Dès les derniers mois de l'Occupation, les mouvements de Résistance et des réalisateurs qui lui sont acquis, souhaitent apporter la preuve, par l'image, de l'action menée contre l'Occupant et contre Vichy. La clandestinité est, sinon ignorée, du moins très mal connue. Il s'agit, dès lors, de contester le regard porté par les Allemands et par Vichy sur la Résistance et les Résistants et de mettre en valeur l'héroïsme de celles et ceux qui ont refusé soumission et collaboration.
La Bataille du rail, film de René Clément, récompensé au premier festival de Cannes en 1946, illustre cette préoccupation sans que les films de Résistance n'acquièrent le monopole des réalisations, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le film de Résistance, à la Libération, doit prendre un aspect documentaire tout en répondant aux préoccupations des mouvements. En ce sens, représentation politique et culturelle, il est le miroir de la société.
Le reflet qu'il renvoie ne peut qu'évoluer dans le temps en fonction du statut dédié à l'action clandestine. En réunissant la plupart des communications présentées dans le cadre de la 10e journée d'études, tenue à Bondues, le 25 janvier 2020, ce volume d'actes interroge, au prisme de ce moment fort et complexe, les relations entre cinéma et histoire.
Dès les derniers mois de l'Occupation, les mouvements de Résistance et des réalisateurs qui lui sont acquis, souhaitent apporter la preuve, par l'image, de l'action menée contre l'Occupant et contre Vichy. La clandestinité est, sinon ignorée, du moins très mal connue. Il s'agit, dès lors, de contester le regard porté par les Allemands et par Vichy sur la Résistance et les Résistants et de mettre en valeur l'héroïsme de celles et ceux qui ont refusé soumission et collaboration.
La Bataille du rail, film de René Clément, récompensé au premier festival de Cannes en 1946, illustre cette préoccupation sans que les films de Résistance n'acquièrent le monopole des réalisations, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le film de Résistance, à la Libération, doit prendre un aspect documentaire tout en répondant aux préoccupations des mouvements. En ce sens, représentation politique et culturelle, il est le miroir de la société.
Le reflet qu'il renvoie ne peut qu'évoluer dans le temps en fonction du statut dédié à l'action clandestine. En réunissant la plupart des communications présentées dans le cadre de la 10e journée d'études, tenue à Bondues, le 25 janvier 2020, ce volume d'actes interroge, au prisme de ce moment fort et complexe, les relations entre cinéma et histoire.
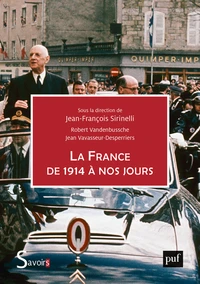
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?