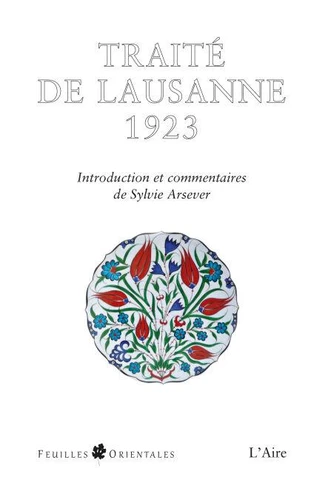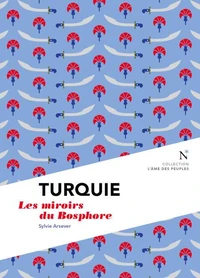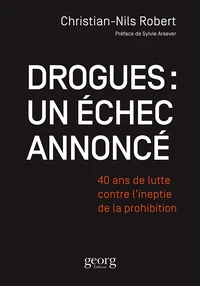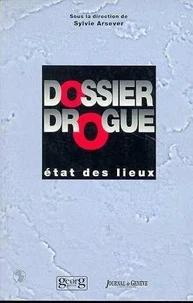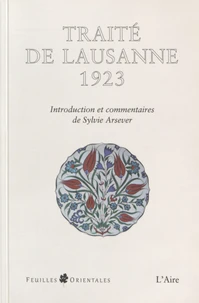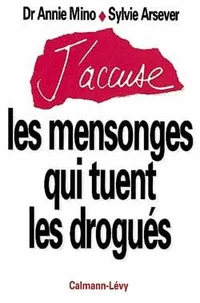Traité de Lausanne 1923
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- FormatePub
- ISBN978-2-940478-98-9
- EAN9782940478989
- Date de parution27/10/2015
- Protection num.pas de protection
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurÉditions de l'Aire
Résumé
Les pages d'Histoire qui dessinèrent définitivement les frontières après la première guerre mondialeLa Première Guerre mondiale sonna le glas des empires austro-hongrois, russes et ottomans et déboucha pour chaque nation héritière d'une délimitation de frontières conclue par un traité de paix. Celles de l'Empire ottoman étaient particulièrement difficiles à tracer en raison de sa vaste étendue, de son multiculturalisme et de la spécificité de son histoire.
D'abord, il y eut le Traité de Sèvres en 1920, concocté dans la hâte par les forces de l'Entente (Grande-Bretagne, France, Italie dont l'esprit avait des relents de colonialisme). Mais celui-ci s'avéra irréaliste et impraticable et provoqua l'ire de la nouvelle Turquie en gestation. Sous les décombres ottomans surgit un mouvement populaire emmené par Mustafa Kemal le visionnaire qui vainquit les Alliés et les Grecs.
Forts de ce succès sur le terrain, les Turcs obtinrent la création d'un nouveau Traité de paix qui eut lieu à Lausanne pendant plusieurs mois et qui fut ratifié par les belligérants le 24 juillet 1923. Comme tout accouchement, celui-ci se fit dans la douleur. Une douleur particulièrement aiguë pour les populations contraintes au déracinement et au retour dans le pays d'origine. Ainsi naquit la nouvelle République de Turquie et furent dessinées définitivement les frontières des pays environnants.
Le passé et l'avenir d'une région stratégique du monde étaient définis en quelques dizaines de pages. Ce livre est agrémenté de cartes géographiques, de photos et d'articles de l'époqueEXTRAITLes frontières C'est évidemment un point déterminant, et le changement majeur par rapport à Sèvres (voir cartes pp. 30-35). Mais seule une petite partie en est discutée à Lausanne, l'essentiel s'était déterminé par la force des armes sur le terrain et concrétisé par des accords bilatéraux avec la France et l'Italie dès 1921, et dans le cadre de l'armistice de Mudanya, signé un mois plus tôt.
La détermination de la frontière gréco-turque en Thrace (art. 2) sert en quelque sorte de round d'échauffement mais, après un baroud d'honneur d'Ismet Pacha pour un plébiscite dans la partie occidentale attribuée à la Grèce, peu de modifications sont apportées au projet allié, si l'on excepte la cession à la Turquie du faubourg de Karagatch, proposée en dernière minute par la Grèce en échange de la renonciation à lui demander des réparations pour les dommages créés par son armée en Anatolie (art.
59). Les règles précises de la démilitarisation sont réglées dans une convention annexe. A PROPOS DE L'AUTEURSylvie Arsever est historienne de formation (Université de Genève) et journaliste en Suisse. Anciennement, vice-présidente du Conseil suisse de la presse, elle gère dorénavant la rubrique « Dossiers » du quotidien suisse Le Temps et publie des ouvrages sur la politique suisse. Elle est également chargée de cours au Centre romand de formation des journalistes.
D'abord, il y eut le Traité de Sèvres en 1920, concocté dans la hâte par les forces de l'Entente (Grande-Bretagne, France, Italie dont l'esprit avait des relents de colonialisme). Mais celui-ci s'avéra irréaliste et impraticable et provoqua l'ire de la nouvelle Turquie en gestation. Sous les décombres ottomans surgit un mouvement populaire emmené par Mustafa Kemal le visionnaire qui vainquit les Alliés et les Grecs.
Forts de ce succès sur le terrain, les Turcs obtinrent la création d'un nouveau Traité de paix qui eut lieu à Lausanne pendant plusieurs mois et qui fut ratifié par les belligérants le 24 juillet 1923. Comme tout accouchement, celui-ci se fit dans la douleur. Une douleur particulièrement aiguë pour les populations contraintes au déracinement et au retour dans le pays d'origine. Ainsi naquit la nouvelle République de Turquie et furent dessinées définitivement les frontières des pays environnants.
Le passé et l'avenir d'une région stratégique du monde étaient définis en quelques dizaines de pages. Ce livre est agrémenté de cartes géographiques, de photos et d'articles de l'époqueEXTRAITLes frontières C'est évidemment un point déterminant, et le changement majeur par rapport à Sèvres (voir cartes pp. 30-35). Mais seule une petite partie en est discutée à Lausanne, l'essentiel s'était déterminé par la force des armes sur le terrain et concrétisé par des accords bilatéraux avec la France et l'Italie dès 1921, et dans le cadre de l'armistice de Mudanya, signé un mois plus tôt.
La détermination de la frontière gréco-turque en Thrace (art. 2) sert en quelque sorte de round d'échauffement mais, après un baroud d'honneur d'Ismet Pacha pour un plébiscite dans la partie occidentale attribuée à la Grèce, peu de modifications sont apportées au projet allié, si l'on excepte la cession à la Turquie du faubourg de Karagatch, proposée en dernière minute par la Grèce en échange de la renonciation à lui demander des réparations pour les dommages créés par son armée en Anatolie (art.
59). Les règles précises de la démilitarisation sont réglées dans une convention annexe. A PROPOS DE L'AUTEURSylvie Arsever est historienne de formation (Université de Genève) et journaliste en Suisse. Anciennement, vice-présidente du Conseil suisse de la presse, elle gère dorénavant la rubrique « Dossiers » du quotidien suisse Le Temps et publie des ouvrages sur la politique suisse. Elle est également chargée de cours au Centre romand de formation des journalistes.
Les pages d'Histoire qui dessinèrent définitivement les frontières après la première guerre mondialeLa Première Guerre mondiale sonna le glas des empires austro-hongrois, russes et ottomans et déboucha pour chaque nation héritière d'une délimitation de frontières conclue par un traité de paix. Celles de l'Empire ottoman étaient particulièrement difficiles à tracer en raison de sa vaste étendue, de son multiculturalisme et de la spécificité de son histoire.
D'abord, il y eut le Traité de Sèvres en 1920, concocté dans la hâte par les forces de l'Entente (Grande-Bretagne, France, Italie dont l'esprit avait des relents de colonialisme). Mais celui-ci s'avéra irréaliste et impraticable et provoqua l'ire de la nouvelle Turquie en gestation. Sous les décombres ottomans surgit un mouvement populaire emmené par Mustafa Kemal le visionnaire qui vainquit les Alliés et les Grecs.
Forts de ce succès sur le terrain, les Turcs obtinrent la création d'un nouveau Traité de paix qui eut lieu à Lausanne pendant plusieurs mois et qui fut ratifié par les belligérants le 24 juillet 1923. Comme tout accouchement, celui-ci se fit dans la douleur. Une douleur particulièrement aiguë pour les populations contraintes au déracinement et au retour dans le pays d'origine. Ainsi naquit la nouvelle République de Turquie et furent dessinées définitivement les frontières des pays environnants.
Le passé et l'avenir d'une région stratégique du monde étaient définis en quelques dizaines de pages. Ce livre est agrémenté de cartes géographiques, de photos et d'articles de l'époqueEXTRAITLes frontières C'est évidemment un point déterminant, et le changement majeur par rapport à Sèvres (voir cartes pp. 30-35). Mais seule une petite partie en est discutée à Lausanne, l'essentiel s'était déterminé par la force des armes sur le terrain et concrétisé par des accords bilatéraux avec la France et l'Italie dès 1921, et dans le cadre de l'armistice de Mudanya, signé un mois plus tôt.
La détermination de la frontière gréco-turque en Thrace (art. 2) sert en quelque sorte de round d'échauffement mais, après un baroud d'honneur d'Ismet Pacha pour un plébiscite dans la partie occidentale attribuée à la Grèce, peu de modifications sont apportées au projet allié, si l'on excepte la cession à la Turquie du faubourg de Karagatch, proposée en dernière minute par la Grèce en échange de la renonciation à lui demander des réparations pour les dommages créés par son armée en Anatolie (art.
59). Les règles précises de la démilitarisation sont réglées dans une convention annexe. A PROPOS DE L'AUTEURSylvie Arsever est historienne de formation (Université de Genève) et journaliste en Suisse. Anciennement, vice-présidente du Conseil suisse de la presse, elle gère dorénavant la rubrique « Dossiers » du quotidien suisse Le Temps et publie des ouvrages sur la politique suisse. Elle est également chargée de cours au Centre romand de formation des journalistes.
D'abord, il y eut le Traité de Sèvres en 1920, concocté dans la hâte par les forces de l'Entente (Grande-Bretagne, France, Italie dont l'esprit avait des relents de colonialisme). Mais celui-ci s'avéra irréaliste et impraticable et provoqua l'ire de la nouvelle Turquie en gestation. Sous les décombres ottomans surgit un mouvement populaire emmené par Mustafa Kemal le visionnaire qui vainquit les Alliés et les Grecs.
Forts de ce succès sur le terrain, les Turcs obtinrent la création d'un nouveau Traité de paix qui eut lieu à Lausanne pendant plusieurs mois et qui fut ratifié par les belligérants le 24 juillet 1923. Comme tout accouchement, celui-ci se fit dans la douleur. Une douleur particulièrement aiguë pour les populations contraintes au déracinement et au retour dans le pays d'origine. Ainsi naquit la nouvelle République de Turquie et furent dessinées définitivement les frontières des pays environnants.
Le passé et l'avenir d'une région stratégique du monde étaient définis en quelques dizaines de pages. Ce livre est agrémenté de cartes géographiques, de photos et d'articles de l'époqueEXTRAITLes frontières C'est évidemment un point déterminant, et le changement majeur par rapport à Sèvres (voir cartes pp. 30-35). Mais seule une petite partie en est discutée à Lausanne, l'essentiel s'était déterminé par la force des armes sur le terrain et concrétisé par des accords bilatéraux avec la France et l'Italie dès 1921, et dans le cadre de l'armistice de Mudanya, signé un mois plus tôt.
La détermination de la frontière gréco-turque en Thrace (art. 2) sert en quelque sorte de round d'échauffement mais, après un baroud d'honneur d'Ismet Pacha pour un plébiscite dans la partie occidentale attribuée à la Grèce, peu de modifications sont apportées au projet allié, si l'on excepte la cession à la Turquie du faubourg de Karagatch, proposée en dernière minute par la Grèce en échange de la renonciation à lui demander des réparations pour les dommages créés par son armée en Anatolie (art.
59). Les règles précises de la démilitarisation sont réglées dans une convention annexe. A PROPOS DE L'AUTEURSylvie Arsever est historienne de formation (Université de Genève) et journaliste en Suisse. Anciennement, vice-présidente du Conseil suisse de la presse, elle gère dorénavant la rubrique « Dossiers » du quotidien suisse Le Temps et publie des ouvrages sur la politique suisse. Elle est également chargée de cours au Centre romand de formation des journalistes.