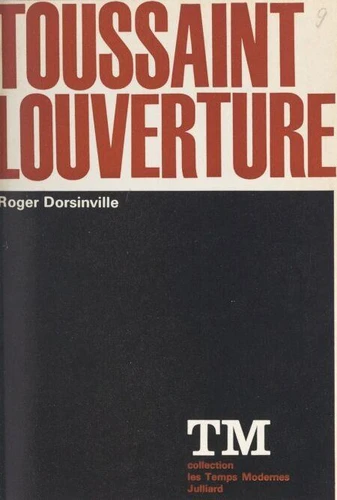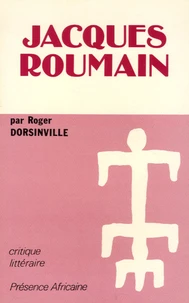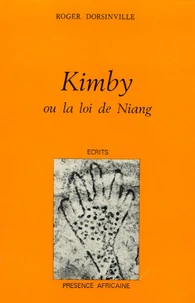Toussaint Louverture. Ou La vocation de la liberté
Par : , ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages294
- FormatePub
- ISBN2-260-04693-2
- EAN9782260046936
- Date de parution01/01/1965
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille983 Ko
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurJulliard (réédition numérique Fe...
Résumé
La brève histoire qui est ici retracée, de 1789 à 1802, dépasse de beaucoup l'aventure personnelle de cet homme sur qui l'auteur a choisi de la centrer (de façon pourtant fort significative). C'est en effet l'histoire des rapports entre deux Révolutions, celle de Saint-Domingue et celle dite de 89, « la nôtre » - qui ne commença guère qu'une année plus tôt, mais qui allait déboucher pour nous sur l'Empire en cette même année 1804 où sa sour presque jumelle accédait à l'indépendance.
A la lire aujourd'hui, on ne peut que se sentir très profondément concerné, et assez diversement troublé. Il y a cet exemplaire cheminement, depuis la révolte des colons français contre l'autorité française (pour des raisons d'intérêt commercial) jusqu'à la rupture définitive avec la métropole, en passant par les soulèvements successifs des petits blancs, des propriétaires autochtones et enfin des esclaves eux-mêmes.
Il y a cette étonnante dialectique entre les contradictions sociales dont souffrait à Saint-Domingue la volonté de libération et celles qui déterminaient en France, au même moment, les temps forts et les temps faibles de la dynamique révolutionnaire. Il y a ce phénomène de radicalisation selon lequel les esclaves (les « nouveaux libres ») s'emparèrent du pouvoir, à peine les affranchis (les « anciens libres ») étaient-ils parvenus à s'y installer...
Mais sans doute y a-t-il, par-dessus tout, ce prodigieux télescopage auquel nous sommes contraints d'assister entre l'époque de Toussaint Louverture et la nôtre, que sépare pourtant plus d'un siècle et demi. Citant la profession de foi d'un planteur (libérer les esclaves serait « les rendre cent fois plus malheureux qu'ils ne sont »), et la rapprochant de ce noble souci du sort du fellah dont se prévalaient récemment nos « humanistes en uniforme », Roger Dorsinville nous fait toucher du doigt cette plaie vive, dans notre progressiste univers : « Il n'est pas possible, dit-il, que dans cent soixante ans encore, l'Histoire ait à poser son oil ironique sur un autre planteur ou un autre centurion. »
A la lire aujourd'hui, on ne peut que se sentir très profondément concerné, et assez diversement troublé. Il y a cet exemplaire cheminement, depuis la révolte des colons français contre l'autorité française (pour des raisons d'intérêt commercial) jusqu'à la rupture définitive avec la métropole, en passant par les soulèvements successifs des petits blancs, des propriétaires autochtones et enfin des esclaves eux-mêmes.
Il y a cette étonnante dialectique entre les contradictions sociales dont souffrait à Saint-Domingue la volonté de libération et celles qui déterminaient en France, au même moment, les temps forts et les temps faibles de la dynamique révolutionnaire. Il y a ce phénomène de radicalisation selon lequel les esclaves (les « nouveaux libres ») s'emparèrent du pouvoir, à peine les affranchis (les « anciens libres ») étaient-ils parvenus à s'y installer...
Mais sans doute y a-t-il, par-dessus tout, ce prodigieux télescopage auquel nous sommes contraints d'assister entre l'époque de Toussaint Louverture et la nôtre, que sépare pourtant plus d'un siècle et demi. Citant la profession de foi d'un planteur (libérer les esclaves serait « les rendre cent fois plus malheureux qu'ils ne sont »), et la rapprochant de ce noble souci du sort du fellah dont se prévalaient récemment nos « humanistes en uniforme », Roger Dorsinville nous fait toucher du doigt cette plaie vive, dans notre progressiste univers : « Il n'est pas possible, dit-il, que dans cent soixante ans encore, l'Histoire ait à poser son oil ironique sur un autre planteur ou un autre centurion. »
La brève histoire qui est ici retracée, de 1789 à 1802, dépasse de beaucoup l'aventure personnelle de cet homme sur qui l'auteur a choisi de la centrer (de façon pourtant fort significative). C'est en effet l'histoire des rapports entre deux Révolutions, celle de Saint-Domingue et celle dite de 89, « la nôtre » - qui ne commença guère qu'une année plus tôt, mais qui allait déboucher pour nous sur l'Empire en cette même année 1804 où sa sour presque jumelle accédait à l'indépendance.
A la lire aujourd'hui, on ne peut que se sentir très profondément concerné, et assez diversement troublé. Il y a cet exemplaire cheminement, depuis la révolte des colons français contre l'autorité française (pour des raisons d'intérêt commercial) jusqu'à la rupture définitive avec la métropole, en passant par les soulèvements successifs des petits blancs, des propriétaires autochtones et enfin des esclaves eux-mêmes.
Il y a cette étonnante dialectique entre les contradictions sociales dont souffrait à Saint-Domingue la volonté de libération et celles qui déterminaient en France, au même moment, les temps forts et les temps faibles de la dynamique révolutionnaire. Il y a ce phénomène de radicalisation selon lequel les esclaves (les « nouveaux libres ») s'emparèrent du pouvoir, à peine les affranchis (les « anciens libres ») étaient-ils parvenus à s'y installer...
Mais sans doute y a-t-il, par-dessus tout, ce prodigieux télescopage auquel nous sommes contraints d'assister entre l'époque de Toussaint Louverture et la nôtre, que sépare pourtant plus d'un siècle et demi. Citant la profession de foi d'un planteur (libérer les esclaves serait « les rendre cent fois plus malheureux qu'ils ne sont »), et la rapprochant de ce noble souci du sort du fellah dont se prévalaient récemment nos « humanistes en uniforme », Roger Dorsinville nous fait toucher du doigt cette plaie vive, dans notre progressiste univers : « Il n'est pas possible, dit-il, que dans cent soixante ans encore, l'Histoire ait à poser son oil ironique sur un autre planteur ou un autre centurion. »
A la lire aujourd'hui, on ne peut que se sentir très profondément concerné, et assez diversement troublé. Il y a cet exemplaire cheminement, depuis la révolte des colons français contre l'autorité française (pour des raisons d'intérêt commercial) jusqu'à la rupture définitive avec la métropole, en passant par les soulèvements successifs des petits blancs, des propriétaires autochtones et enfin des esclaves eux-mêmes.
Il y a cette étonnante dialectique entre les contradictions sociales dont souffrait à Saint-Domingue la volonté de libération et celles qui déterminaient en France, au même moment, les temps forts et les temps faibles de la dynamique révolutionnaire. Il y a ce phénomène de radicalisation selon lequel les esclaves (les « nouveaux libres ») s'emparèrent du pouvoir, à peine les affranchis (les « anciens libres ») étaient-ils parvenus à s'y installer...
Mais sans doute y a-t-il, par-dessus tout, ce prodigieux télescopage auquel nous sommes contraints d'assister entre l'époque de Toussaint Louverture et la nôtre, que sépare pourtant plus d'un siècle et demi. Citant la profession de foi d'un planteur (libérer les esclaves serait « les rendre cent fois plus malheureux qu'ils ne sont »), et la rapprochant de ce noble souci du sort du fellah dont se prévalaient récemment nos « humanistes en uniforme », Roger Dorsinville nous fait toucher du doigt cette plaie vive, dans notre progressiste univers : « Il n'est pas possible, dit-il, que dans cent soixante ans encore, l'Histoire ait à poser son oil ironique sur un autre planteur ou un autre centurion. »