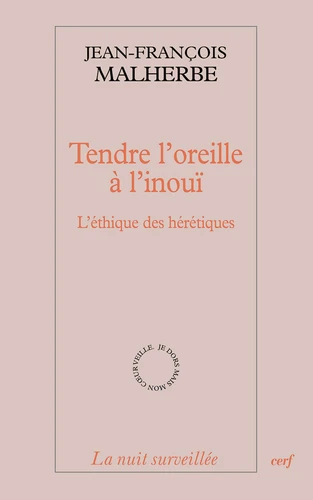Tendre l'oreille à l'inouï. L'éthique des hérétiques
Par : , ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub protégé est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
- Non compatible avec un achat hors France métropolitaine
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- FormatePub
- ISBN978-2-204-12029-6
- EAN9782204120296
- Date de parution25/11/2016
- Protection num.Adobe DRM
- Taille338 Ko
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurEditions du Cerf
Résumé
La tradition philosophique occidentale recèle des propos éthiques inouïs. Étrangement, ces propos ont été articulés par des penseurs que l'on a souvent considérés comme des « hérétiques » et qui, pour cette raison, ont été diffamés, ostracisés, condamnés, voire exécutés. Héraclite, Socrate, Épicure, Eckhart, Spinoza, Wittgenstein, Arendt et quelques autres exclus ont prononcé des paroles qui n'ont pas été entendues.
Sans doute parce qu'elles étaient « hérétiques », c'est-à-dire inaudibles par les pouvoirs en place qu'elles mettaient en cause, directement ou indirectement. Le mot français « hérésie » vient d'une racine grecque qui connote la décision et la pensée. Un « hairetikos » est quelqu'un qui pense par lui-même et décide de façon autonome. On perçoit immédiatement le renversement sémantique qui caractérise le sens de ce mot, depuis l'Inquisition jusqu'à nos jours, où il désigne plutôt un « déviant », un mouton noir dans un troupeau de moutons blancs, un empêcheur de tourner en rond, un gêneur, un dissident, voire un séditieux.
Ce sont pourtant ces « hérétiques » qui ont pensé la nécessité de substituer en éthique l'inclusion à l'exclusion. Une étrange surdité s'est structurée à travers les siècles à l'égard de leurs contributions les plus décisives. L'ouvrage tente de dégager des archives de notre culture quelques éléments d'une éthique de l'inclusion. Les éléments demeurés inouïs nous permettraient sans doute, si nous les entendions, de trouver comment surmonter les crises qui nous assaillent de toutes parts.
Sans doute parce qu'elles étaient « hérétiques », c'est-à-dire inaudibles par les pouvoirs en place qu'elles mettaient en cause, directement ou indirectement. Le mot français « hérésie » vient d'une racine grecque qui connote la décision et la pensée. Un « hairetikos » est quelqu'un qui pense par lui-même et décide de façon autonome. On perçoit immédiatement le renversement sémantique qui caractérise le sens de ce mot, depuis l'Inquisition jusqu'à nos jours, où il désigne plutôt un « déviant », un mouton noir dans un troupeau de moutons blancs, un empêcheur de tourner en rond, un gêneur, un dissident, voire un séditieux.
Ce sont pourtant ces « hérétiques » qui ont pensé la nécessité de substituer en éthique l'inclusion à l'exclusion. Une étrange surdité s'est structurée à travers les siècles à l'égard de leurs contributions les plus décisives. L'ouvrage tente de dégager des archives de notre culture quelques éléments d'une éthique de l'inclusion. Les éléments demeurés inouïs nous permettraient sans doute, si nous les entendions, de trouver comment surmonter les crises qui nous assaillent de toutes parts.
La tradition philosophique occidentale recèle des propos éthiques inouïs. Étrangement, ces propos ont été articulés par des penseurs que l'on a souvent considérés comme des « hérétiques » et qui, pour cette raison, ont été diffamés, ostracisés, condamnés, voire exécutés. Héraclite, Socrate, Épicure, Eckhart, Spinoza, Wittgenstein, Arendt et quelques autres exclus ont prononcé des paroles qui n'ont pas été entendues.
Sans doute parce qu'elles étaient « hérétiques », c'est-à-dire inaudibles par les pouvoirs en place qu'elles mettaient en cause, directement ou indirectement. Le mot français « hérésie » vient d'une racine grecque qui connote la décision et la pensée. Un « hairetikos » est quelqu'un qui pense par lui-même et décide de façon autonome. On perçoit immédiatement le renversement sémantique qui caractérise le sens de ce mot, depuis l'Inquisition jusqu'à nos jours, où il désigne plutôt un « déviant », un mouton noir dans un troupeau de moutons blancs, un empêcheur de tourner en rond, un gêneur, un dissident, voire un séditieux.
Ce sont pourtant ces « hérétiques » qui ont pensé la nécessité de substituer en éthique l'inclusion à l'exclusion. Une étrange surdité s'est structurée à travers les siècles à l'égard de leurs contributions les plus décisives. L'ouvrage tente de dégager des archives de notre culture quelques éléments d'une éthique de l'inclusion. Les éléments demeurés inouïs nous permettraient sans doute, si nous les entendions, de trouver comment surmonter les crises qui nous assaillent de toutes parts.
Sans doute parce qu'elles étaient « hérétiques », c'est-à-dire inaudibles par les pouvoirs en place qu'elles mettaient en cause, directement ou indirectement. Le mot français « hérésie » vient d'une racine grecque qui connote la décision et la pensée. Un « hairetikos » est quelqu'un qui pense par lui-même et décide de façon autonome. On perçoit immédiatement le renversement sémantique qui caractérise le sens de ce mot, depuis l'Inquisition jusqu'à nos jours, où il désigne plutôt un « déviant », un mouton noir dans un troupeau de moutons blancs, un empêcheur de tourner en rond, un gêneur, un dissident, voire un séditieux.
Ce sont pourtant ces « hérétiques » qui ont pensé la nécessité de substituer en éthique l'inclusion à l'exclusion. Une étrange surdité s'est structurée à travers les siècles à l'égard de leurs contributions les plus décisives. L'ouvrage tente de dégager des archives de notre culture quelques éléments d'une éthique de l'inclusion. Les éléments demeurés inouïs nous permettraient sans doute, si nous les entendions, de trouver comment surmonter les crises qui nous assaillent de toutes parts.