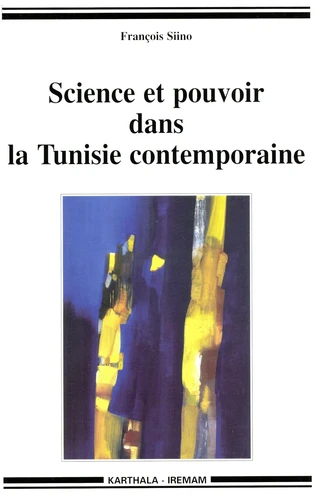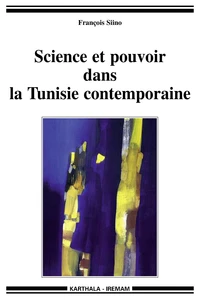Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format Multi-format est :
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages405
- FormatMulti-format
- ISBN978-2-8111-3866-0
- EAN9782811138660
- Date de parution09/09/2013
- Protection num.NC
- Infos supplémentairesMulti-format incluant PDF avec W...
- ÉditeurInstitut de recherches et d’étud...
- PréfacierAhmed Mahiou
Résumé
Dès l'indépendance tunisienne, la science a été fortement mobilisée dans les discours des pouvoirs politiques. Elle est présentée comme la condition du développement économique, la voie d'une émancipation générale du peuple, la garantie de l'indépendance et de la puissance du nouvel État. Mais les conditions socio-historiques de la naissance d'une pratique scientifique en Tunisie ont conféré à la mise en actes de ce discours un caractère ambigu.
Tout d'abord, l'Université, lieu de l'éclosion de la recherche scientifique dès l'années 1960, est devenue, après un court « état de grâce », le symbole d'une contestation politique virulente, notamment islamiste à partir des années 1980. Ensuite, les premières générations de scientifiques tunisiens, marquées, lors de leur formation à l'étranger, par les valeurs de l'universalisme scientifique, ont très tôt associé pratique scientifique et ouverture d'un espace de débat critique.
C'est cette tension entre les représentations politiques de la science et les conditions sociales de sa pratique que tente d'analyser cet ouvrage centré sur la période cruciale des quarante ans qui précèdent l'adoption, en 1996, d'un cadre législatif pour la recherche scientifique en Tunisie. Il montre comment les politiques scientifiques mises en ouvres révèlent un rapport équivoque des pouvoirs politiques tunisiens à la science, et peut-être plus encore aux « savants ».
Et comment, dans la période la plus récente, la tentative de concilier libéralisation économique et maintien d'un ordre politique centralisé et autoritaire ne laisse aux scientifiques d'autre alternative que d'être marginalisés ou étroitement agrégés à l'appareil d'État sous prétexte d'efficacité : c'est-à-dire dans les deux cas, hors d'état d'agir sur les orientations de leur pratique.
Tout d'abord, l'Université, lieu de l'éclosion de la recherche scientifique dès l'années 1960, est devenue, après un court « état de grâce », le symbole d'une contestation politique virulente, notamment islamiste à partir des années 1980. Ensuite, les premières générations de scientifiques tunisiens, marquées, lors de leur formation à l'étranger, par les valeurs de l'universalisme scientifique, ont très tôt associé pratique scientifique et ouverture d'un espace de débat critique.
C'est cette tension entre les représentations politiques de la science et les conditions sociales de sa pratique que tente d'analyser cet ouvrage centré sur la période cruciale des quarante ans qui précèdent l'adoption, en 1996, d'un cadre législatif pour la recherche scientifique en Tunisie. Il montre comment les politiques scientifiques mises en ouvres révèlent un rapport équivoque des pouvoirs politiques tunisiens à la science, et peut-être plus encore aux « savants ».
Et comment, dans la période la plus récente, la tentative de concilier libéralisation économique et maintien d'un ordre politique centralisé et autoritaire ne laisse aux scientifiques d'autre alternative que d'être marginalisés ou étroitement agrégés à l'appareil d'État sous prétexte d'efficacité : c'est-à-dire dans les deux cas, hors d'état d'agir sur les orientations de leur pratique.
Dès l'indépendance tunisienne, la science a été fortement mobilisée dans les discours des pouvoirs politiques. Elle est présentée comme la condition du développement économique, la voie d'une émancipation générale du peuple, la garantie de l'indépendance et de la puissance du nouvel État. Mais les conditions socio-historiques de la naissance d'une pratique scientifique en Tunisie ont conféré à la mise en actes de ce discours un caractère ambigu.
Tout d'abord, l'Université, lieu de l'éclosion de la recherche scientifique dès l'années 1960, est devenue, après un court « état de grâce », le symbole d'une contestation politique virulente, notamment islamiste à partir des années 1980. Ensuite, les premières générations de scientifiques tunisiens, marquées, lors de leur formation à l'étranger, par les valeurs de l'universalisme scientifique, ont très tôt associé pratique scientifique et ouverture d'un espace de débat critique.
C'est cette tension entre les représentations politiques de la science et les conditions sociales de sa pratique que tente d'analyser cet ouvrage centré sur la période cruciale des quarante ans qui précèdent l'adoption, en 1996, d'un cadre législatif pour la recherche scientifique en Tunisie. Il montre comment les politiques scientifiques mises en ouvres révèlent un rapport équivoque des pouvoirs politiques tunisiens à la science, et peut-être plus encore aux « savants ».
Et comment, dans la période la plus récente, la tentative de concilier libéralisation économique et maintien d'un ordre politique centralisé et autoritaire ne laisse aux scientifiques d'autre alternative que d'être marginalisés ou étroitement agrégés à l'appareil d'État sous prétexte d'efficacité : c'est-à-dire dans les deux cas, hors d'état d'agir sur les orientations de leur pratique.
Tout d'abord, l'Université, lieu de l'éclosion de la recherche scientifique dès l'années 1960, est devenue, après un court « état de grâce », le symbole d'une contestation politique virulente, notamment islamiste à partir des années 1980. Ensuite, les premières générations de scientifiques tunisiens, marquées, lors de leur formation à l'étranger, par les valeurs de l'universalisme scientifique, ont très tôt associé pratique scientifique et ouverture d'un espace de débat critique.
C'est cette tension entre les représentations politiques de la science et les conditions sociales de sa pratique que tente d'analyser cet ouvrage centré sur la période cruciale des quarante ans qui précèdent l'adoption, en 1996, d'un cadre législatif pour la recherche scientifique en Tunisie. Il montre comment les politiques scientifiques mises en ouvres révèlent un rapport équivoque des pouvoirs politiques tunisiens à la science, et peut-être plus encore aux « savants ».
Et comment, dans la période la plus récente, la tentative de concilier libéralisation économique et maintien d'un ordre politique centralisé et autoritaire ne laisse aux scientifiques d'autre alternative que d'être marginalisés ou étroitement agrégés à l'appareil d'État sous prétexte d'efficacité : c'est-à-dire dans les deux cas, hors d'état d'agir sur les orientations de leur pratique.