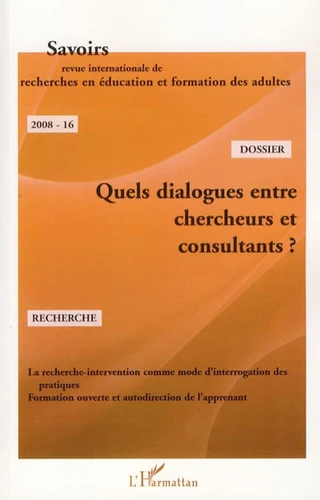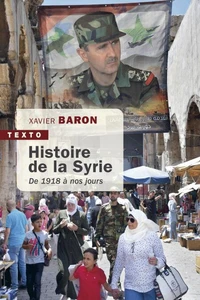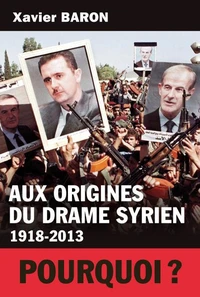Savoirs N° 16, 2008
Quels dialogues entre chercheurs et consultants ?
Par : Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages150
- FormatPDF
- ISBN978-2-296-19254-6
- EAN9782296192546
- Date de parution01/03/2008
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille4 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Voici une livraison relativement originale de la revue Savoirs : le sujet du dossier est plus incertain, plus polémique aussi que la plupart des thèmes que nous avons traités. La relation entre praticiens et chercheurs n'est pas un thème nouveau en soi mais sa définition comme objet scientifique reste un problème. Xavier Baron a accepté de faire le tour d'un champ mal défini, protéiforme et instable.
De quels chercheurs parlons-nous ? De quelles sciences aussi ? Et qui sont ces praticiens qui prétendent dialoguer avec la recherche ? Des questions de territoire, de méthodes mais aussi d'identités montrent que ce fameux dialogue auquel tous disent aspirer pose des questions épistémologiques redoutables pour autant que l'on veuille bien avancer dans une réflexion sur les pratiques des uns et des autres.
Cette note de synthèse nous aidera à circonscrire la discussion mais aussi à lancer le débat. Preuve en est donnée d'ores et déjà par les rebonds de Philippe Carré, Jean-Pierre Bouchez et Pierre Caspar qui ne craignent pas de réagir et proposer des approches complémentaires du sujet. Deux articles de recherche sont proposés ici. Le premier, dont le thème correspond bien au dossier, est signé par Corinne Merini et Pascale Ponté.
Il s'agit en effet de s'interroger sur les pratiques de recherche-intervention. Après avoir situé l'émergence de la notion de recherche-intervention à partir d'une analyse sociohistorique, les auteures cherchent à clarifier les relations de coopération qui s'instaurent entre recherche, formation et intervention. L'article d'Annie Jézégou concerne les formations ouvertes et l'autodirection de l'apprenant.
Il fonde tout d'abord la définition selon laquelle une formation est ouverte si elle ouvre des libertés de choix à l'apprenant, au regard des différentes composantes du dispositif pédagogique. En s'appuyant sur les résultats d'une étude empirique, l'auteure montre que la perception des apprenants au regard de l'ouverture joue ici un rôle médiateur dans l'influence du dispositif sur leurs comportements autorégulés.
De quels chercheurs parlons-nous ? De quelles sciences aussi ? Et qui sont ces praticiens qui prétendent dialoguer avec la recherche ? Des questions de territoire, de méthodes mais aussi d'identités montrent que ce fameux dialogue auquel tous disent aspirer pose des questions épistémologiques redoutables pour autant que l'on veuille bien avancer dans une réflexion sur les pratiques des uns et des autres.
Cette note de synthèse nous aidera à circonscrire la discussion mais aussi à lancer le débat. Preuve en est donnée d'ores et déjà par les rebonds de Philippe Carré, Jean-Pierre Bouchez et Pierre Caspar qui ne craignent pas de réagir et proposer des approches complémentaires du sujet. Deux articles de recherche sont proposés ici. Le premier, dont le thème correspond bien au dossier, est signé par Corinne Merini et Pascale Ponté.
Il s'agit en effet de s'interroger sur les pratiques de recherche-intervention. Après avoir situé l'émergence de la notion de recherche-intervention à partir d'une analyse sociohistorique, les auteures cherchent à clarifier les relations de coopération qui s'instaurent entre recherche, formation et intervention. L'article d'Annie Jézégou concerne les formations ouvertes et l'autodirection de l'apprenant.
Il fonde tout d'abord la définition selon laquelle une formation est ouverte si elle ouvre des libertés de choix à l'apprenant, au regard des différentes composantes du dispositif pédagogique. En s'appuyant sur les résultats d'une étude empirique, l'auteure montre que la perception des apprenants au regard de l'ouverture joue ici un rôle médiateur dans l'influence du dispositif sur leurs comportements autorégulés.
Voici une livraison relativement originale de la revue Savoirs : le sujet du dossier est plus incertain, plus polémique aussi que la plupart des thèmes que nous avons traités. La relation entre praticiens et chercheurs n'est pas un thème nouveau en soi mais sa définition comme objet scientifique reste un problème. Xavier Baron a accepté de faire le tour d'un champ mal défini, protéiforme et instable.
De quels chercheurs parlons-nous ? De quelles sciences aussi ? Et qui sont ces praticiens qui prétendent dialoguer avec la recherche ? Des questions de territoire, de méthodes mais aussi d'identités montrent que ce fameux dialogue auquel tous disent aspirer pose des questions épistémologiques redoutables pour autant que l'on veuille bien avancer dans une réflexion sur les pratiques des uns et des autres.
Cette note de synthèse nous aidera à circonscrire la discussion mais aussi à lancer le débat. Preuve en est donnée d'ores et déjà par les rebonds de Philippe Carré, Jean-Pierre Bouchez et Pierre Caspar qui ne craignent pas de réagir et proposer des approches complémentaires du sujet. Deux articles de recherche sont proposés ici. Le premier, dont le thème correspond bien au dossier, est signé par Corinne Merini et Pascale Ponté.
Il s'agit en effet de s'interroger sur les pratiques de recherche-intervention. Après avoir situé l'émergence de la notion de recherche-intervention à partir d'une analyse sociohistorique, les auteures cherchent à clarifier les relations de coopération qui s'instaurent entre recherche, formation et intervention. L'article d'Annie Jézégou concerne les formations ouvertes et l'autodirection de l'apprenant.
Il fonde tout d'abord la définition selon laquelle une formation est ouverte si elle ouvre des libertés de choix à l'apprenant, au regard des différentes composantes du dispositif pédagogique. En s'appuyant sur les résultats d'une étude empirique, l'auteure montre que la perception des apprenants au regard de l'ouverture joue ici un rôle médiateur dans l'influence du dispositif sur leurs comportements autorégulés.
De quels chercheurs parlons-nous ? De quelles sciences aussi ? Et qui sont ces praticiens qui prétendent dialoguer avec la recherche ? Des questions de territoire, de méthodes mais aussi d'identités montrent que ce fameux dialogue auquel tous disent aspirer pose des questions épistémologiques redoutables pour autant que l'on veuille bien avancer dans une réflexion sur les pratiques des uns et des autres.
Cette note de synthèse nous aidera à circonscrire la discussion mais aussi à lancer le débat. Preuve en est donnée d'ores et déjà par les rebonds de Philippe Carré, Jean-Pierre Bouchez et Pierre Caspar qui ne craignent pas de réagir et proposer des approches complémentaires du sujet. Deux articles de recherche sont proposés ici. Le premier, dont le thème correspond bien au dossier, est signé par Corinne Merini et Pascale Ponté.
Il s'agit en effet de s'interroger sur les pratiques de recherche-intervention. Après avoir situé l'émergence de la notion de recherche-intervention à partir d'une analyse sociohistorique, les auteures cherchent à clarifier les relations de coopération qui s'instaurent entre recherche, formation et intervention. L'article d'Annie Jézégou concerne les formations ouvertes et l'autodirection de l'apprenant.
Il fonde tout d'abord la définition selon laquelle une formation est ouverte si elle ouvre des libertés de choix à l'apprenant, au regard des différentes composantes du dispositif pédagogique. En s'appuyant sur les résultats d'une étude empirique, l'auteure montre que la perception des apprenants au regard de l'ouverture joue ici un rôle médiateur dans l'influence du dispositif sur leurs comportements autorégulés.