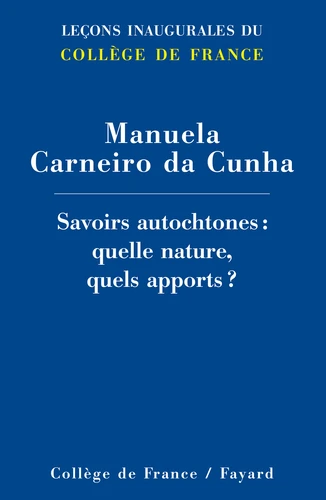Savoirs autochtones : quelle nature, quels apports ?
Par :Formats :
Actuellement indisponible
Cet article est actuellement indisponible, il ne peut pas être commandé sur notre site pour le moment. Nous vous invitons à vous inscrire à l'alerte disponibilité, vous recevrez un e-mail dès que cet ouvrage sera à nouveau disponible.
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub protégé est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
- Non compatible avec un achat hors France métropolitaine
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages64
- FormatePub
- ISBN978-2-213-67467-4
- EAN9782213674674
- Date de parution07/11/2012
- Copier CollerNon Autorisé
- Protection num.Adobe & CARE
- Taille255 Ko
- ÉditeurFayard
Résumé
En 1992, la convention de Rio sur la diversité biologique reconnaissait officiellement et pour la première fois l'importance des savoirs autochtones face aux grands défis écologiques et humanistes des décennies à venir. Si les peuples traditionnels sont désormais officiellement reconnus dans l'espace politique et les institutions internationales, les différents acteurs - peuples autochtones, ONG, États et scientifiques - ont parfois des pratiques et des visions radicalement différentes, notamment en matière d'utilisation et de rémunération des ressources génétiques et d'exploitation des brevets qui y sont liés.
Si l'un des objectifs de la convention de Rio est « le partage juste et équitable des bénéfices issus de l'utilisation des ressources génétiques », les efforts traditionnels de conservation et les préoccupations économiques ne font pas toujours bon ménage. Dans ce contexte, les recherches sur la nature, les programmes et les régimes des savoirs traditionnels deviennent cruciales. Nous ne sommes pas en présence d'un seul mode d'accès à la connaissance, mais bien d'une pléthore de régimes de savoir qu'il faut encore connaître.
Ignorer ces dimensions, c'est mettre en danger la continuité des systèmes de savoirs autochtones.
Si l'un des objectifs de la convention de Rio est « le partage juste et équitable des bénéfices issus de l'utilisation des ressources génétiques », les efforts traditionnels de conservation et les préoccupations économiques ne font pas toujours bon ménage. Dans ce contexte, les recherches sur la nature, les programmes et les régimes des savoirs traditionnels deviennent cruciales. Nous ne sommes pas en présence d'un seul mode d'accès à la connaissance, mais bien d'une pléthore de régimes de savoir qu'il faut encore connaître.
Ignorer ces dimensions, c'est mettre en danger la continuité des systèmes de savoirs autochtones.
En 1992, la convention de Rio sur la diversité biologique reconnaissait officiellement et pour la première fois l'importance des savoirs autochtones face aux grands défis écologiques et humanistes des décennies à venir. Si les peuples traditionnels sont désormais officiellement reconnus dans l'espace politique et les institutions internationales, les différents acteurs - peuples autochtones, ONG, États et scientifiques - ont parfois des pratiques et des visions radicalement différentes, notamment en matière d'utilisation et de rémunération des ressources génétiques et d'exploitation des brevets qui y sont liés.
Si l'un des objectifs de la convention de Rio est « le partage juste et équitable des bénéfices issus de l'utilisation des ressources génétiques », les efforts traditionnels de conservation et les préoccupations économiques ne font pas toujours bon ménage. Dans ce contexte, les recherches sur la nature, les programmes et les régimes des savoirs traditionnels deviennent cruciales. Nous ne sommes pas en présence d'un seul mode d'accès à la connaissance, mais bien d'une pléthore de régimes de savoir qu'il faut encore connaître.
Ignorer ces dimensions, c'est mettre en danger la continuité des systèmes de savoirs autochtones.
Si l'un des objectifs de la convention de Rio est « le partage juste et équitable des bénéfices issus de l'utilisation des ressources génétiques », les efforts traditionnels de conservation et les préoccupations économiques ne font pas toujours bon ménage. Dans ce contexte, les recherches sur la nature, les programmes et les régimes des savoirs traditionnels deviennent cruciales. Nous ne sommes pas en présence d'un seul mode d'accès à la connaissance, mais bien d'une pléthore de régimes de savoir qu'il faut encore connaître.
Ignorer ces dimensions, c'est mettre en danger la continuité des systèmes de savoirs autochtones.