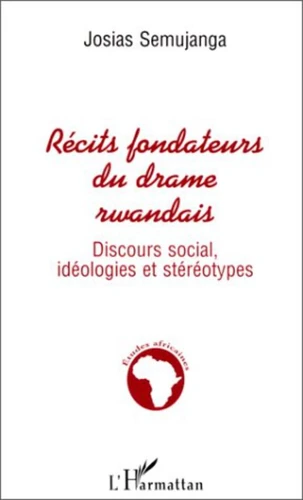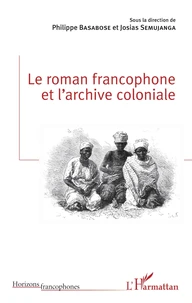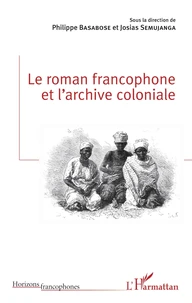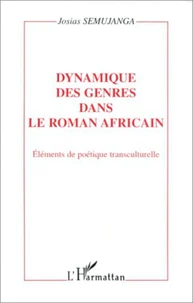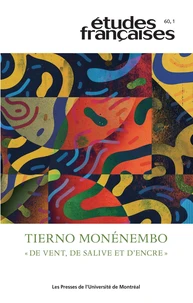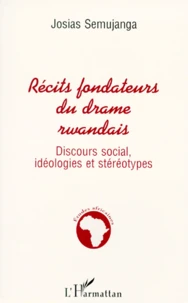RECITS FONDATEURS DU DRAME RWANDAIS.. Discours social, idéologies et stéréotypes
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages256
- FormatPDF
- ISBN2-296-37479-4
- EAN9782296374799
- Date de parution01/01/1998
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille9 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
A la base du drame rwandais, il y a le récit colonial ethnocentrique sur la Civilisation. Ce récit fait du Tutsi le Hamite (appelé "faux Nègre") venu du Caucase pour apporter "la civilisation aux vrais Nègres appelés Bantou-Hutu". A la veille de l'indépendance, Le Manifeste des Bahutu inverse les prémisses de cette logique coloniale. Il attribue au Tutsi une "nature dangereuse", en fait "l'ennemi absolu" face auquel toutes les mesures d'autodéfense sont prônées.
Ce préjugé, largement partagé par la population, crée un seuil d'acceptabilité sur la "nocivité" du Tutsi et légitime son extermination. C'est sur cet aspect que ce livre apporte un éclairage nouveau par rapport aux études antérieures. Car il remet en question le schéma souvent privilégié de la culpabilité de l'Etat et de l'innocence du peuple. C'est pourquoi une question demeure : une meilleure compréhension du génocide permettrait-elle de contenir la folie collective quand celle-ci s'inscrit dans une idéologie raciale au service d'un régime politique ? Cette dramatique interrogation incite à redoubler de vigilance vis-à-vis des élites qui nous gouvernent.
Car le drame rwandais a montré qu'il ne suffit plus de dire "plus jamais ça" pour que "ça" ne revienne plus.
Ce préjugé, largement partagé par la population, crée un seuil d'acceptabilité sur la "nocivité" du Tutsi et légitime son extermination. C'est sur cet aspect que ce livre apporte un éclairage nouveau par rapport aux études antérieures. Car il remet en question le schéma souvent privilégié de la culpabilité de l'Etat et de l'innocence du peuple. C'est pourquoi une question demeure : une meilleure compréhension du génocide permettrait-elle de contenir la folie collective quand celle-ci s'inscrit dans une idéologie raciale au service d'un régime politique ? Cette dramatique interrogation incite à redoubler de vigilance vis-à-vis des élites qui nous gouvernent.
Car le drame rwandais a montré qu'il ne suffit plus de dire "plus jamais ça" pour que "ça" ne revienne plus.
A la base du drame rwandais, il y a le récit colonial ethnocentrique sur la Civilisation. Ce récit fait du Tutsi le Hamite (appelé "faux Nègre") venu du Caucase pour apporter "la civilisation aux vrais Nègres appelés Bantou-Hutu". A la veille de l'indépendance, Le Manifeste des Bahutu inverse les prémisses de cette logique coloniale. Il attribue au Tutsi une "nature dangereuse", en fait "l'ennemi absolu" face auquel toutes les mesures d'autodéfense sont prônées.
Ce préjugé, largement partagé par la population, crée un seuil d'acceptabilité sur la "nocivité" du Tutsi et légitime son extermination. C'est sur cet aspect que ce livre apporte un éclairage nouveau par rapport aux études antérieures. Car il remet en question le schéma souvent privilégié de la culpabilité de l'Etat et de l'innocence du peuple. C'est pourquoi une question demeure : une meilleure compréhension du génocide permettrait-elle de contenir la folie collective quand celle-ci s'inscrit dans une idéologie raciale au service d'un régime politique ? Cette dramatique interrogation incite à redoubler de vigilance vis-à-vis des élites qui nous gouvernent.
Car le drame rwandais a montré qu'il ne suffit plus de dire "plus jamais ça" pour que "ça" ne revienne plus.
Ce préjugé, largement partagé par la population, crée un seuil d'acceptabilité sur la "nocivité" du Tutsi et légitime son extermination. C'est sur cet aspect que ce livre apporte un éclairage nouveau par rapport aux études antérieures. Car il remet en question le schéma souvent privilégié de la culpabilité de l'Etat et de l'innocence du peuple. C'est pourquoi une question demeure : une meilleure compréhension du génocide permettrait-elle de contenir la folie collective quand celle-ci s'inscrit dans une idéologie raciale au service d'un régime politique ? Cette dramatique interrogation incite à redoubler de vigilance vis-à-vis des élites qui nous gouvernent.
Car le drame rwandais a montré qu'il ne suffit plus de dire "plus jamais ça" pour que "ça" ne revienne plus.