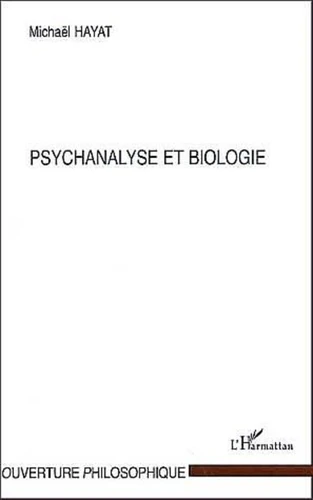Psychanalyse et biologie
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages240
- FormatPDF
- ISBN2-296-29964-4
- EAN9782296299641
- Date de parution01/01/2002
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille8 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
L'énigme humaine tient dans cette question : comment l'homme symbolise-t-il la dynamique biologique ? Seule une meilleure compréhension de la représentation mentale peut nous aider à y répondre. La pensée, en effet, est une activité de représentation. En outre, le pouvoir de représentation est créateur d'une réalité relativement autonome par rapport à celle de la simple copie, mais aussi plus riche que celle de l'expression analogique.
Enfin, pour le comprendre, il est nécessaire d'éclairer la relation entre processus endogènes et sources exogènes de la représentation. Telles sont les hypothèses de cette investigation. Or, la psychanalyse tente de penser l'énigme humaine à partir de ces mêmes hypothèses. Du double point de vue psychologique et anthropologique, elle doit être prise au sérieux, mieux connue et approfondie, notamment pour éclairer la relation entre mémoire et symbolisation.
Pourtant, la théorie freudienne est ouverte à des interprétations diverses et parfois contradictoires. L'opposition la plus générale est favorisée par l'œuvre freudienne elle-même : une perspective biologisante et moniste de l'esprit d'un côté, une approche métaphorisante et dualiste de l'autre. Or, c'est précisément le lien entre biologique et métaphorique qui fait problème. Sans l'effort pour lier rigoureusement le processus de métaphorisation et, plus globalement, de symbolisation, au biologique et au physique, la psychanalyse resterait un nouveau spiritualisme ou l'énième avatar du subjectivisme.
Or, nous travaillons ici à partir d'une hypothèse moniste et matérialiste. Pour comprendre l'esprit, il convient donc d'en revenir à la matérialité du corps. Mais toute théorie qui tire de l'interprétation psychologique, comme philosophique une certaine idée du vivant court le risque de " penser la tête à l'envers " et de manquer son objet en le surdéterminant : il convient au contraire de partir du biologique, voire du physique, pour mieux remonter vers l'esprit.
Notre thèse est la suivante : la psychologie doit s'enraciner dans les sciences de la vie et les formes mentales sont une traduction des formes biologiques via la cérébralité. Mais enracinement n'est pas réduction. En outre, la notion de forme biologique reste problématique. C'est à son éclairage que se consacre la fin de cette recherche, qui confronte les modèles instructionnistes et sélectionnistes du vivant.
Enfin, pour le comprendre, il est nécessaire d'éclairer la relation entre processus endogènes et sources exogènes de la représentation. Telles sont les hypothèses de cette investigation. Or, la psychanalyse tente de penser l'énigme humaine à partir de ces mêmes hypothèses. Du double point de vue psychologique et anthropologique, elle doit être prise au sérieux, mieux connue et approfondie, notamment pour éclairer la relation entre mémoire et symbolisation.
Pourtant, la théorie freudienne est ouverte à des interprétations diverses et parfois contradictoires. L'opposition la plus générale est favorisée par l'œuvre freudienne elle-même : une perspective biologisante et moniste de l'esprit d'un côté, une approche métaphorisante et dualiste de l'autre. Or, c'est précisément le lien entre biologique et métaphorique qui fait problème. Sans l'effort pour lier rigoureusement le processus de métaphorisation et, plus globalement, de symbolisation, au biologique et au physique, la psychanalyse resterait un nouveau spiritualisme ou l'énième avatar du subjectivisme.
Or, nous travaillons ici à partir d'une hypothèse moniste et matérialiste. Pour comprendre l'esprit, il convient donc d'en revenir à la matérialité du corps. Mais toute théorie qui tire de l'interprétation psychologique, comme philosophique une certaine idée du vivant court le risque de " penser la tête à l'envers " et de manquer son objet en le surdéterminant : il convient au contraire de partir du biologique, voire du physique, pour mieux remonter vers l'esprit.
Notre thèse est la suivante : la psychologie doit s'enraciner dans les sciences de la vie et les formes mentales sont une traduction des formes biologiques via la cérébralité. Mais enracinement n'est pas réduction. En outre, la notion de forme biologique reste problématique. C'est à son éclairage que se consacre la fin de cette recherche, qui confronte les modèles instructionnistes et sélectionnistes du vivant.
L'énigme humaine tient dans cette question : comment l'homme symbolise-t-il la dynamique biologique ? Seule une meilleure compréhension de la représentation mentale peut nous aider à y répondre. La pensée, en effet, est une activité de représentation. En outre, le pouvoir de représentation est créateur d'une réalité relativement autonome par rapport à celle de la simple copie, mais aussi plus riche que celle de l'expression analogique.
Enfin, pour le comprendre, il est nécessaire d'éclairer la relation entre processus endogènes et sources exogènes de la représentation. Telles sont les hypothèses de cette investigation. Or, la psychanalyse tente de penser l'énigme humaine à partir de ces mêmes hypothèses. Du double point de vue psychologique et anthropologique, elle doit être prise au sérieux, mieux connue et approfondie, notamment pour éclairer la relation entre mémoire et symbolisation.
Pourtant, la théorie freudienne est ouverte à des interprétations diverses et parfois contradictoires. L'opposition la plus générale est favorisée par l'œuvre freudienne elle-même : une perspective biologisante et moniste de l'esprit d'un côté, une approche métaphorisante et dualiste de l'autre. Or, c'est précisément le lien entre biologique et métaphorique qui fait problème. Sans l'effort pour lier rigoureusement le processus de métaphorisation et, plus globalement, de symbolisation, au biologique et au physique, la psychanalyse resterait un nouveau spiritualisme ou l'énième avatar du subjectivisme.
Or, nous travaillons ici à partir d'une hypothèse moniste et matérialiste. Pour comprendre l'esprit, il convient donc d'en revenir à la matérialité du corps. Mais toute théorie qui tire de l'interprétation psychologique, comme philosophique une certaine idée du vivant court le risque de " penser la tête à l'envers " et de manquer son objet en le surdéterminant : il convient au contraire de partir du biologique, voire du physique, pour mieux remonter vers l'esprit.
Notre thèse est la suivante : la psychologie doit s'enraciner dans les sciences de la vie et les formes mentales sont une traduction des formes biologiques via la cérébralité. Mais enracinement n'est pas réduction. En outre, la notion de forme biologique reste problématique. C'est à son éclairage que se consacre la fin de cette recherche, qui confronte les modèles instructionnistes et sélectionnistes du vivant.
Enfin, pour le comprendre, il est nécessaire d'éclairer la relation entre processus endogènes et sources exogènes de la représentation. Telles sont les hypothèses de cette investigation. Or, la psychanalyse tente de penser l'énigme humaine à partir de ces mêmes hypothèses. Du double point de vue psychologique et anthropologique, elle doit être prise au sérieux, mieux connue et approfondie, notamment pour éclairer la relation entre mémoire et symbolisation.
Pourtant, la théorie freudienne est ouverte à des interprétations diverses et parfois contradictoires. L'opposition la plus générale est favorisée par l'œuvre freudienne elle-même : une perspective biologisante et moniste de l'esprit d'un côté, une approche métaphorisante et dualiste de l'autre. Or, c'est précisément le lien entre biologique et métaphorique qui fait problème. Sans l'effort pour lier rigoureusement le processus de métaphorisation et, plus globalement, de symbolisation, au biologique et au physique, la psychanalyse resterait un nouveau spiritualisme ou l'énième avatar du subjectivisme.
Or, nous travaillons ici à partir d'une hypothèse moniste et matérialiste. Pour comprendre l'esprit, il convient donc d'en revenir à la matérialité du corps. Mais toute théorie qui tire de l'interprétation psychologique, comme philosophique une certaine idée du vivant court le risque de " penser la tête à l'envers " et de manquer son objet en le surdéterminant : il convient au contraire de partir du biologique, voire du physique, pour mieux remonter vers l'esprit.
Notre thèse est la suivante : la psychologie doit s'enraciner dans les sciences de la vie et les formes mentales sont une traduction des formes biologiques via la cérébralité. Mais enracinement n'est pas réduction. En outre, la notion de forme biologique reste problématique. C'est à son éclairage que se consacre la fin de cette recherche, qui confronte les modèles instructionnistes et sélectionnistes du vivant.