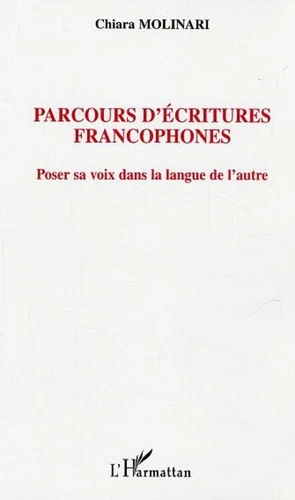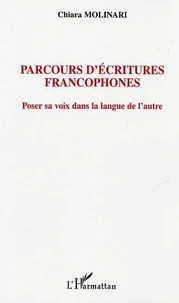Parcours d'écritures francophones. Poser sa voix dans la langue de l'autre
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages248
- FormatPDF
- ISBN2-296-40152-X
- EAN9782296401525
- Date de parution01/06/2005
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille8 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
On se propose ici d'étudier la manière dont trois écrivains francophones (A. Hampâté Bâ pour le Mali, P. Chamoiseau pour la Martinique et M. Tremblay pour le Québec) parviennent à imprimer leur marque verbale propre et à poser leur voix dans la langue de l'autre, notamment en relation au français standard normé. L'examen des représentations écrites d'une oralité tout à la fois complexifiée du fait des contacts entre langues (ou variétés de langues) et cultures hétérogènes dans des espaces multilingues et affectée par des modes de scolarisation largement unilingue constitue le point de départ.
Trois hypothèses guident notre recherche : la première pose l'existence d'un lien entre la distance qui sépare les langues enjeu et la nature des relations qui s'établissent entre elles : la transition d'un cadre de variétés multiples et éloignées, comme le Mali, à un contexte de plurilinguisme entre des variétés plus proches, comme la Martinique ou le Québec, s'accompagne d'une intensification de l'insécurité linguistique.
La deuxième tend à étayer l'idée que l'insécurité linguistique augmente proportionnellement à la disparition des dispositifs assurant la médiation entre les variétés linguistiques en jeu. Enfin, la troisième envisage une relation entre les choix stratégiques effectués sur le plan de l'écriture et les conditions de sécurité vs insécurité ethniques et identitaires.
Trois hypothèses guident notre recherche : la première pose l'existence d'un lien entre la distance qui sépare les langues enjeu et la nature des relations qui s'établissent entre elles : la transition d'un cadre de variétés multiples et éloignées, comme le Mali, à un contexte de plurilinguisme entre des variétés plus proches, comme la Martinique ou le Québec, s'accompagne d'une intensification de l'insécurité linguistique.
La deuxième tend à étayer l'idée que l'insécurité linguistique augmente proportionnellement à la disparition des dispositifs assurant la médiation entre les variétés linguistiques en jeu. Enfin, la troisième envisage une relation entre les choix stratégiques effectués sur le plan de l'écriture et les conditions de sécurité vs insécurité ethniques et identitaires.
On se propose ici d'étudier la manière dont trois écrivains francophones (A. Hampâté Bâ pour le Mali, P. Chamoiseau pour la Martinique et M. Tremblay pour le Québec) parviennent à imprimer leur marque verbale propre et à poser leur voix dans la langue de l'autre, notamment en relation au français standard normé. L'examen des représentations écrites d'une oralité tout à la fois complexifiée du fait des contacts entre langues (ou variétés de langues) et cultures hétérogènes dans des espaces multilingues et affectée par des modes de scolarisation largement unilingue constitue le point de départ.
Trois hypothèses guident notre recherche : la première pose l'existence d'un lien entre la distance qui sépare les langues enjeu et la nature des relations qui s'établissent entre elles : la transition d'un cadre de variétés multiples et éloignées, comme le Mali, à un contexte de plurilinguisme entre des variétés plus proches, comme la Martinique ou le Québec, s'accompagne d'une intensification de l'insécurité linguistique.
La deuxième tend à étayer l'idée que l'insécurité linguistique augmente proportionnellement à la disparition des dispositifs assurant la médiation entre les variétés linguistiques en jeu. Enfin, la troisième envisage une relation entre les choix stratégiques effectués sur le plan de l'écriture et les conditions de sécurité vs insécurité ethniques et identitaires.
Trois hypothèses guident notre recherche : la première pose l'existence d'un lien entre la distance qui sépare les langues enjeu et la nature des relations qui s'établissent entre elles : la transition d'un cadre de variétés multiples et éloignées, comme le Mali, à un contexte de plurilinguisme entre des variétés plus proches, comme la Martinique ou le Québec, s'accompagne d'une intensification de l'insécurité linguistique.
La deuxième tend à étayer l'idée que l'insécurité linguistique augmente proportionnellement à la disparition des dispositifs assurant la médiation entre les variétés linguistiques en jeu. Enfin, la troisième envisage une relation entre les choix stratégiques effectués sur le plan de l'écriture et les conditions de sécurité vs insécurité ethniques et identitaires.