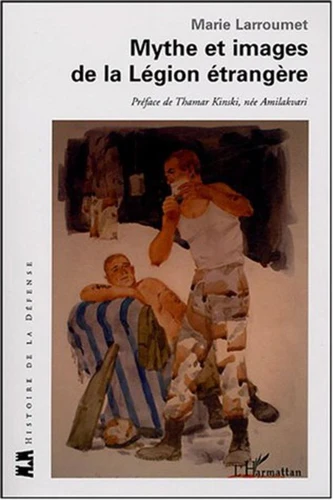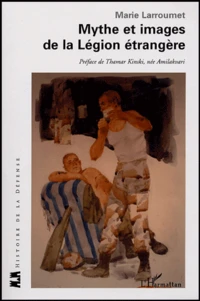Mythe et images de la légion étrangère
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages310
- FormatPDF
- ISBN2-296-37574-X
- EAN9782296375741
- Date de parution01/10/2004
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille12 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
- PréfacierThamar Kinski
Résumé
La Légion étrangère est créée par le roi Louis-Philippe en 1831. Le public ne découvre cependant que très progressivement cette Légion composée d'étrangers que l'on envoie guerroyer en pays lointains. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, grâce à différents témoignages d'anciens légionnaires ou de civils qui ont côtoyé la Légion puis grâce à l'intervention de l'Institution elle-même qui commence à prendre son image en main, la Légion et le légionnaire acquièrent une identité propre aux yeux du public.
Depuis cette époque, les deux facettes de la personnalité du légionnaire se disputent les faveurs de la littérature, de la chanson et du cinéma : pour certains le " képi blanc " est un héros mythique infiniment romantique - qu'il était beau mon légionnaire - ; pour d'autres, c'est un mercenaire sans foi ni loi. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en 1978, les deux images évoluent parallèlement, la première puis la seconde prenant le pas sur l'autre.
Après 1978, la Légion étant parvenue à surmonter les difficultés inhérentes à son arrivée en France métropolitaine et le public s'étant habitué à côtoyer les " képis blancs ", ces deux représentations s'estompent quelque peu. A travers l'étude de la presse, de la littérature, de la chanson et du cinéma, l'auteur étudie l'évolution de la manière dont le public imagine la Légion étrangère, le légionnaire et l'interaction qu'il existe entre ces représentations et l'image que l'institution souhaite donner d'elle-même.
Elle ne cherche, en aucun cas, à faire la part du mythe et de la réalité dans la vision que le public a de la Légion et du légionnaire.
Depuis cette époque, les deux facettes de la personnalité du légionnaire se disputent les faveurs de la littérature, de la chanson et du cinéma : pour certains le " képi blanc " est un héros mythique infiniment romantique - qu'il était beau mon légionnaire - ; pour d'autres, c'est un mercenaire sans foi ni loi. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en 1978, les deux images évoluent parallèlement, la première puis la seconde prenant le pas sur l'autre.
Après 1978, la Légion étant parvenue à surmonter les difficultés inhérentes à son arrivée en France métropolitaine et le public s'étant habitué à côtoyer les " képis blancs ", ces deux représentations s'estompent quelque peu. A travers l'étude de la presse, de la littérature, de la chanson et du cinéma, l'auteur étudie l'évolution de la manière dont le public imagine la Légion étrangère, le légionnaire et l'interaction qu'il existe entre ces représentations et l'image que l'institution souhaite donner d'elle-même.
Elle ne cherche, en aucun cas, à faire la part du mythe et de la réalité dans la vision que le public a de la Légion et du légionnaire.
La Légion étrangère est créée par le roi Louis-Philippe en 1831. Le public ne découvre cependant que très progressivement cette Légion composée d'étrangers que l'on envoie guerroyer en pays lointains. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, grâce à différents témoignages d'anciens légionnaires ou de civils qui ont côtoyé la Légion puis grâce à l'intervention de l'Institution elle-même qui commence à prendre son image en main, la Légion et le légionnaire acquièrent une identité propre aux yeux du public.
Depuis cette époque, les deux facettes de la personnalité du légionnaire se disputent les faveurs de la littérature, de la chanson et du cinéma : pour certains le " képi blanc " est un héros mythique infiniment romantique - qu'il était beau mon légionnaire - ; pour d'autres, c'est un mercenaire sans foi ni loi. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en 1978, les deux images évoluent parallèlement, la première puis la seconde prenant le pas sur l'autre.
Après 1978, la Légion étant parvenue à surmonter les difficultés inhérentes à son arrivée en France métropolitaine et le public s'étant habitué à côtoyer les " képis blancs ", ces deux représentations s'estompent quelque peu. A travers l'étude de la presse, de la littérature, de la chanson et du cinéma, l'auteur étudie l'évolution de la manière dont le public imagine la Légion étrangère, le légionnaire et l'interaction qu'il existe entre ces représentations et l'image que l'institution souhaite donner d'elle-même.
Elle ne cherche, en aucun cas, à faire la part du mythe et de la réalité dans la vision que le public a de la Légion et du légionnaire.
Depuis cette époque, les deux facettes de la personnalité du légionnaire se disputent les faveurs de la littérature, de la chanson et du cinéma : pour certains le " képi blanc " est un héros mythique infiniment romantique - qu'il était beau mon légionnaire - ; pour d'autres, c'est un mercenaire sans foi ni loi. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en 1978, les deux images évoluent parallèlement, la première puis la seconde prenant le pas sur l'autre.
Après 1978, la Légion étant parvenue à surmonter les difficultés inhérentes à son arrivée en France métropolitaine et le public s'étant habitué à côtoyer les " képis blancs ", ces deux représentations s'estompent quelque peu. A travers l'étude de la presse, de la littérature, de la chanson et du cinéma, l'auteur étudie l'évolution de la manière dont le public imagine la Légion étrangère, le légionnaire et l'interaction qu'il existe entre ces représentations et l'image que l'institution souhaite donner d'elle-même.
Elle ne cherche, en aucun cas, à faire la part du mythe et de la réalité dans la vision que le public a de la Légion et du légionnaire.