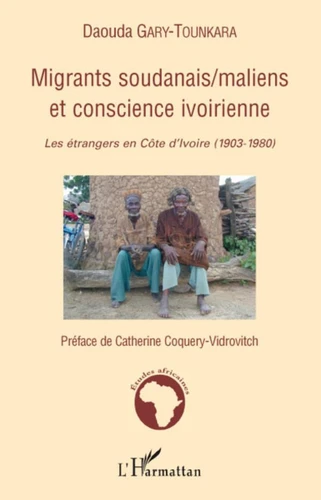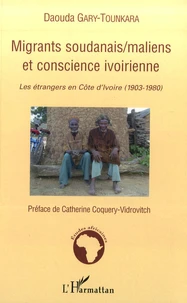Migrants soudanais / maliens et conscience ivoirienne. Les étrangers en Côte d'Ivoire (1903-1980)
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages344
- FormatPDF
- ISBN978-2-296-20610-6
- EAN9782296206106
- Date de parution01/09/2008
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille13 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
- PréfacierCatherine Coquery-Vidrovitch
Résumé
Cet ouvrage analyse les migrations du Soudan-Mali vers la Côte d'Ivoire de 1903, début de la " pacification " de la Côte d'Ivoire, à 1980, fin de la période de prospérité économique ivoirienne amorcée à l'indépendance en 1960. L'auteur examine les politiques migratoires (coloniales, nationales) et la diversification des flux migratoires (soldats, marchands, anciens captifs, travailleurs) entre les deux pays.
Ces flux s'inscrivent dans le prolongement des migrations anciennes reliant la vallée du fleuve Niger à la Côte d'Ivoire. Après 1903, les alliances matrimoniales et professionnelles nouées entre les migrants et les autochtones se sont transformées. Les constructions identitaires du pouvoir colonial puis du président de la République Félix Houphouët-Boigny, élu en 1960, mettant en concurrence Ivoiriens et Soudanais/Maliens (riches contre pauvres, résistants à la conquête contre auxiliaires coloniaux, paresseux contre travailleurs, originaires du pays contre étrangers) ont toutefois favorisé une exclusion des migrants par les autochtones, ainsi que des conflits identitaires et professionnels.
Ce travail contribue à mettre en lumière les racines historiques du nationalisme ivoirien et de l'ivoirité dans sa dimension xénophobe. La perception de la présence soudanaise/malienne en Côte d'Ivoire et surtout sa gestion politique participent en effet du processus par lequel les Ivoiriens rejettent un pouvoir autoritaire qui utilise les migrants contre les autochtones. L'auteur montre que ce rejet relève moins de la xénophobie que d'une contestation croissante de l'Etat.
Ces flux s'inscrivent dans le prolongement des migrations anciennes reliant la vallée du fleuve Niger à la Côte d'Ivoire. Après 1903, les alliances matrimoniales et professionnelles nouées entre les migrants et les autochtones se sont transformées. Les constructions identitaires du pouvoir colonial puis du président de la République Félix Houphouët-Boigny, élu en 1960, mettant en concurrence Ivoiriens et Soudanais/Maliens (riches contre pauvres, résistants à la conquête contre auxiliaires coloniaux, paresseux contre travailleurs, originaires du pays contre étrangers) ont toutefois favorisé une exclusion des migrants par les autochtones, ainsi que des conflits identitaires et professionnels.
Ce travail contribue à mettre en lumière les racines historiques du nationalisme ivoirien et de l'ivoirité dans sa dimension xénophobe. La perception de la présence soudanaise/malienne en Côte d'Ivoire et surtout sa gestion politique participent en effet du processus par lequel les Ivoiriens rejettent un pouvoir autoritaire qui utilise les migrants contre les autochtones. L'auteur montre que ce rejet relève moins de la xénophobie que d'une contestation croissante de l'Etat.
Cet ouvrage analyse les migrations du Soudan-Mali vers la Côte d'Ivoire de 1903, début de la " pacification " de la Côte d'Ivoire, à 1980, fin de la période de prospérité économique ivoirienne amorcée à l'indépendance en 1960. L'auteur examine les politiques migratoires (coloniales, nationales) et la diversification des flux migratoires (soldats, marchands, anciens captifs, travailleurs) entre les deux pays.
Ces flux s'inscrivent dans le prolongement des migrations anciennes reliant la vallée du fleuve Niger à la Côte d'Ivoire. Après 1903, les alliances matrimoniales et professionnelles nouées entre les migrants et les autochtones se sont transformées. Les constructions identitaires du pouvoir colonial puis du président de la République Félix Houphouët-Boigny, élu en 1960, mettant en concurrence Ivoiriens et Soudanais/Maliens (riches contre pauvres, résistants à la conquête contre auxiliaires coloniaux, paresseux contre travailleurs, originaires du pays contre étrangers) ont toutefois favorisé une exclusion des migrants par les autochtones, ainsi que des conflits identitaires et professionnels.
Ce travail contribue à mettre en lumière les racines historiques du nationalisme ivoirien et de l'ivoirité dans sa dimension xénophobe. La perception de la présence soudanaise/malienne en Côte d'Ivoire et surtout sa gestion politique participent en effet du processus par lequel les Ivoiriens rejettent un pouvoir autoritaire qui utilise les migrants contre les autochtones. L'auteur montre que ce rejet relève moins de la xénophobie que d'une contestation croissante de l'Etat.
Ces flux s'inscrivent dans le prolongement des migrations anciennes reliant la vallée du fleuve Niger à la Côte d'Ivoire. Après 1903, les alliances matrimoniales et professionnelles nouées entre les migrants et les autochtones se sont transformées. Les constructions identitaires du pouvoir colonial puis du président de la République Félix Houphouët-Boigny, élu en 1960, mettant en concurrence Ivoiriens et Soudanais/Maliens (riches contre pauvres, résistants à la conquête contre auxiliaires coloniaux, paresseux contre travailleurs, originaires du pays contre étrangers) ont toutefois favorisé une exclusion des migrants par les autochtones, ainsi que des conflits identitaires et professionnels.
Ce travail contribue à mettre en lumière les racines historiques du nationalisme ivoirien et de l'ivoirité dans sa dimension xénophobe. La perception de la présence soudanaise/malienne en Côte d'Ivoire et surtout sa gestion politique participent en effet du processus par lequel les Ivoiriens rejettent un pouvoir autoritaire qui utilise les migrants contre les autochtones. L'auteur montre que ce rejet relève moins de la xénophobie que d'une contestation croissante de l'Etat.