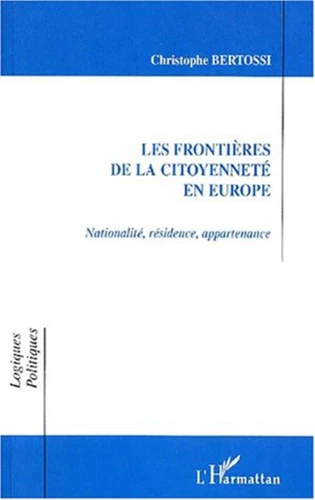Les frontières de la citoyenneté en Europe
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages304
- FormatPDF
- ISBN2-296-16790-X
- EAN9782296167902
- Date de parution01/01/2001
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille10 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Au milieu des années 1980, la nationalité cristallise des débats passionnels, en Europe, autour des angoisses des sociétés nationales à propos de leur "identité" et de la place des étrangers dans la Cité. A la fin des années 1990, les termes du débat ont profondément changé. Maintenant, la nationalité n'apparaît plus comme une barrière qui devrait être dressée contre les populations issues de l'immigration.
Le droit du sol devient une règle pour la nationalité de la plupart des Etats européens. Les enfants et petits-enfants des "immigrés" économiques des années 1970 acquièrent un droit automatique à la citoyenneté. Comment évaluer cette transition ? S'agit-il d'une réconciliation entre l'Etat-nation et l'immigration ? En procédant à une analyse comparative du contexte européen de la nationalité, cet ouvrage montre comment de telles évolutions ne sont pas une réconciliation entre la nationalité, la citoyenneté libérale et l'immigration.
Elles révèlent plutôt les limites mêmes du principe national à asseoir, aujourd'hui, la mesure démocratique de l'exclusion politique. La discrimination nationale, sur laquelle se fonde historiquement la nationalité, n'est plus compatible avec les citoyennetés disponibles en Europe. Longtemps complémentaire, la relation citoyenneté-nationalité apparaît désormais comme synonyme de l'échec du libéralisme national.
Les attentes de citoyenneté se transforment en contestation de la nationalité. Il n'existe plus de consensus sur la manière dont une société libérale doit désigner les étrangers et distribuer les appartenances politiques. Où en est aujourd'hui la négociation sur la citoyenneté en Europe ? Quelle influences la citoyenneté européenne a-t-elle sur cette négociation ? Quelle est la place de la nationalité dans ce contexte ? Comment désigner les étrangers, les citoyens, mais aussi les minorités culturelles dans des espaces réellement démocratiques ? L'enjeu d'une redéfinition des frontières de la citoyenneté en Europe tient, au final, à une refonte globale de la notion de citoyenneté elle-même.
Le droit du sol devient une règle pour la nationalité de la plupart des Etats européens. Les enfants et petits-enfants des "immigrés" économiques des années 1970 acquièrent un droit automatique à la citoyenneté. Comment évaluer cette transition ? S'agit-il d'une réconciliation entre l'Etat-nation et l'immigration ? En procédant à une analyse comparative du contexte européen de la nationalité, cet ouvrage montre comment de telles évolutions ne sont pas une réconciliation entre la nationalité, la citoyenneté libérale et l'immigration.
Elles révèlent plutôt les limites mêmes du principe national à asseoir, aujourd'hui, la mesure démocratique de l'exclusion politique. La discrimination nationale, sur laquelle se fonde historiquement la nationalité, n'est plus compatible avec les citoyennetés disponibles en Europe. Longtemps complémentaire, la relation citoyenneté-nationalité apparaît désormais comme synonyme de l'échec du libéralisme national.
Les attentes de citoyenneté se transforment en contestation de la nationalité. Il n'existe plus de consensus sur la manière dont une société libérale doit désigner les étrangers et distribuer les appartenances politiques. Où en est aujourd'hui la négociation sur la citoyenneté en Europe ? Quelle influences la citoyenneté européenne a-t-elle sur cette négociation ? Quelle est la place de la nationalité dans ce contexte ? Comment désigner les étrangers, les citoyens, mais aussi les minorités culturelles dans des espaces réellement démocratiques ? L'enjeu d'une redéfinition des frontières de la citoyenneté en Europe tient, au final, à une refonte globale de la notion de citoyenneté elle-même.
Au milieu des années 1980, la nationalité cristallise des débats passionnels, en Europe, autour des angoisses des sociétés nationales à propos de leur "identité" et de la place des étrangers dans la Cité. A la fin des années 1990, les termes du débat ont profondément changé. Maintenant, la nationalité n'apparaît plus comme une barrière qui devrait être dressée contre les populations issues de l'immigration.
Le droit du sol devient une règle pour la nationalité de la plupart des Etats européens. Les enfants et petits-enfants des "immigrés" économiques des années 1970 acquièrent un droit automatique à la citoyenneté. Comment évaluer cette transition ? S'agit-il d'une réconciliation entre l'Etat-nation et l'immigration ? En procédant à une analyse comparative du contexte européen de la nationalité, cet ouvrage montre comment de telles évolutions ne sont pas une réconciliation entre la nationalité, la citoyenneté libérale et l'immigration.
Elles révèlent plutôt les limites mêmes du principe national à asseoir, aujourd'hui, la mesure démocratique de l'exclusion politique. La discrimination nationale, sur laquelle se fonde historiquement la nationalité, n'est plus compatible avec les citoyennetés disponibles en Europe. Longtemps complémentaire, la relation citoyenneté-nationalité apparaît désormais comme synonyme de l'échec du libéralisme national.
Les attentes de citoyenneté se transforment en contestation de la nationalité. Il n'existe plus de consensus sur la manière dont une société libérale doit désigner les étrangers et distribuer les appartenances politiques. Où en est aujourd'hui la négociation sur la citoyenneté en Europe ? Quelle influences la citoyenneté européenne a-t-elle sur cette négociation ? Quelle est la place de la nationalité dans ce contexte ? Comment désigner les étrangers, les citoyens, mais aussi les minorités culturelles dans des espaces réellement démocratiques ? L'enjeu d'une redéfinition des frontières de la citoyenneté en Europe tient, au final, à une refonte globale de la notion de citoyenneté elle-même.
Le droit du sol devient une règle pour la nationalité de la plupart des Etats européens. Les enfants et petits-enfants des "immigrés" économiques des années 1970 acquièrent un droit automatique à la citoyenneté. Comment évaluer cette transition ? S'agit-il d'une réconciliation entre l'Etat-nation et l'immigration ? En procédant à une analyse comparative du contexte européen de la nationalité, cet ouvrage montre comment de telles évolutions ne sont pas une réconciliation entre la nationalité, la citoyenneté libérale et l'immigration.
Elles révèlent plutôt les limites mêmes du principe national à asseoir, aujourd'hui, la mesure démocratique de l'exclusion politique. La discrimination nationale, sur laquelle se fonde historiquement la nationalité, n'est plus compatible avec les citoyennetés disponibles en Europe. Longtemps complémentaire, la relation citoyenneté-nationalité apparaît désormais comme synonyme de l'échec du libéralisme national.
Les attentes de citoyenneté se transforment en contestation de la nationalité. Il n'existe plus de consensus sur la manière dont une société libérale doit désigner les étrangers et distribuer les appartenances politiques. Où en est aujourd'hui la négociation sur la citoyenneté en Europe ? Quelle influences la citoyenneté européenne a-t-elle sur cette négociation ? Quelle est la place de la nationalité dans ce contexte ? Comment désigner les étrangers, les citoyens, mais aussi les minorités culturelles dans des espaces réellement démocratiques ? L'enjeu d'une redéfinition des frontières de la citoyenneté en Europe tient, au final, à une refonte globale de la notion de citoyenneté elle-même.