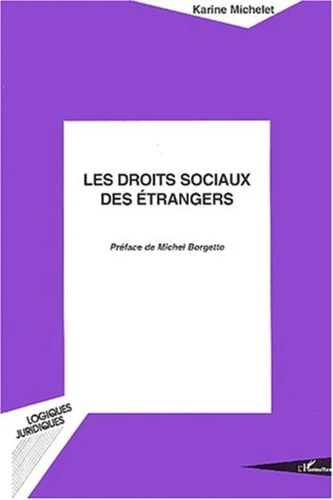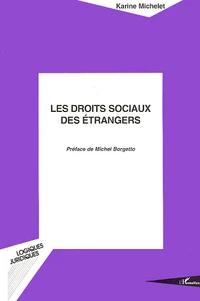Les droits sociaux des étrangers
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages498
- FormatPDF
- ISBN2-296-30159-2
- EAN9782296301597
- Date de parution01/01/2002
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille20 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Si l'analyse de la condition des étrangers est en général révélatrice du degré de tolérance d'une société, l'étude de leur statut en matière de droits sociaux permet quant à elle de souligner les limites et les paradoxes de l'Etat de droit. Parce que leur caractère " inaliénable et sacré " s'impose avec moins d'évidence, les droits sociaux consacrés par le Préambule de la Constitution de 1946, longtemps considérés comme l'accessoire des droits et libertés dits " classiques ", ont été d'autant moins facilement reconnus au profit des étrangers qu'ils ont des répercussions économiques et financières.
Bon nombre d'entre eux étant, en outre, des " droits-créances ", imposant pour leur mise en oeuvre l'intervention du législateur, la condition des étrangers en la matière est longtemps restée subordonnée aux positions instables des majorités politiques. Aussi, loin d'être spontanée et immédiate, l'affirmation des droits sociaux des étrangers est, à l'image de l'ensemble du droit réservé à cette catégorie de personnes, le produit d'un long processus.
Historiquement contesté, le droit des étrangers aux droits sociaux s'est néanmoins progressivement affirmé. Sous la pression des principes d'égalité et d'interdiction des discriminations reposant sur la nationalité, proclamés au niveau interne comme international, et grâce aux progrès des divers instruments de contrôle, l'accès des étrangers aux droits sociaux du Préambule a été admis. Pour autant, il n'est pas permis de parler d'identité de statut à l'égard des droits sociaux entre étrangers et nationaux.
Résultante de l'immixtion de la politique d'immigration dans le secteur des droits de l'homme, la mise en oeuvre contemporaine des droits sociaux des étrangers apparaît encore largement contestable : la persistance de certaines discriminations reposant sur la nationalité ainsi que les conditions de l'accès de cette catégorie de personnes à ces droits témoignent en effet du caractère minimaliste du régime de droit commun.
Bien que déjà ponctuellement assoupli, ce dernier est encore largement perfectible. Plusieurs évolutions récentes de la législation comme de la jurisprudence interne et internationale affectent les fondements de ces droits comme leur régime et semblent poser les bases d'une évolution favorable de la situation des non-nationaux à l'égard du bénéfice des droits sociaux.
Bon nombre d'entre eux étant, en outre, des " droits-créances ", imposant pour leur mise en oeuvre l'intervention du législateur, la condition des étrangers en la matière est longtemps restée subordonnée aux positions instables des majorités politiques. Aussi, loin d'être spontanée et immédiate, l'affirmation des droits sociaux des étrangers est, à l'image de l'ensemble du droit réservé à cette catégorie de personnes, le produit d'un long processus.
Historiquement contesté, le droit des étrangers aux droits sociaux s'est néanmoins progressivement affirmé. Sous la pression des principes d'égalité et d'interdiction des discriminations reposant sur la nationalité, proclamés au niveau interne comme international, et grâce aux progrès des divers instruments de contrôle, l'accès des étrangers aux droits sociaux du Préambule a été admis. Pour autant, il n'est pas permis de parler d'identité de statut à l'égard des droits sociaux entre étrangers et nationaux.
Résultante de l'immixtion de la politique d'immigration dans le secteur des droits de l'homme, la mise en oeuvre contemporaine des droits sociaux des étrangers apparaît encore largement contestable : la persistance de certaines discriminations reposant sur la nationalité ainsi que les conditions de l'accès de cette catégorie de personnes à ces droits témoignent en effet du caractère minimaliste du régime de droit commun.
Bien que déjà ponctuellement assoupli, ce dernier est encore largement perfectible. Plusieurs évolutions récentes de la législation comme de la jurisprudence interne et internationale affectent les fondements de ces droits comme leur régime et semblent poser les bases d'une évolution favorable de la situation des non-nationaux à l'égard du bénéfice des droits sociaux.
Si l'analyse de la condition des étrangers est en général révélatrice du degré de tolérance d'une société, l'étude de leur statut en matière de droits sociaux permet quant à elle de souligner les limites et les paradoxes de l'Etat de droit. Parce que leur caractère " inaliénable et sacré " s'impose avec moins d'évidence, les droits sociaux consacrés par le Préambule de la Constitution de 1946, longtemps considérés comme l'accessoire des droits et libertés dits " classiques ", ont été d'autant moins facilement reconnus au profit des étrangers qu'ils ont des répercussions économiques et financières.
Bon nombre d'entre eux étant, en outre, des " droits-créances ", imposant pour leur mise en oeuvre l'intervention du législateur, la condition des étrangers en la matière est longtemps restée subordonnée aux positions instables des majorités politiques. Aussi, loin d'être spontanée et immédiate, l'affirmation des droits sociaux des étrangers est, à l'image de l'ensemble du droit réservé à cette catégorie de personnes, le produit d'un long processus.
Historiquement contesté, le droit des étrangers aux droits sociaux s'est néanmoins progressivement affirmé. Sous la pression des principes d'égalité et d'interdiction des discriminations reposant sur la nationalité, proclamés au niveau interne comme international, et grâce aux progrès des divers instruments de contrôle, l'accès des étrangers aux droits sociaux du Préambule a été admis. Pour autant, il n'est pas permis de parler d'identité de statut à l'égard des droits sociaux entre étrangers et nationaux.
Résultante de l'immixtion de la politique d'immigration dans le secteur des droits de l'homme, la mise en oeuvre contemporaine des droits sociaux des étrangers apparaît encore largement contestable : la persistance de certaines discriminations reposant sur la nationalité ainsi que les conditions de l'accès de cette catégorie de personnes à ces droits témoignent en effet du caractère minimaliste du régime de droit commun.
Bien que déjà ponctuellement assoupli, ce dernier est encore largement perfectible. Plusieurs évolutions récentes de la législation comme de la jurisprudence interne et internationale affectent les fondements de ces droits comme leur régime et semblent poser les bases d'une évolution favorable de la situation des non-nationaux à l'égard du bénéfice des droits sociaux.
Bon nombre d'entre eux étant, en outre, des " droits-créances ", imposant pour leur mise en oeuvre l'intervention du législateur, la condition des étrangers en la matière est longtemps restée subordonnée aux positions instables des majorités politiques. Aussi, loin d'être spontanée et immédiate, l'affirmation des droits sociaux des étrangers est, à l'image de l'ensemble du droit réservé à cette catégorie de personnes, le produit d'un long processus.
Historiquement contesté, le droit des étrangers aux droits sociaux s'est néanmoins progressivement affirmé. Sous la pression des principes d'égalité et d'interdiction des discriminations reposant sur la nationalité, proclamés au niveau interne comme international, et grâce aux progrès des divers instruments de contrôle, l'accès des étrangers aux droits sociaux du Préambule a été admis. Pour autant, il n'est pas permis de parler d'identité de statut à l'égard des droits sociaux entre étrangers et nationaux.
Résultante de l'immixtion de la politique d'immigration dans le secteur des droits de l'homme, la mise en oeuvre contemporaine des droits sociaux des étrangers apparaît encore largement contestable : la persistance de certaines discriminations reposant sur la nationalité ainsi que les conditions de l'accès de cette catégorie de personnes à ces droits témoignent en effet du caractère minimaliste du régime de droit commun.
Bien que déjà ponctuellement assoupli, ce dernier est encore largement perfectible. Plusieurs évolutions récentes de la législation comme de la jurisprudence interne et internationale affectent les fondements de ces droits comme leur régime et semblent poser les bases d'une évolution favorable de la situation des non-nationaux à l'égard du bénéfice des droits sociaux.