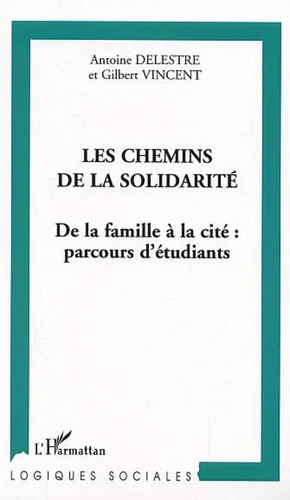Les chemins de la solidarité. De la famille à la cité : parcours d'étudiants
Par : ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages280
- FormatPDF
- ISBN2-296-32239-5
- EAN9782296322394
- Date de parution01/06/2003
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille9 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Une majorité de nos contemporains estiment que la solidarité est une valeur importante : serait-ce le signe qu'on commence à percevoir les effets dissolvants de l'individualisme ? Beaucoup, pourtant, ont l'impression que les relations sociales sont plus âpres, que la compétition tend à l'emporter sur les conduites altruistes : ce genre de constat n'annoncerait-il pas que la résignation menace ? Les nombreuses observations recueillies dans ce volume semblent aller surtout dans le sens de la seconde hypothèse, car, à côté d'une moindre fréquence des engagements altruistes, on discerne, chez la plupart des gens, une tendance nette à réserver à ses proches - famille et compatriotes - les ressources, en temps comme en argent, qu'on est prêt à consacrer à la solidarité.
Les choix et engagements des jeunes, qu'on imagine souvent moins conformistes, plus tentés par l'utopie et désireux d'expériences alternatives, nous obligeraient-ils à nuancer l'impression générale ? La comparaison de données d'enquête recueillies chez les étudiants, sur plusieurs années, confirme largement la tendance générale vers plus d'individualisme. Néanmoins, il existe une minorité de jeunes attachée, en paroles et en actes, aux valeurs d'entraide et de générosité.
On a choisi de prêter attention à cette minorité, d'analyser les facteurs - histoire familiale, exemple parental, engagements religieux, militantisme syndical ou politique etc. - susceptibles d'éclairer la socio-genèse des choix affirmés par chacun en matière de solidarité, au carrefour de l'éthique et de la politique.
Les choix et engagements des jeunes, qu'on imagine souvent moins conformistes, plus tentés par l'utopie et désireux d'expériences alternatives, nous obligeraient-ils à nuancer l'impression générale ? La comparaison de données d'enquête recueillies chez les étudiants, sur plusieurs années, confirme largement la tendance générale vers plus d'individualisme. Néanmoins, il existe une minorité de jeunes attachée, en paroles et en actes, aux valeurs d'entraide et de générosité.
On a choisi de prêter attention à cette minorité, d'analyser les facteurs - histoire familiale, exemple parental, engagements religieux, militantisme syndical ou politique etc. - susceptibles d'éclairer la socio-genèse des choix affirmés par chacun en matière de solidarité, au carrefour de l'éthique et de la politique.
Une majorité de nos contemporains estiment que la solidarité est une valeur importante : serait-ce le signe qu'on commence à percevoir les effets dissolvants de l'individualisme ? Beaucoup, pourtant, ont l'impression que les relations sociales sont plus âpres, que la compétition tend à l'emporter sur les conduites altruistes : ce genre de constat n'annoncerait-il pas que la résignation menace ? Les nombreuses observations recueillies dans ce volume semblent aller surtout dans le sens de la seconde hypothèse, car, à côté d'une moindre fréquence des engagements altruistes, on discerne, chez la plupart des gens, une tendance nette à réserver à ses proches - famille et compatriotes - les ressources, en temps comme en argent, qu'on est prêt à consacrer à la solidarité.
Les choix et engagements des jeunes, qu'on imagine souvent moins conformistes, plus tentés par l'utopie et désireux d'expériences alternatives, nous obligeraient-ils à nuancer l'impression générale ? La comparaison de données d'enquête recueillies chez les étudiants, sur plusieurs années, confirme largement la tendance générale vers plus d'individualisme. Néanmoins, il existe une minorité de jeunes attachée, en paroles et en actes, aux valeurs d'entraide et de générosité.
On a choisi de prêter attention à cette minorité, d'analyser les facteurs - histoire familiale, exemple parental, engagements religieux, militantisme syndical ou politique etc. - susceptibles d'éclairer la socio-genèse des choix affirmés par chacun en matière de solidarité, au carrefour de l'éthique et de la politique.
Les choix et engagements des jeunes, qu'on imagine souvent moins conformistes, plus tentés par l'utopie et désireux d'expériences alternatives, nous obligeraient-ils à nuancer l'impression générale ? La comparaison de données d'enquête recueillies chez les étudiants, sur plusieurs années, confirme largement la tendance générale vers plus d'individualisme. Néanmoins, il existe une minorité de jeunes attachée, en paroles et en actes, aux valeurs d'entraide et de générosité.
On a choisi de prêter attention à cette minorité, d'analyser les facteurs - histoire familiale, exemple parental, engagements religieux, militantisme syndical ou politique etc. - susceptibles d'éclairer la socio-genèse des choix affirmés par chacun en matière de solidarité, au carrefour de l'éthique et de la politique.