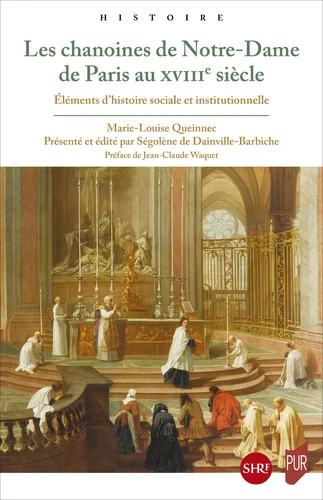Les chanoines de Notre - Dame de Paris au XVIIIe siècle. Eléments d'histoire sociale et institutionnelle
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format Multi-format est :
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages476
- FormatMulti-format
- ISBN979-10-413-0566-7
- EAN9791041305667
- Date de parution03/06/2025
- Protection num.NC
- Infos supplémentairesMulti-format incluant PDF avec W...
- ÉditeurPresses universitaires de Rennes
- Directeur de publicationSégolène de Dainville-Barbiche
- PréfacierJean-Claude Waquet
Résumé
L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, a mis en lumière ses bâtisseurs. Ses administrateurs - les chanoines de Notre-Dame - sont restés dans l'ombre sauf exception. Le minutieux dépouillement de leurs délibérations au xviiie siècle jusqu'à leur suppression en 1790, fait pénétrer dans les détails de leur organisation et de leur quotidien : du chour de la cathédrale où ils chantaient à heures fixes les louanges de Dieu, dans la salle du chapitre au cour du cloître-Notre-Dame, jusqu'à leurs maisons canoniales aux caves parfois bien garnies.
De l'étude des revenus des canonicats, ressortent l'étendue des domaines ruraux du chapitre de Notre-Dame et les richesses qu'il en tirait. Celles-ci n'ont pas servi seulement à entretenir grassement des ecclésiastiques oisifs, cibles de Boileau puis des philosophes, mais à rémunérer des collaborateurs de l'archevêque ou de la monarchie, ainsi qu'à assurer les réparations et l'embellissement de la cathédrale, siège des pompes religieuses officielles.
Cet ouvrage démontre par l'analyse juridique des modalités d'accès aux canonicats que, loin d'avoir été confisqué entièrement par la noblesse, le chapitre de Notre-Dame est resté un espace de brassage entre hommes issus de milieux divers. Ce constat s'appuie sur une prosopographie de 279 notices de dignitaires et de chanoines.
De l'étude des revenus des canonicats, ressortent l'étendue des domaines ruraux du chapitre de Notre-Dame et les richesses qu'il en tirait. Celles-ci n'ont pas servi seulement à entretenir grassement des ecclésiastiques oisifs, cibles de Boileau puis des philosophes, mais à rémunérer des collaborateurs de l'archevêque ou de la monarchie, ainsi qu'à assurer les réparations et l'embellissement de la cathédrale, siège des pompes religieuses officielles.
Cet ouvrage démontre par l'analyse juridique des modalités d'accès aux canonicats que, loin d'avoir été confisqué entièrement par la noblesse, le chapitre de Notre-Dame est resté un espace de brassage entre hommes issus de milieux divers. Ce constat s'appuie sur une prosopographie de 279 notices de dignitaires et de chanoines.
L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, a mis en lumière ses bâtisseurs. Ses administrateurs - les chanoines de Notre-Dame - sont restés dans l'ombre sauf exception. Le minutieux dépouillement de leurs délibérations au xviiie siècle jusqu'à leur suppression en 1790, fait pénétrer dans les détails de leur organisation et de leur quotidien : du chour de la cathédrale où ils chantaient à heures fixes les louanges de Dieu, dans la salle du chapitre au cour du cloître-Notre-Dame, jusqu'à leurs maisons canoniales aux caves parfois bien garnies.
De l'étude des revenus des canonicats, ressortent l'étendue des domaines ruraux du chapitre de Notre-Dame et les richesses qu'il en tirait. Celles-ci n'ont pas servi seulement à entretenir grassement des ecclésiastiques oisifs, cibles de Boileau puis des philosophes, mais à rémunérer des collaborateurs de l'archevêque ou de la monarchie, ainsi qu'à assurer les réparations et l'embellissement de la cathédrale, siège des pompes religieuses officielles.
Cet ouvrage démontre par l'analyse juridique des modalités d'accès aux canonicats que, loin d'avoir été confisqué entièrement par la noblesse, le chapitre de Notre-Dame est resté un espace de brassage entre hommes issus de milieux divers. Ce constat s'appuie sur une prosopographie de 279 notices de dignitaires et de chanoines.
De l'étude des revenus des canonicats, ressortent l'étendue des domaines ruraux du chapitre de Notre-Dame et les richesses qu'il en tirait. Celles-ci n'ont pas servi seulement à entretenir grassement des ecclésiastiques oisifs, cibles de Boileau puis des philosophes, mais à rémunérer des collaborateurs de l'archevêque ou de la monarchie, ainsi qu'à assurer les réparations et l'embellissement de la cathédrale, siège des pompes religieuses officielles.
Cet ouvrage démontre par l'analyse juridique des modalités d'accès aux canonicats que, loin d'avoir été confisqué entièrement par la noblesse, le chapitre de Notre-Dame est resté un espace de brassage entre hommes issus de milieux divers. Ce constat s'appuie sur une prosopographie de 279 notices de dignitaires et de chanoines.