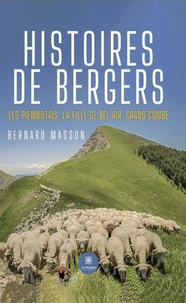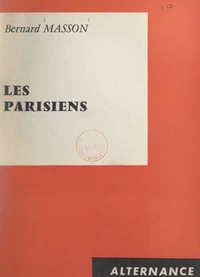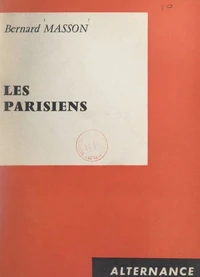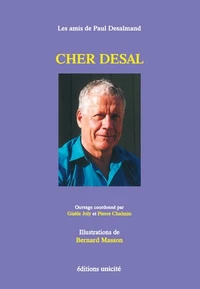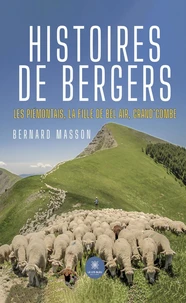Lectures de l'imaginaire
Par : ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages254
- FormatePub
- ISBN2-7059-2894-4
- EAN9782705928940
- Date de parution01/01/1993
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille594 Ko
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurPresses universitaires de France...
Résumé
Le livre rassemble onze études dont quelques-unes, déjà publiées, sont devenues introuvables et d'autres entièrement ou partiellement inédites. Elles portent d'abord sur deux écrivains - Musset et Flaubert - auxquels l'auteur consacre une attention continue et des travaux depuis une trentaine d'années ; et, par contiguïté ou pour le plaisir, sur d'autres écrivains du XIXe siècle. La concentration du titre choisi exprime l'unité d'approche critique qui rassemble ces articles en faisceau et donne à l'ouvrage une tonalité commune.
L'attention du critique est principalement portée sur ce que Mallarmé appelle « ces motifs qui composent une logique, avec nos fibres ». L'imaginaire « lu » dans les textes retenus et commentés emprunte des chemins qui s'apparentent à ce que J.-P. Richard appelle métaphoriquement les « sous-bois », ces « pistes à demi découvertes », ces « en-dessous de l'ouvre » où s'enfouit souvent sa vérité secrète et profonde.
Considérant qu'un commentaire critique est fait pour éclairer le lecteur, non pour le mystifier ou l'égarer, tous ces textes évitent soigneusement deux écueils fréquents de nos jours : la science absconse et le jargon prétentieux. La communication est directe, à deux ou trois termes près, toujours expliqués, et la perspective à la fois didactique et humaniste. Tant il est vrai que parler des livres qu'on aime, c'est d'abord vouloir les faire connaître, reconnaître et, si possible, aimer.
L'attention du critique est principalement portée sur ce que Mallarmé appelle « ces motifs qui composent une logique, avec nos fibres ». L'imaginaire « lu » dans les textes retenus et commentés emprunte des chemins qui s'apparentent à ce que J.-P. Richard appelle métaphoriquement les « sous-bois », ces « pistes à demi découvertes », ces « en-dessous de l'ouvre » où s'enfouit souvent sa vérité secrète et profonde.
Considérant qu'un commentaire critique est fait pour éclairer le lecteur, non pour le mystifier ou l'égarer, tous ces textes évitent soigneusement deux écueils fréquents de nos jours : la science absconse et le jargon prétentieux. La communication est directe, à deux ou trois termes près, toujours expliqués, et la perspective à la fois didactique et humaniste. Tant il est vrai que parler des livres qu'on aime, c'est d'abord vouloir les faire connaître, reconnaître et, si possible, aimer.
Le livre rassemble onze études dont quelques-unes, déjà publiées, sont devenues introuvables et d'autres entièrement ou partiellement inédites. Elles portent d'abord sur deux écrivains - Musset et Flaubert - auxquels l'auteur consacre une attention continue et des travaux depuis une trentaine d'années ; et, par contiguïté ou pour le plaisir, sur d'autres écrivains du XIXe siècle. La concentration du titre choisi exprime l'unité d'approche critique qui rassemble ces articles en faisceau et donne à l'ouvrage une tonalité commune.
L'attention du critique est principalement portée sur ce que Mallarmé appelle « ces motifs qui composent une logique, avec nos fibres ». L'imaginaire « lu » dans les textes retenus et commentés emprunte des chemins qui s'apparentent à ce que J.-P. Richard appelle métaphoriquement les « sous-bois », ces « pistes à demi découvertes », ces « en-dessous de l'ouvre » où s'enfouit souvent sa vérité secrète et profonde.
Considérant qu'un commentaire critique est fait pour éclairer le lecteur, non pour le mystifier ou l'égarer, tous ces textes évitent soigneusement deux écueils fréquents de nos jours : la science absconse et le jargon prétentieux. La communication est directe, à deux ou trois termes près, toujours expliqués, et la perspective à la fois didactique et humaniste. Tant il est vrai que parler des livres qu'on aime, c'est d'abord vouloir les faire connaître, reconnaître et, si possible, aimer.
L'attention du critique est principalement portée sur ce que Mallarmé appelle « ces motifs qui composent une logique, avec nos fibres ». L'imaginaire « lu » dans les textes retenus et commentés emprunte des chemins qui s'apparentent à ce que J.-P. Richard appelle métaphoriquement les « sous-bois », ces « pistes à demi découvertes », ces « en-dessous de l'ouvre » où s'enfouit souvent sa vérité secrète et profonde.
Considérant qu'un commentaire critique est fait pour éclairer le lecteur, non pour le mystifier ou l'égarer, tous ces textes évitent soigneusement deux écueils fréquents de nos jours : la science absconse et le jargon prétentieux. La communication est directe, à deux ou trois termes près, toujours expliqués, et la perspective à la fois didactique et humaniste. Tant il est vrai que parler des livres qu'on aime, c'est d'abord vouloir les faire connaître, reconnaître et, si possible, aimer.