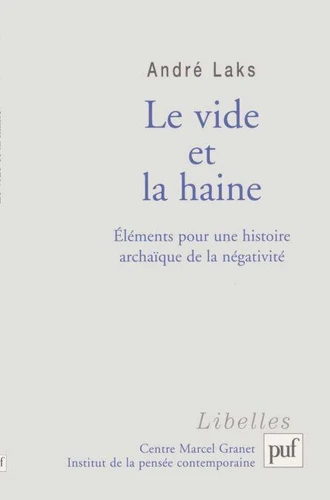Le vide et la haine. Eléments pour une histoire archaïque de la négativité
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages64
- FormatePub
- ISBN2-13-080644-9
- EAN9782130806448
- Date de parution17/03/2004
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille2 Mo
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurPUF
Résumé
Cet essai développe une communication présentée au colloque "Que faisons-nous du négatif ?" organisé en décembre 2002 par l'Institut de la pensée contemporaine - IPC et dirigé par François Jullien. L'auteur avait posé la question de savoir ce qu'eux, les Grecs, en avaient fait et plus précisément, après Parménide, le penseur de l'Être et celui de l'Amour, après Leucippe, le philosophe du vide (et du plein), après Empédocle, celui de la haine (et de l'amour).
Les grecs nous parlent-ils encore de notre négatif ? "On ne peut analyser ce que représentent le vide et la haine, du point de vue d'une histoire du négatif, sans s'arrêter sur Parménide lui-même, non seulement parce que celui-ci livre le fond de positivité dont ces négatifs prennent le contre-pied, mais aussi parce que, en vertu d'un paradoxe qui constitue, comme le dit Ernst Cassirer, "l'une des questions les plus difficiles et les plus obscures, l'une des plus discutées de l'histoire de la philosophie grecque", Parménide fut le premier à se retourner contre lui-même en un geste suicidaire.
Le poème de Parménide est en effet traversé par une dualité fondamentale .... Toute chose dans le monde résulte du mélange de deux entités originelles qui présentent toutes les caractéristiques de ce que la tradition philosophique postérieure appellera les éléments." "C'est justement parce qu'il est que le négatif doit être aboli. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'affirmer avec Platon qu'il ne saurait être pensé ou inversement qu'il peut l'être."
Les grecs nous parlent-ils encore de notre négatif ? "On ne peut analyser ce que représentent le vide et la haine, du point de vue d'une histoire du négatif, sans s'arrêter sur Parménide lui-même, non seulement parce que celui-ci livre le fond de positivité dont ces négatifs prennent le contre-pied, mais aussi parce que, en vertu d'un paradoxe qui constitue, comme le dit Ernst Cassirer, "l'une des questions les plus difficiles et les plus obscures, l'une des plus discutées de l'histoire de la philosophie grecque", Parménide fut le premier à se retourner contre lui-même en un geste suicidaire.
Le poème de Parménide est en effet traversé par une dualité fondamentale .... Toute chose dans le monde résulte du mélange de deux entités originelles qui présentent toutes les caractéristiques de ce que la tradition philosophique postérieure appellera les éléments." "C'est justement parce qu'il est que le négatif doit être aboli. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'affirmer avec Platon qu'il ne saurait être pensé ou inversement qu'il peut l'être."
Cet essai développe une communication présentée au colloque "Que faisons-nous du négatif ?" organisé en décembre 2002 par l'Institut de la pensée contemporaine - IPC et dirigé par François Jullien. L'auteur avait posé la question de savoir ce qu'eux, les Grecs, en avaient fait et plus précisément, après Parménide, le penseur de l'Être et celui de l'Amour, après Leucippe, le philosophe du vide (et du plein), après Empédocle, celui de la haine (et de l'amour).
Les grecs nous parlent-ils encore de notre négatif ? "On ne peut analyser ce que représentent le vide et la haine, du point de vue d'une histoire du négatif, sans s'arrêter sur Parménide lui-même, non seulement parce que celui-ci livre le fond de positivité dont ces négatifs prennent le contre-pied, mais aussi parce que, en vertu d'un paradoxe qui constitue, comme le dit Ernst Cassirer, "l'une des questions les plus difficiles et les plus obscures, l'une des plus discutées de l'histoire de la philosophie grecque", Parménide fut le premier à se retourner contre lui-même en un geste suicidaire.
Le poème de Parménide est en effet traversé par une dualité fondamentale .... Toute chose dans le monde résulte du mélange de deux entités originelles qui présentent toutes les caractéristiques de ce que la tradition philosophique postérieure appellera les éléments." "C'est justement parce qu'il est que le négatif doit être aboli. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'affirmer avec Platon qu'il ne saurait être pensé ou inversement qu'il peut l'être."
Les grecs nous parlent-ils encore de notre négatif ? "On ne peut analyser ce que représentent le vide et la haine, du point de vue d'une histoire du négatif, sans s'arrêter sur Parménide lui-même, non seulement parce que celui-ci livre le fond de positivité dont ces négatifs prennent le contre-pied, mais aussi parce que, en vertu d'un paradoxe qui constitue, comme le dit Ernst Cassirer, "l'une des questions les plus difficiles et les plus obscures, l'une des plus discutées de l'histoire de la philosophie grecque", Parménide fut le premier à se retourner contre lui-même en un geste suicidaire.
Le poème de Parménide est en effet traversé par une dualité fondamentale .... Toute chose dans le monde résulte du mélange de deux entités originelles qui présentent toutes les caractéristiques de ce que la tradition philosophique postérieure appellera les éléments." "C'est justement parce qu'il est que le négatif doit être aboli. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'affirmer avec Platon qu'il ne saurait être pensé ou inversement qu'il peut l'être."