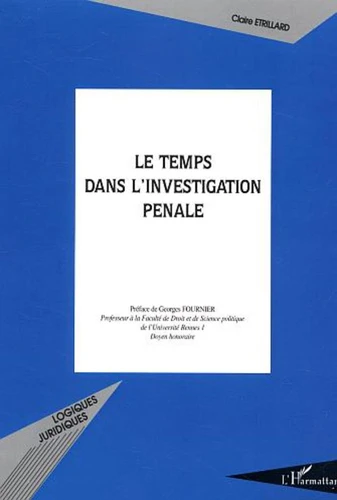Le temps dans l'investigation pénale
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages392
- FormatPDF
- ISBN2-296-38580-X
- EAN9782296385801
- Date de parution01/01/2005
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille18 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
- PréfacierGeorges Fournier
Résumé
Cet ouvrage souligne le rôle ambivalent que le temps joue au cours de l'investigation pénale, c'est-à-dire au cours de la recherche effectuée par les agents institutionnels pour établir la réalité d'une infraction et pour en déterminer l'auteur. De prime abord, le temps conditionne l'efficacité de l'investigation pénale. L'existence même de l'investigation pénale implique que soient pris en considération par les agents institutionnels, non seulement le temps écoulé à cause de la prescriptibilité des infractions, mais aussi le temps à venir, car celui-ci les amène à opérer des choix, voire à renoncer dans maintes hypothèses à effectuer des investigations (simple inscription sur le registre de main courante, absence d'instruction préparatoire...).
La progression de l'investigation pénale dépend également du temps. Les actes d'investigation doivent être établis suffisamment rapidement, mais ils doivent aussi être maintenus dans le temps en cas de critique de la part des parties. Leur annulation doit demeurer exceptionnelle. D'un autre point de vues le temps apparaît comme l'instrument privilégié de la protection des droits de l'individu. Il protège les libertés individuelles en ce qu'il modère les mesures privatives de liberté (durée de la garde à vue, de la détention, provisoire...) et les mesures attentatoires à la vie privée (moment des perquisitions, durée des interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications...) qui sont prises au cours de l'investigation pénale.
Le temps sert également les droits de la défense. Le droit d'être informé "dans le plus court délai" et le droit à disposer "du temps nécessaire à la préparation de sa défense", prévus notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sont en effet garantis au cours de l'investigation pénale. La prise en compte quotidienne du temps qui s'écoule par les agents d'investigation, de même que le choix politique délicat des multiples délais de procédure qui rythment la marche de l'investigation, témoignent de la difficulté à trouver un équilibre satisfaisant entre des finalités diverses et souvent contraires.
La progression de l'investigation pénale dépend également du temps. Les actes d'investigation doivent être établis suffisamment rapidement, mais ils doivent aussi être maintenus dans le temps en cas de critique de la part des parties. Leur annulation doit demeurer exceptionnelle. D'un autre point de vues le temps apparaît comme l'instrument privilégié de la protection des droits de l'individu. Il protège les libertés individuelles en ce qu'il modère les mesures privatives de liberté (durée de la garde à vue, de la détention, provisoire...) et les mesures attentatoires à la vie privée (moment des perquisitions, durée des interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications...) qui sont prises au cours de l'investigation pénale.
Le temps sert également les droits de la défense. Le droit d'être informé "dans le plus court délai" et le droit à disposer "du temps nécessaire à la préparation de sa défense", prévus notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sont en effet garantis au cours de l'investigation pénale. La prise en compte quotidienne du temps qui s'écoule par les agents d'investigation, de même que le choix politique délicat des multiples délais de procédure qui rythment la marche de l'investigation, témoignent de la difficulté à trouver un équilibre satisfaisant entre des finalités diverses et souvent contraires.
Cet ouvrage souligne le rôle ambivalent que le temps joue au cours de l'investigation pénale, c'est-à-dire au cours de la recherche effectuée par les agents institutionnels pour établir la réalité d'une infraction et pour en déterminer l'auteur. De prime abord, le temps conditionne l'efficacité de l'investigation pénale. L'existence même de l'investigation pénale implique que soient pris en considération par les agents institutionnels, non seulement le temps écoulé à cause de la prescriptibilité des infractions, mais aussi le temps à venir, car celui-ci les amène à opérer des choix, voire à renoncer dans maintes hypothèses à effectuer des investigations (simple inscription sur le registre de main courante, absence d'instruction préparatoire...).
La progression de l'investigation pénale dépend également du temps. Les actes d'investigation doivent être établis suffisamment rapidement, mais ils doivent aussi être maintenus dans le temps en cas de critique de la part des parties. Leur annulation doit demeurer exceptionnelle. D'un autre point de vues le temps apparaît comme l'instrument privilégié de la protection des droits de l'individu. Il protège les libertés individuelles en ce qu'il modère les mesures privatives de liberté (durée de la garde à vue, de la détention, provisoire...) et les mesures attentatoires à la vie privée (moment des perquisitions, durée des interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications...) qui sont prises au cours de l'investigation pénale.
Le temps sert également les droits de la défense. Le droit d'être informé "dans le plus court délai" et le droit à disposer "du temps nécessaire à la préparation de sa défense", prévus notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sont en effet garantis au cours de l'investigation pénale. La prise en compte quotidienne du temps qui s'écoule par les agents d'investigation, de même que le choix politique délicat des multiples délais de procédure qui rythment la marche de l'investigation, témoignent de la difficulté à trouver un équilibre satisfaisant entre des finalités diverses et souvent contraires.
La progression de l'investigation pénale dépend également du temps. Les actes d'investigation doivent être établis suffisamment rapidement, mais ils doivent aussi être maintenus dans le temps en cas de critique de la part des parties. Leur annulation doit demeurer exceptionnelle. D'un autre point de vues le temps apparaît comme l'instrument privilégié de la protection des droits de l'individu. Il protège les libertés individuelles en ce qu'il modère les mesures privatives de liberté (durée de la garde à vue, de la détention, provisoire...) et les mesures attentatoires à la vie privée (moment des perquisitions, durée des interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications...) qui sont prises au cours de l'investigation pénale.
Le temps sert également les droits de la défense. Le droit d'être informé "dans le plus court délai" et le droit à disposer "du temps nécessaire à la préparation de sa défense", prévus notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sont en effet garantis au cours de l'investigation pénale. La prise en compte quotidienne du temps qui s'écoule par les agents d'investigation, de même que le choix politique délicat des multiples délais de procédure qui rythment la marche de l'investigation, témoignent de la difficulté à trouver un équilibre satisfaisant entre des finalités diverses et souvent contraires.