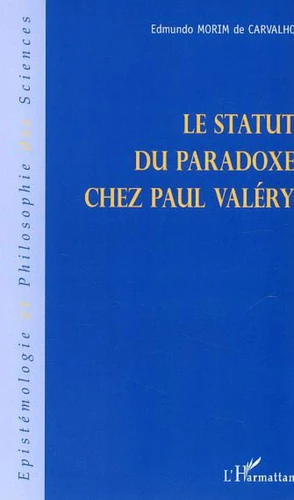Le statut du paradoxe chez Paul Valéry
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages298
- FormatPDF
- ISBN2-296-38942-2
- EAN9782296389427
- Date de parution01/02/2005
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille11 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Le paradoxe traverse des domaines tels que science, religion, théologie, philosophie, métaphysique, langage, poésie, rêve, société ou prise en compte des " autres " par le " moi-zéro ", comme un art de défaire les oppositions, en les désamorçant - point de fuite des contradictions -, en leur enlevant leur aspect tragique. On trouve chez Valéry à la fois une critique pertinente de l'enjeu paradoxal, autour de la figure de Zénon, dans un remarquable travail d'analyse, et un " retour " au paradoxe dans une ambivalence créée et exploitée par le langage.
Nous y voyons l'émergence de quelques " mythes " fondateurs de la modernité, et déjà leur " destruction ". De la haine à l'amour du paradoxe, Valéry ne cesse de cacher la douleur, et de l'avouer. Le paradoxe est avant toute chose une pratique de l'écriture, voulant cerner les impasses existentielles, langagières, politiques, idéologiques, et les reconduisant malgré elle. Le paradoxe est l'art de danser au bord de l'abîme : jeu de mots contre la douleur, ou la douleur comme jeu de mots.
Nous y voyons l'émergence de quelques " mythes " fondateurs de la modernité, et déjà leur " destruction ". De la haine à l'amour du paradoxe, Valéry ne cesse de cacher la douleur, et de l'avouer. Le paradoxe est avant toute chose une pratique de l'écriture, voulant cerner les impasses existentielles, langagières, politiques, idéologiques, et les reconduisant malgré elle. Le paradoxe est l'art de danser au bord de l'abîme : jeu de mots contre la douleur, ou la douleur comme jeu de mots.
Le paradoxe traverse des domaines tels que science, religion, théologie, philosophie, métaphysique, langage, poésie, rêve, société ou prise en compte des " autres " par le " moi-zéro ", comme un art de défaire les oppositions, en les désamorçant - point de fuite des contradictions -, en leur enlevant leur aspect tragique. On trouve chez Valéry à la fois une critique pertinente de l'enjeu paradoxal, autour de la figure de Zénon, dans un remarquable travail d'analyse, et un " retour " au paradoxe dans une ambivalence créée et exploitée par le langage.
Nous y voyons l'émergence de quelques " mythes " fondateurs de la modernité, et déjà leur " destruction ". De la haine à l'amour du paradoxe, Valéry ne cesse de cacher la douleur, et de l'avouer. Le paradoxe est avant toute chose une pratique de l'écriture, voulant cerner les impasses existentielles, langagières, politiques, idéologiques, et les reconduisant malgré elle. Le paradoxe est l'art de danser au bord de l'abîme : jeu de mots contre la douleur, ou la douleur comme jeu de mots.
Nous y voyons l'émergence de quelques " mythes " fondateurs de la modernité, et déjà leur " destruction ". De la haine à l'amour du paradoxe, Valéry ne cesse de cacher la douleur, et de l'avouer. Le paradoxe est avant toute chose une pratique de l'écriture, voulant cerner les impasses existentielles, langagières, politiques, idéologiques, et les reconduisant malgré elle. Le paradoxe est l'art de danser au bord de l'abîme : jeu de mots contre la douleur, ou la douleur comme jeu de mots.