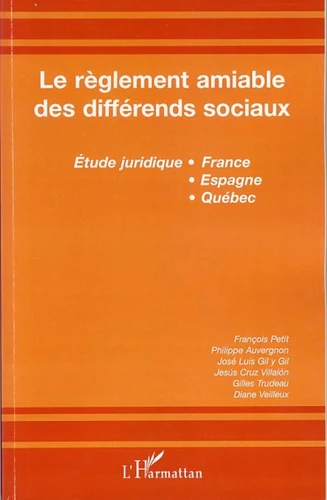Le règlement à l'amiable des différends sociaux
Par : , , ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages272
- FormatPDF
- ISBN978-2-296-17497-9
- EAN9782296174979
- Date de parution01/06/2007
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille10 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Les rapports sociaux sont l'occasion de conflits et de litiges entre les salariés et leurs employeurs. Entre autres solutions, la recherche d'un accord est souvent décrite comme une méthode plus rapide que le procès, plus adaptée que le rapport de forces. Pourtant, les textes édictés par le législateur français en faveur du règlement amiable sont comme impropres à leur usage. Les possibilités de résolution négociée des conflits collectifs, figurant dans le code du travail, sont très rarement mises en œuvre.
Des systèmes de médiation visant le harcèlement au travail et les licenciements économiques ont été retirés peu après leur institution. Le règlement amiable des différends sociaux se pratique donc sans cadre juridique d'ensemble. On peut se demander s'il est prudent de laisser les choses en l'état. Les contraintes sont fortes, puisqu'elles relèvent de paradoxes : pourquoi conduire les intéressés à la table des négociations, si tout les oppose ? Comment les inciter à se rapprocher sans attenter à leur liberté ? Les pouvoirs publics peuvent-ils légitimement offrir un autre recours que le juge, dont le rôle est d'appliquer la loi sans concession ? Il existe pourtant, aussi bien en Espagne qu'au Québec, des systèmes opérationnels de médiation et de conciliation.
Etudier leur fonctionnement permet de savoir sur quels équilibres ils reposent. Les auteurs se sont attachés, à travers l'étude des expériences française, espagnole et québécoise, à échanger leurs analyses, sur la base d'une problématique commune.
Des systèmes de médiation visant le harcèlement au travail et les licenciements économiques ont été retirés peu après leur institution. Le règlement amiable des différends sociaux se pratique donc sans cadre juridique d'ensemble. On peut se demander s'il est prudent de laisser les choses en l'état. Les contraintes sont fortes, puisqu'elles relèvent de paradoxes : pourquoi conduire les intéressés à la table des négociations, si tout les oppose ? Comment les inciter à se rapprocher sans attenter à leur liberté ? Les pouvoirs publics peuvent-ils légitimement offrir un autre recours que le juge, dont le rôle est d'appliquer la loi sans concession ? Il existe pourtant, aussi bien en Espagne qu'au Québec, des systèmes opérationnels de médiation et de conciliation.
Etudier leur fonctionnement permet de savoir sur quels équilibres ils reposent. Les auteurs se sont attachés, à travers l'étude des expériences française, espagnole et québécoise, à échanger leurs analyses, sur la base d'une problématique commune.
Les rapports sociaux sont l'occasion de conflits et de litiges entre les salariés et leurs employeurs. Entre autres solutions, la recherche d'un accord est souvent décrite comme une méthode plus rapide que le procès, plus adaptée que le rapport de forces. Pourtant, les textes édictés par le législateur français en faveur du règlement amiable sont comme impropres à leur usage. Les possibilités de résolution négociée des conflits collectifs, figurant dans le code du travail, sont très rarement mises en œuvre.
Des systèmes de médiation visant le harcèlement au travail et les licenciements économiques ont été retirés peu après leur institution. Le règlement amiable des différends sociaux se pratique donc sans cadre juridique d'ensemble. On peut se demander s'il est prudent de laisser les choses en l'état. Les contraintes sont fortes, puisqu'elles relèvent de paradoxes : pourquoi conduire les intéressés à la table des négociations, si tout les oppose ? Comment les inciter à se rapprocher sans attenter à leur liberté ? Les pouvoirs publics peuvent-ils légitimement offrir un autre recours que le juge, dont le rôle est d'appliquer la loi sans concession ? Il existe pourtant, aussi bien en Espagne qu'au Québec, des systèmes opérationnels de médiation et de conciliation.
Etudier leur fonctionnement permet de savoir sur quels équilibres ils reposent. Les auteurs se sont attachés, à travers l'étude des expériences française, espagnole et québécoise, à échanger leurs analyses, sur la base d'une problématique commune.
Des systèmes de médiation visant le harcèlement au travail et les licenciements économiques ont été retirés peu après leur institution. Le règlement amiable des différends sociaux se pratique donc sans cadre juridique d'ensemble. On peut se demander s'il est prudent de laisser les choses en l'état. Les contraintes sont fortes, puisqu'elles relèvent de paradoxes : pourquoi conduire les intéressés à la table des négociations, si tout les oppose ? Comment les inciter à se rapprocher sans attenter à leur liberté ? Les pouvoirs publics peuvent-ils légitimement offrir un autre recours que le juge, dont le rôle est d'appliquer la loi sans concession ? Il existe pourtant, aussi bien en Espagne qu'au Québec, des systèmes opérationnels de médiation et de conciliation.
Etudier leur fonctionnement permet de savoir sur quels équilibres ils reposent. Les auteurs se sont attachés, à travers l'étude des expériences française, espagnole et québécoise, à échanger leurs analyses, sur la base d'une problématique commune.