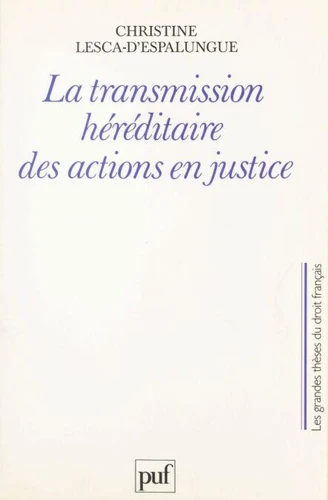La transmission héréditaire des actions en justice
Par : , ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages338
- FormatPDF
- ISBN2-7059-6091-0
- EAN9782705960919
- Date de parution01/01/1992
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille83 Mo
- Infos supplémentairespdf
- ÉditeurPresses universitaires de France...
Résumé
À l'ouverture de la succession d'un parent proche, d'un client., se pose fréquemment - pour les héritiers, l'avocat ou le notaire - le problème du règlement de procès déjà introduits au moment du décès, et celui de procès latents, qui ne sont pas encore engagés, mais simplement virtuels.
En effet, le de cujus a pu, de son vivant, déclencher un litige contre un débiteur négligent, l'auteur d'un dommage., ou être lui-même assigné en justice, et décéder avant le prononcé d'un jugement, laissant ainsi des procès en cours.
Titulaire d'un droit non réalisé de son vivant, ou redevable d'une dette restée impayée, le défunt laisse - en ce cas - d'éventuels procès à venir. Il s'agira alors, pour les héritiers, soit de continuer l'instance comme demandeurs ou défendeurs, soit de l'introduire ou d'y défendre. La continuation - ou l'exercice post mortem - de ces procès dépend de la réponse à une question essentielle : l'action en justice permettant de réaliser le droit - ou de contester la dette du de cujus - est-elle transmissible aux héritiers ? Quels sont les critères de la transmissibilité - active et passive - d'une action en justice ? Par ailleurs, à quelles conditions de procédure les héritiers peuvent-ils exercer une action héréditaire, c'est-à-dire une action transmise à cause de mort ? L'absence, en droit positif, de système ordonnant les multiples rapports du droit civil et du droit judiciaire en la matière, a suggéré des recherches.
Celles-ci ont conduit à la mise en évidence d'un « droit des procès introduits ou continués par ou contre des héritiers », qui peut être qualifié de droit judiciaire successoral ; et, sur ce chemin, à une nouvelle réflexion sur la théorie générale de l'action en justice. La collection « Les grandes thèses du droit français » répond à un constat : nos facultés de droit sont à l'origine de nombreuses thèses, d'un grand intérêt scientifique, mais malheureusement trop peu sont publiées.
Nous voulons permettre, aux meilleures thèses soutenues dans les disciplines juridiques, d'être connues non seulement des universitaires, mais aussi des praticiens, et ce en France comme à l'étranger. Nous savons que la science juridique française mérite cet effort de promotion. Sans donner un caractère d'exclusivité à cette dimension, nous avons le souci d'inscrire cette collection dans le champ des transformations du droit à l'époque contemporaine, dont le droit communautaire constitue une donnée particulièrement importante.
Titulaire d'un droit non réalisé de son vivant, ou redevable d'une dette restée impayée, le défunt laisse - en ce cas - d'éventuels procès à venir. Il s'agira alors, pour les héritiers, soit de continuer l'instance comme demandeurs ou défendeurs, soit de l'introduire ou d'y défendre. La continuation - ou l'exercice post mortem - de ces procès dépend de la réponse à une question essentielle : l'action en justice permettant de réaliser le droit - ou de contester la dette du de cujus - est-elle transmissible aux héritiers ? Quels sont les critères de la transmissibilité - active et passive - d'une action en justice ? Par ailleurs, à quelles conditions de procédure les héritiers peuvent-ils exercer une action héréditaire, c'est-à-dire une action transmise à cause de mort ? L'absence, en droit positif, de système ordonnant les multiples rapports du droit civil et du droit judiciaire en la matière, a suggéré des recherches.
Celles-ci ont conduit à la mise en évidence d'un « droit des procès introduits ou continués par ou contre des héritiers », qui peut être qualifié de droit judiciaire successoral ; et, sur ce chemin, à une nouvelle réflexion sur la théorie générale de l'action en justice. La collection « Les grandes thèses du droit français » répond à un constat : nos facultés de droit sont à l'origine de nombreuses thèses, d'un grand intérêt scientifique, mais malheureusement trop peu sont publiées.
Nous voulons permettre, aux meilleures thèses soutenues dans les disciplines juridiques, d'être connues non seulement des universitaires, mais aussi des praticiens, et ce en France comme à l'étranger. Nous savons que la science juridique française mérite cet effort de promotion. Sans donner un caractère d'exclusivité à cette dimension, nous avons le souci d'inscrire cette collection dans le champ des transformations du droit à l'époque contemporaine, dont le droit communautaire constitue une donnée particulièrement importante.
À l'ouverture de la succession d'un parent proche, d'un client., se pose fréquemment - pour les héritiers, l'avocat ou le notaire - le problème du règlement de procès déjà introduits au moment du décès, et celui de procès latents, qui ne sont pas encore engagés, mais simplement virtuels.
En effet, le de cujus a pu, de son vivant, déclencher un litige contre un débiteur négligent, l'auteur d'un dommage., ou être lui-même assigné en justice, et décéder avant le prononcé d'un jugement, laissant ainsi des procès en cours.
Titulaire d'un droit non réalisé de son vivant, ou redevable d'une dette restée impayée, le défunt laisse - en ce cas - d'éventuels procès à venir. Il s'agira alors, pour les héritiers, soit de continuer l'instance comme demandeurs ou défendeurs, soit de l'introduire ou d'y défendre. La continuation - ou l'exercice post mortem - de ces procès dépend de la réponse à une question essentielle : l'action en justice permettant de réaliser le droit - ou de contester la dette du de cujus - est-elle transmissible aux héritiers ? Quels sont les critères de la transmissibilité - active et passive - d'une action en justice ? Par ailleurs, à quelles conditions de procédure les héritiers peuvent-ils exercer une action héréditaire, c'est-à-dire une action transmise à cause de mort ? L'absence, en droit positif, de système ordonnant les multiples rapports du droit civil et du droit judiciaire en la matière, a suggéré des recherches.
Celles-ci ont conduit à la mise en évidence d'un « droit des procès introduits ou continués par ou contre des héritiers », qui peut être qualifié de droit judiciaire successoral ; et, sur ce chemin, à une nouvelle réflexion sur la théorie générale de l'action en justice. La collection « Les grandes thèses du droit français » répond à un constat : nos facultés de droit sont à l'origine de nombreuses thèses, d'un grand intérêt scientifique, mais malheureusement trop peu sont publiées.
Nous voulons permettre, aux meilleures thèses soutenues dans les disciplines juridiques, d'être connues non seulement des universitaires, mais aussi des praticiens, et ce en France comme à l'étranger. Nous savons que la science juridique française mérite cet effort de promotion. Sans donner un caractère d'exclusivité à cette dimension, nous avons le souci d'inscrire cette collection dans le champ des transformations du droit à l'époque contemporaine, dont le droit communautaire constitue une donnée particulièrement importante.
Titulaire d'un droit non réalisé de son vivant, ou redevable d'une dette restée impayée, le défunt laisse - en ce cas - d'éventuels procès à venir. Il s'agira alors, pour les héritiers, soit de continuer l'instance comme demandeurs ou défendeurs, soit de l'introduire ou d'y défendre. La continuation - ou l'exercice post mortem - de ces procès dépend de la réponse à une question essentielle : l'action en justice permettant de réaliser le droit - ou de contester la dette du de cujus - est-elle transmissible aux héritiers ? Quels sont les critères de la transmissibilité - active et passive - d'une action en justice ? Par ailleurs, à quelles conditions de procédure les héritiers peuvent-ils exercer une action héréditaire, c'est-à-dire une action transmise à cause de mort ? L'absence, en droit positif, de système ordonnant les multiples rapports du droit civil et du droit judiciaire en la matière, a suggéré des recherches.
Celles-ci ont conduit à la mise en évidence d'un « droit des procès introduits ou continués par ou contre des héritiers », qui peut être qualifié de droit judiciaire successoral ; et, sur ce chemin, à une nouvelle réflexion sur la théorie générale de l'action en justice. La collection « Les grandes thèses du droit français » répond à un constat : nos facultés de droit sont à l'origine de nombreuses thèses, d'un grand intérêt scientifique, mais malheureusement trop peu sont publiées.
Nous voulons permettre, aux meilleures thèses soutenues dans les disciplines juridiques, d'être connues non seulement des universitaires, mais aussi des praticiens, et ce en France comme à l'étranger. Nous savons que la science juridique française mérite cet effort de promotion. Sans donner un caractère d'exclusivité à cette dimension, nous avons le souci d'inscrire cette collection dans le champ des transformations du droit à l'époque contemporaine, dont le droit communautaire constitue une donnée particulièrement importante.