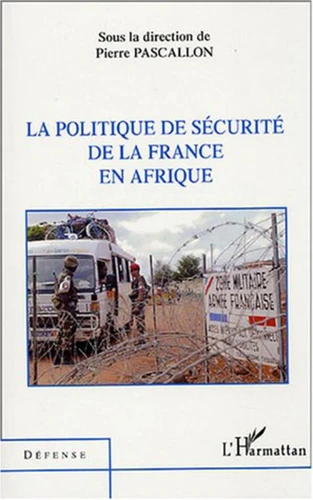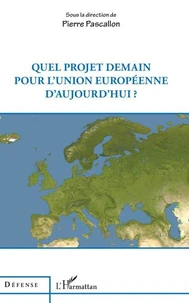La politique de la sécurité de la France en Afrique
Par : ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages474
- FormatPDF
- ISBN2-296-35691-5
- EAN9782296356917
- Date de parution01/04/2004
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille12 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
La politique de sécurité de la France en Afrique s'inscrit dans la longue durée. Il conviendrait de s'attacher d'abord à la période coloniale qui est, bien sûr, le temps de l'apogée de la présence militaire française sur le continent africain. Mais les indépendances africaines ne marquent pas le retrait militaire complet français. En effet, au lendemain des indépendances, la France va s'impliquer fortement dans la sécurité du continent africain, avec de nombreuses interventions armées pour protéger, voire rétablir, des pouvoirs menacés dans son " pré carré " sub-saharien.
Il nous faut donc rappeler d'abord cette période " d'activisme militaire " du " gendarme français " en Afrique après les indépendances ; puis s'attacher à préciser le " désengagement " militaire français qui a suivi ; et enfin marquer le " réengagement " militaire français actuel en Afrique. Telle fut la chronologie des débats qui ont animé le colloque sur ce thème, organisé par le Professeur Pierre Pascallon, le 7 juillet 2003, et qui a réuni les meilleurs experts français et étrangers à l'Assemblée Nationale à Paris.
Il nous faut donc rappeler d'abord cette période " d'activisme militaire " du " gendarme français " en Afrique après les indépendances ; puis s'attacher à préciser le " désengagement " militaire français qui a suivi ; et enfin marquer le " réengagement " militaire français actuel en Afrique. Telle fut la chronologie des débats qui ont animé le colloque sur ce thème, organisé par le Professeur Pierre Pascallon, le 7 juillet 2003, et qui a réuni les meilleurs experts français et étrangers à l'Assemblée Nationale à Paris.
La politique de sécurité de la France en Afrique s'inscrit dans la longue durée. Il conviendrait de s'attacher d'abord à la période coloniale qui est, bien sûr, le temps de l'apogée de la présence militaire française sur le continent africain. Mais les indépendances africaines ne marquent pas le retrait militaire complet français. En effet, au lendemain des indépendances, la France va s'impliquer fortement dans la sécurité du continent africain, avec de nombreuses interventions armées pour protéger, voire rétablir, des pouvoirs menacés dans son " pré carré " sub-saharien.
Il nous faut donc rappeler d'abord cette période " d'activisme militaire " du " gendarme français " en Afrique après les indépendances ; puis s'attacher à préciser le " désengagement " militaire français qui a suivi ; et enfin marquer le " réengagement " militaire français actuel en Afrique. Telle fut la chronologie des débats qui ont animé le colloque sur ce thème, organisé par le Professeur Pierre Pascallon, le 7 juillet 2003, et qui a réuni les meilleurs experts français et étrangers à l'Assemblée Nationale à Paris.
Il nous faut donc rappeler d'abord cette période " d'activisme militaire " du " gendarme français " en Afrique après les indépendances ; puis s'attacher à préciser le " désengagement " militaire français qui a suivi ; et enfin marquer le " réengagement " militaire français actuel en Afrique. Telle fut la chronologie des débats qui ont animé le colloque sur ce thème, organisé par le Professeur Pierre Pascallon, le 7 juillet 2003, et qui a réuni les meilleurs experts français et étrangers à l'Assemblée Nationale à Paris.