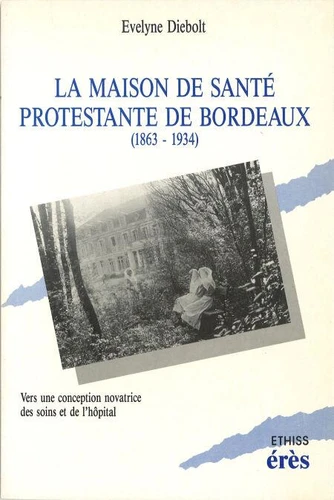La Maison de santé protestante de Bordeaux. 1863-1934, vers une conception novatrice des soins et de l'hôpital
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages192
- FormatePub
- ISBN978-2-7492-5912-3
- EAN9782749259123
- Date de parution24/10/2018
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille9 Mo
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurEres
Résumé
Quelle fonction pour l'hôpital ? Quelle qualification et quelle reconnaissance sociale pour son personnel ? Quel accueil pour le malade? Quelle gestion pour quel type d'hôpital ?
Ces interrogations, d'une brûlante actualité, ont fait l'objet, à la fin du siècle dernier, de débats passionnés auxquels la Maison de santé protestante de Bordeaux prit une part active. En effet, dans une période de mutation hospitalière, cette prestigieuse ouvre sociale proposait une structure originale et singulière qui eût un rôle déterminant dans l'évolution de l'action sanitaire et sociale française.
Anna Hamilton (1864-1935), jeune femme protestante, mène en 1898 pour sa thèse de médecine une enquête à l"échelle européenne sur la formation et la fonction du personnel infirmier des hôpitaux.
En 1900, directrice de la Maison de santé protestante, elle décide d'en faire un lieu de formation modèle, un hôpital-école d'où émerge un nouveau corps professionnel, les garde-malades "hospitalières" ou "visiteuses". Ses élèves essaiment dans toute la France. Elles prennent la direction d'hôpitaux municipaux, certaines sont à la tête des premiers services sociaux, d'autres encore forment des ouvres analogues. La notoriété, dans le monde anglo-saxon, de la Maison de santé protestante de Bordeaux, n'a d'égal que sa méconnaissance en France.
Pourtant, les professions sanitaires et sociales françaises trouvent dans cette oeuvre une de leurs racines les plus vigoureuses. Cette monographie menée avec une grande rigueur méthodologique s'inscrit dans un questionnement du secteur sanitaire et social et contribue ainsi à créer un champ transversal d'investigation historique.
En 1900, directrice de la Maison de santé protestante, elle décide d'en faire un lieu de formation modèle, un hôpital-école d'où émerge un nouveau corps professionnel, les garde-malades "hospitalières" ou "visiteuses". Ses élèves essaiment dans toute la France. Elles prennent la direction d'hôpitaux municipaux, certaines sont à la tête des premiers services sociaux, d'autres encore forment des ouvres analogues. La notoriété, dans le monde anglo-saxon, de la Maison de santé protestante de Bordeaux, n'a d'égal que sa méconnaissance en France.
Pourtant, les professions sanitaires et sociales françaises trouvent dans cette oeuvre une de leurs racines les plus vigoureuses. Cette monographie menée avec une grande rigueur méthodologique s'inscrit dans un questionnement du secteur sanitaire et social et contribue ainsi à créer un champ transversal d'investigation historique.
Quelle fonction pour l'hôpital ? Quelle qualification et quelle reconnaissance sociale pour son personnel ? Quel accueil pour le malade? Quelle gestion pour quel type d'hôpital ?
Ces interrogations, d'une brûlante actualité, ont fait l'objet, à la fin du siècle dernier, de débats passionnés auxquels la Maison de santé protestante de Bordeaux prit une part active. En effet, dans une période de mutation hospitalière, cette prestigieuse ouvre sociale proposait une structure originale et singulière qui eût un rôle déterminant dans l'évolution de l'action sanitaire et sociale française.
Anna Hamilton (1864-1935), jeune femme protestante, mène en 1898 pour sa thèse de médecine une enquête à l"échelle européenne sur la formation et la fonction du personnel infirmier des hôpitaux.
En 1900, directrice de la Maison de santé protestante, elle décide d'en faire un lieu de formation modèle, un hôpital-école d'où émerge un nouveau corps professionnel, les garde-malades "hospitalières" ou "visiteuses". Ses élèves essaiment dans toute la France. Elles prennent la direction d'hôpitaux municipaux, certaines sont à la tête des premiers services sociaux, d'autres encore forment des ouvres analogues. La notoriété, dans le monde anglo-saxon, de la Maison de santé protestante de Bordeaux, n'a d'égal que sa méconnaissance en France.
Pourtant, les professions sanitaires et sociales françaises trouvent dans cette oeuvre une de leurs racines les plus vigoureuses. Cette monographie menée avec une grande rigueur méthodologique s'inscrit dans un questionnement du secteur sanitaire et social et contribue ainsi à créer un champ transversal d'investigation historique.
En 1900, directrice de la Maison de santé protestante, elle décide d'en faire un lieu de formation modèle, un hôpital-école d'où émerge un nouveau corps professionnel, les garde-malades "hospitalières" ou "visiteuses". Ses élèves essaiment dans toute la France. Elles prennent la direction d'hôpitaux municipaux, certaines sont à la tête des premiers services sociaux, d'autres encore forment des ouvres analogues. La notoriété, dans le monde anglo-saxon, de la Maison de santé protestante de Bordeaux, n'a d'égal que sa méconnaissance en France.
Pourtant, les professions sanitaires et sociales françaises trouvent dans cette oeuvre une de leurs racines les plus vigoureuses. Cette monographie menée avec une grande rigueur méthodologique s'inscrit dans un questionnement du secteur sanitaire et social et contribue ainsi à créer un champ transversal d'investigation historique.