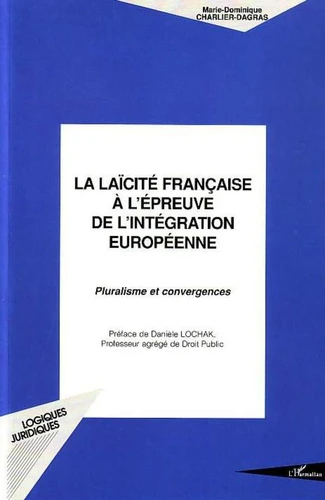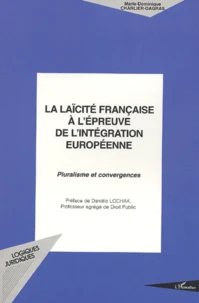La laïcité française à l'épreuve de l'intégration européenne. Pluralisme et convergence
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages452
- FormatPDF
- ISBN2-296-30455-9
- EAN9782296304550
- Date de parution01/12/2002
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille8 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
La loi de 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat, loin de n'être qu'une simple émancipation des sphères étatique et religieuse avait surtout pour ambition d'armer la liberté des citoyens quant à leurs convictions religieuses. Saisie par un discours politique souvent partisan, cette conception a fréquemment été occultée, au bénéfice d'une appréhension essentiellement anticléricale. Les mutations intervenues dans les sociétés occidentales contemporaines, qu'ils s'agisse du rapprochement de la société civile et de l'Etat, de la radicalisation des revendications identitaires de minorités, ou bien encore de manière différente, de la multiplication des dérives de type intégriste et sectaire, détiennent en commun le privilège de souligner l'impérieuse nécessité de revenir aux fondements juridiques et philosophiques du texte de 1905 et de démythifier cette laïcité que le doyen de Toulouse Maurice Hauriou qualifiait déjà en son temps de " fiction d'ignorance légale ".
L'urgence de ce sujet surgit aussi bien avec le port du turban par les Sikhs ou le port du foulard par les jeunes filles musulmanes qu'avec la réglementation de l'abattage rituel ou l'observation du shabbat. Ce défi se pose aujourd'hui avec force à un double niveau : français et européen. Effectivement, le processus d'intégration européen est lui aussi générateur d'un certain nombre de contraintes impliquant une nouvelle approche de la laïcité plus en conformité avec la liberté religieuse.
L'analyse du droit comparé des relations Eglises-Etat dans les pays de l'Union européenne, permet de mettre en évidence une pluralité de conceptions juridiques qui, peut être appréhendée dans le cadre d'une typologie constituée autour de deux modèles principaux : la " fusion institutionnelle " et la " coopération cultuelle ". Mais l'auteur démontre qu'un certain rapprochement dans la façon d'envisager les rapports entre l'Etat et la religion est à terme inévitable entre les pays d'Europe, dès lors qu'on assiste, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, à un processus d'harmonisation juridique.
Dégagée de toutes les idéologies, la laïcité française participe de la réflexion sur une nouvelle génération des droits de l'homme et plus particulièrement celle des droits culturels fondamentaux qui après la génération des droits politiques et celle des droits économiques et sociaux, favorise la diversité des croyances et des opinions et plus largement l'expression de la Fraternité. Préfaçant cet ouvrage, le professeur Danièle Lochak pose très précisément le coeur du sujet étudié : Comment concilier égalité et diversité, comment convaincre qu'assurer à tous les mêmes droits suppose aussi de respecter les identités plurielles, comment faire une place aux particularismes culturels sans sacrifier les exigences de l'universalisme et les contraintes du " vivre ensemble " ?
L'urgence de ce sujet surgit aussi bien avec le port du turban par les Sikhs ou le port du foulard par les jeunes filles musulmanes qu'avec la réglementation de l'abattage rituel ou l'observation du shabbat. Ce défi se pose aujourd'hui avec force à un double niveau : français et européen. Effectivement, le processus d'intégration européen est lui aussi générateur d'un certain nombre de contraintes impliquant une nouvelle approche de la laïcité plus en conformité avec la liberté religieuse.
L'analyse du droit comparé des relations Eglises-Etat dans les pays de l'Union européenne, permet de mettre en évidence une pluralité de conceptions juridiques qui, peut être appréhendée dans le cadre d'une typologie constituée autour de deux modèles principaux : la " fusion institutionnelle " et la " coopération cultuelle ". Mais l'auteur démontre qu'un certain rapprochement dans la façon d'envisager les rapports entre l'Etat et la religion est à terme inévitable entre les pays d'Europe, dès lors qu'on assiste, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, à un processus d'harmonisation juridique.
Dégagée de toutes les idéologies, la laïcité française participe de la réflexion sur une nouvelle génération des droits de l'homme et plus particulièrement celle des droits culturels fondamentaux qui après la génération des droits politiques et celle des droits économiques et sociaux, favorise la diversité des croyances et des opinions et plus largement l'expression de la Fraternité. Préfaçant cet ouvrage, le professeur Danièle Lochak pose très précisément le coeur du sujet étudié : Comment concilier égalité et diversité, comment convaincre qu'assurer à tous les mêmes droits suppose aussi de respecter les identités plurielles, comment faire une place aux particularismes culturels sans sacrifier les exigences de l'universalisme et les contraintes du " vivre ensemble " ?
La loi de 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat, loin de n'être qu'une simple émancipation des sphères étatique et religieuse avait surtout pour ambition d'armer la liberté des citoyens quant à leurs convictions religieuses. Saisie par un discours politique souvent partisan, cette conception a fréquemment été occultée, au bénéfice d'une appréhension essentiellement anticléricale. Les mutations intervenues dans les sociétés occidentales contemporaines, qu'ils s'agisse du rapprochement de la société civile et de l'Etat, de la radicalisation des revendications identitaires de minorités, ou bien encore de manière différente, de la multiplication des dérives de type intégriste et sectaire, détiennent en commun le privilège de souligner l'impérieuse nécessité de revenir aux fondements juridiques et philosophiques du texte de 1905 et de démythifier cette laïcité que le doyen de Toulouse Maurice Hauriou qualifiait déjà en son temps de " fiction d'ignorance légale ".
L'urgence de ce sujet surgit aussi bien avec le port du turban par les Sikhs ou le port du foulard par les jeunes filles musulmanes qu'avec la réglementation de l'abattage rituel ou l'observation du shabbat. Ce défi se pose aujourd'hui avec force à un double niveau : français et européen. Effectivement, le processus d'intégration européen est lui aussi générateur d'un certain nombre de contraintes impliquant une nouvelle approche de la laïcité plus en conformité avec la liberté religieuse.
L'analyse du droit comparé des relations Eglises-Etat dans les pays de l'Union européenne, permet de mettre en évidence une pluralité de conceptions juridiques qui, peut être appréhendée dans le cadre d'une typologie constituée autour de deux modèles principaux : la " fusion institutionnelle " et la " coopération cultuelle ". Mais l'auteur démontre qu'un certain rapprochement dans la façon d'envisager les rapports entre l'Etat et la religion est à terme inévitable entre les pays d'Europe, dès lors qu'on assiste, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, à un processus d'harmonisation juridique.
Dégagée de toutes les idéologies, la laïcité française participe de la réflexion sur une nouvelle génération des droits de l'homme et plus particulièrement celle des droits culturels fondamentaux qui après la génération des droits politiques et celle des droits économiques et sociaux, favorise la diversité des croyances et des opinions et plus largement l'expression de la Fraternité. Préfaçant cet ouvrage, le professeur Danièle Lochak pose très précisément le coeur du sujet étudié : Comment concilier égalité et diversité, comment convaincre qu'assurer à tous les mêmes droits suppose aussi de respecter les identités plurielles, comment faire une place aux particularismes culturels sans sacrifier les exigences de l'universalisme et les contraintes du " vivre ensemble " ?
L'urgence de ce sujet surgit aussi bien avec le port du turban par les Sikhs ou le port du foulard par les jeunes filles musulmanes qu'avec la réglementation de l'abattage rituel ou l'observation du shabbat. Ce défi se pose aujourd'hui avec force à un double niveau : français et européen. Effectivement, le processus d'intégration européen est lui aussi générateur d'un certain nombre de contraintes impliquant une nouvelle approche de la laïcité plus en conformité avec la liberté religieuse.
L'analyse du droit comparé des relations Eglises-Etat dans les pays de l'Union européenne, permet de mettre en évidence une pluralité de conceptions juridiques qui, peut être appréhendée dans le cadre d'une typologie constituée autour de deux modèles principaux : la " fusion institutionnelle " et la " coopération cultuelle ". Mais l'auteur démontre qu'un certain rapprochement dans la façon d'envisager les rapports entre l'Etat et la religion est à terme inévitable entre les pays d'Europe, dès lors qu'on assiste, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, à un processus d'harmonisation juridique.
Dégagée de toutes les idéologies, la laïcité française participe de la réflexion sur une nouvelle génération des droits de l'homme et plus particulièrement celle des droits culturels fondamentaux qui après la génération des droits politiques et celle des droits économiques et sociaux, favorise la diversité des croyances et des opinions et plus largement l'expression de la Fraternité. Préfaçant cet ouvrage, le professeur Danièle Lochak pose très précisément le coeur du sujet étudié : Comment concilier égalité et diversité, comment convaincre qu'assurer à tous les mêmes droits suppose aussi de respecter les identités plurielles, comment faire une place aux particularismes culturels sans sacrifier les exigences de l'universalisme et les contraintes du " vivre ensemble " ?