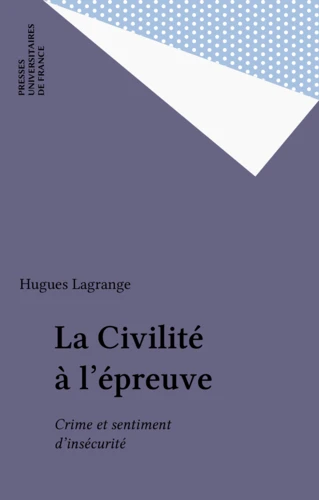LA CIVILITE A L'EPREUVE. Crime et sentiment d'insécurité
Par :Formats :
Actuellement indisponible
Cet article est actuellement indisponible, il ne peut pas être commandé sur notre site pour le moment. Nous vous invitons à vous inscrire à l'alerte disponibilité, vous recevrez un e-mail dès que cet ouvrage sera à nouveau disponible.
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages320
- FormatePub
- ISBN2-13-068032-1
- EAN9782130680321
- Date de parution31/12/1994
- Protection num.Digital Watermarking
- ÉditeurPresses universitaires de France...
Résumé
Du XVIe au XXe siècle, un processus de pacification des mours est intervenu dans la vie civile de la plupart des pays d'Europe. Cette réduction des violences interpersonnelles s'opère, parallèlement à ce que N. Élias a décrit comme une civilisation des mours. Favorisée par la diffusion des manières de Cour, la civilisation des mours se caractérise par une répression de l'expression publique des émotions et des passions, et le développement d'une sphère privée.
Pour Élias, la réduction de la violence interpersonnelle est la conséquence d'un processus historique de maîtrise de l'affectivité. Le refoulement des pulsions est venu prendre le relais de la coercition externe, du XVIIe au XIXe siècle, la sanction du crime va perdre son caractère emblématique d'expiation sanguinaire, pour s'inscrire dans le cadre d'une économie proportionnée. Au regard du recul historique des violences interpersonnelles dans les rapports civils ordinaires, l'augmentation des agressions et des crimes d'appropriation des trois dernières décennies, est remarquable.
Cette résurgence de la violence n'aurait pas une telle portée, si le développement d'un sentiment d'insécurité - manifeste tant dans les choix politiques, que dans les comportements d'ostracisme - et une profonde involution de la vie sociale, n'étaient venues s'y associer. Suscité, à la fin des années 1980, par la multiplication de la délinquance prédatrice, le sentiment d'insécurité est, d'abord, le fait des populations peu exposées puis, avec l'explosion des incivilités, il se déplace dans les centres urbains ; il touche encore, en priorité, la fraction la plus âgée - et la moins exposée - de la population.
Dans la phase actuelle, l'inquiétude gagne les gens plus jeunes, habitant les zones où la violence interpersonnelle est forte, elle répond à la fois à une violence exogène, et à une violence venue de soi-même ou de proches, en quelque sorte endogène. Peut-on évaluer la pacification des mours et son involution sans s'interroger sur les conditions qui ont permis l'une et l'autre ? Peut-on éluder la question de savoir au prix de quoi la lutte contre les crimes et délits, dont l'augmentation ne paraît pas douteuse, doit être entreprise ? À quelle aune apprécier les vicissitudes de la paix civile ?
Pour Élias, la réduction de la violence interpersonnelle est la conséquence d'un processus historique de maîtrise de l'affectivité. Le refoulement des pulsions est venu prendre le relais de la coercition externe, du XVIIe au XIXe siècle, la sanction du crime va perdre son caractère emblématique d'expiation sanguinaire, pour s'inscrire dans le cadre d'une économie proportionnée. Au regard du recul historique des violences interpersonnelles dans les rapports civils ordinaires, l'augmentation des agressions et des crimes d'appropriation des trois dernières décennies, est remarquable.
Cette résurgence de la violence n'aurait pas une telle portée, si le développement d'un sentiment d'insécurité - manifeste tant dans les choix politiques, que dans les comportements d'ostracisme - et une profonde involution de la vie sociale, n'étaient venues s'y associer. Suscité, à la fin des années 1980, par la multiplication de la délinquance prédatrice, le sentiment d'insécurité est, d'abord, le fait des populations peu exposées puis, avec l'explosion des incivilités, il se déplace dans les centres urbains ; il touche encore, en priorité, la fraction la plus âgée - et la moins exposée - de la population.
Dans la phase actuelle, l'inquiétude gagne les gens plus jeunes, habitant les zones où la violence interpersonnelle est forte, elle répond à la fois à une violence exogène, et à une violence venue de soi-même ou de proches, en quelque sorte endogène. Peut-on évaluer la pacification des mours et son involution sans s'interroger sur les conditions qui ont permis l'une et l'autre ? Peut-on éluder la question de savoir au prix de quoi la lutte contre les crimes et délits, dont l'augmentation ne paraît pas douteuse, doit être entreprise ? À quelle aune apprécier les vicissitudes de la paix civile ?
Du XVIe au XXe siècle, un processus de pacification des mours est intervenu dans la vie civile de la plupart des pays d'Europe. Cette réduction des violences interpersonnelles s'opère, parallèlement à ce que N. Élias a décrit comme une civilisation des mours. Favorisée par la diffusion des manières de Cour, la civilisation des mours se caractérise par une répression de l'expression publique des émotions et des passions, et le développement d'une sphère privée.
Pour Élias, la réduction de la violence interpersonnelle est la conséquence d'un processus historique de maîtrise de l'affectivité. Le refoulement des pulsions est venu prendre le relais de la coercition externe, du XVIIe au XIXe siècle, la sanction du crime va perdre son caractère emblématique d'expiation sanguinaire, pour s'inscrire dans le cadre d'une économie proportionnée. Au regard du recul historique des violences interpersonnelles dans les rapports civils ordinaires, l'augmentation des agressions et des crimes d'appropriation des trois dernières décennies, est remarquable.
Cette résurgence de la violence n'aurait pas une telle portée, si le développement d'un sentiment d'insécurité - manifeste tant dans les choix politiques, que dans les comportements d'ostracisme - et une profonde involution de la vie sociale, n'étaient venues s'y associer. Suscité, à la fin des années 1980, par la multiplication de la délinquance prédatrice, le sentiment d'insécurité est, d'abord, le fait des populations peu exposées puis, avec l'explosion des incivilités, il se déplace dans les centres urbains ; il touche encore, en priorité, la fraction la plus âgée - et la moins exposée - de la population.
Dans la phase actuelle, l'inquiétude gagne les gens plus jeunes, habitant les zones où la violence interpersonnelle est forte, elle répond à la fois à une violence exogène, et à une violence venue de soi-même ou de proches, en quelque sorte endogène. Peut-on évaluer la pacification des mours et son involution sans s'interroger sur les conditions qui ont permis l'une et l'autre ? Peut-on éluder la question de savoir au prix de quoi la lutte contre les crimes et délits, dont l'augmentation ne paraît pas douteuse, doit être entreprise ? À quelle aune apprécier les vicissitudes de la paix civile ?
Pour Élias, la réduction de la violence interpersonnelle est la conséquence d'un processus historique de maîtrise de l'affectivité. Le refoulement des pulsions est venu prendre le relais de la coercition externe, du XVIIe au XIXe siècle, la sanction du crime va perdre son caractère emblématique d'expiation sanguinaire, pour s'inscrire dans le cadre d'une économie proportionnée. Au regard du recul historique des violences interpersonnelles dans les rapports civils ordinaires, l'augmentation des agressions et des crimes d'appropriation des trois dernières décennies, est remarquable.
Cette résurgence de la violence n'aurait pas une telle portée, si le développement d'un sentiment d'insécurité - manifeste tant dans les choix politiques, que dans les comportements d'ostracisme - et une profonde involution de la vie sociale, n'étaient venues s'y associer. Suscité, à la fin des années 1980, par la multiplication de la délinquance prédatrice, le sentiment d'insécurité est, d'abord, le fait des populations peu exposées puis, avec l'explosion des incivilités, il se déplace dans les centres urbains ; il touche encore, en priorité, la fraction la plus âgée - et la moins exposée - de la population.
Dans la phase actuelle, l'inquiétude gagne les gens plus jeunes, habitant les zones où la violence interpersonnelle est forte, elle répond à la fois à une violence exogène, et à une violence venue de soi-même ou de proches, en quelque sorte endogène. Peut-on évaluer la pacification des mours et son involution sans s'interroger sur les conditions qui ont permis l'une et l'autre ? Peut-on éluder la question de savoir au prix de quoi la lutte contre les crimes et délits, dont l'augmentation ne paraît pas douteuse, doit être entreprise ? À quelle aune apprécier les vicissitudes de la paix civile ?