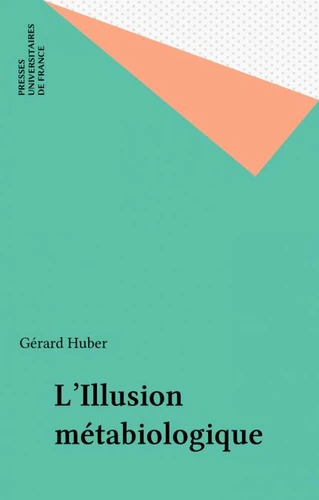L'illusion métabiologique
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages224
- FormatePub
- ISBN2-13-068010-0
- EAN9782130680109
- Date de parution01/01/1994
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille287 Ko
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurPresses universitaires de France...
Résumé
Sur le modèle de l'expression freudienne de métapsychologie a, depuis longtemps, été inventée celle de métabiologie. Elle était alors, il est vrai, censée rendre compte d'une espérance de transformation des sciences de la vie par la psychanalyse. Ferenczi y a cru ; Freud non. Était-ce la première illusion ? L'illusion métabiologique aujourd'hui ferait, en vérité, bien peu cas des développements cliniques et théoriques de la psychanalyse.
Idéologiquement animée par une volonté de puissance, elle consisterait en la croyance de pouvoir réaliser, sans limites, des choix sélectifs en vue d'une néo-adaptation - y compris dans le champ des comportements humains. Après l'échec de la psychiatrie biologique, la psychopathologie deviendra-t-elle un jour génomique ou génétique ? Prenons acte que les recherches les plus sérieuses dans les sciences de la vie et de la santé, n'ont guère besoin de revendiquer l'appel à une métabiologie et, pour nombre d'entre elles, ne contesteraient pas la place accordée à la psychanalyse.
Dans cet ouvrage, Gérard Huber traite tout d'abord des rapports entre neurosciences et métapsychologie : il s'interroge sur les conditions psychiques d'une réalité neuronale. Dégageant les principales réponses de l'humanisme philosophique contemporain face aux avancées de la biologie, il détecte en celles-ci les formes de méconnaissance des apports de la métapsychologie freudienne. Serait-ce alors sur cette seule voie, Spinoza-Freud, que peuvent valablement se trouver questionnées la biologie et la neurobiologie aux fins d'intégrer leurs apports incontestables - en deçà ou au delà de tout réductionnisme métabiologique ?
Idéologiquement animée par une volonté de puissance, elle consisterait en la croyance de pouvoir réaliser, sans limites, des choix sélectifs en vue d'une néo-adaptation - y compris dans le champ des comportements humains. Après l'échec de la psychiatrie biologique, la psychopathologie deviendra-t-elle un jour génomique ou génétique ? Prenons acte que les recherches les plus sérieuses dans les sciences de la vie et de la santé, n'ont guère besoin de revendiquer l'appel à une métabiologie et, pour nombre d'entre elles, ne contesteraient pas la place accordée à la psychanalyse.
Dans cet ouvrage, Gérard Huber traite tout d'abord des rapports entre neurosciences et métapsychologie : il s'interroge sur les conditions psychiques d'une réalité neuronale. Dégageant les principales réponses de l'humanisme philosophique contemporain face aux avancées de la biologie, il détecte en celles-ci les formes de méconnaissance des apports de la métapsychologie freudienne. Serait-ce alors sur cette seule voie, Spinoza-Freud, que peuvent valablement se trouver questionnées la biologie et la neurobiologie aux fins d'intégrer leurs apports incontestables - en deçà ou au delà de tout réductionnisme métabiologique ?
Sur le modèle de l'expression freudienne de métapsychologie a, depuis longtemps, été inventée celle de métabiologie. Elle était alors, il est vrai, censée rendre compte d'une espérance de transformation des sciences de la vie par la psychanalyse. Ferenczi y a cru ; Freud non. Était-ce la première illusion ? L'illusion métabiologique aujourd'hui ferait, en vérité, bien peu cas des développements cliniques et théoriques de la psychanalyse.
Idéologiquement animée par une volonté de puissance, elle consisterait en la croyance de pouvoir réaliser, sans limites, des choix sélectifs en vue d'une néo-adaptation - y compris dans le champ des comportements humains. Après l'échec de la psychiatrie biologique, la psychopathologie deviendra-t-elle un jour génomique ou génétique ? Prenons acte que les recherches les plus sérieuses dans les sciences de la vie et de la santé, n'ont guère besoin de revendiquer l'appel à une métabiologie et, pour nombre d'entre elles, ne contesteraient pas la place accordée à la psychanalyse.
Dans cet ouvrage, Gérard Huber traite tout d'abord des rapports entre neurosciences et métapsychologie : il s'interroge sur les conditions psychiques d'une réalité neuronale. Dégageant les principales réponses de l'humanisme philosophique contemporain face aux avancées de la biologie, il détecte en celles-ci les formes de méconnaissance des apports de la métapsychologie freudienne. Serait-ce alors sur cette seule voie, Spinoza-Freud, que peuvent valablement se trouver questionnées la biologie et la neurobiologie aux fins d'intégrer leurs apports incontestables - en deçà ou au delà de tout réductionnisme métabiologique ?
Idéologiquement animée par une volonté de puissance, elle consisterait en la croyance de pouvoir réaliser, sans limites, des choix sélectifs en vue d'une néo-adaptation - y compris dans le champ des comportements humains. Après l'échec de la psychiatrie biologique, la psychopathologie deviendra-t-elle un jour génomique ou génétique ? Prenons acte que les recherches les plus sérieuses dans les sciences de la vie et de la santé, n'ont guère besoin de revendiquer l'appel à une métabiologie et, pour nombre d'entre elles, ne contesteraient pas la place accordée à la psychanalyse.
Dans cet ouvrage, Gérard Huber traite tout d'abord des rapports entre neurosciences et métapsychologie : il s'interroge sur les conditions psychiques d'une réalité neuronale. Dégageant les principales réponses de l'humanisme philosophique contemporain face aux avancées de la biologie, il détecte en celles-ci les formes de méconnaissance des apports de la métapsychologie freudienne. Serait-ce alors sur cette seule voie, Spinoza-Freud, que peuvent valablement se trouver questionnées la biologie et la neurobiologie aux fins d'intégrer leurs apports incontestables - en deçà ou au delà de tout réductionnisme métabiologique ?