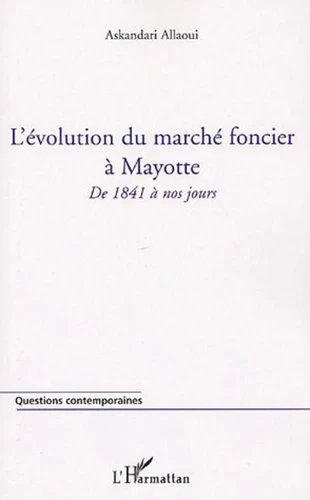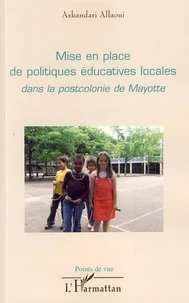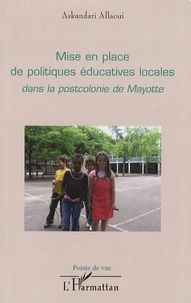L'évolution du marché foncier à Mayotte. De 1841 à nos jours
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages186
- FormatPDF
- ISBN2-296-14423-3
- EAN9782296144231
- Date de parution01/03/2006
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille1 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Mayotte est cette île française de l'océan Indien, faisant géographiquement partie de l'archipel des Comores. L'île fut cédée à la France en 1841 par Andriantsoly. L'article 5 du traité stipulait que la France devait reconnaître les propriétés foncières des autochtones. Le sultan de Mayotte s'effaça de la scène politique et le colons, nouveaux maîtres de l'île, restèrent seuls juges et policier; pour mettre en application et contrôler les prescriptions de ladite convention.
Le traité souffrait d'une imprécision sur un point au moins : la définition d'une propriété foncière. Cette étude, mettant en avant la notion de marché foncier, un espace d'échange où ce qui s'échange est le lopin de terre, voudrait mettre en exergue les lois qui ont caractérisé ce champ particulier, où dominant et dominé cherchent à accumuler chacun à son profit le capital spécifique. Ce faisant, ce travail constitue une évaluation des tractations dont firent l'objet les terres des habitants de Mayotte.
Mais encore, l'auteur voudrait mettre en évidence la déculturation caractérisant les nouveaux cadres indigènes au regard de la représentation foncière conduisant inévitablement à des rapports conflictuels au sein de la communauté mahoraise.
Le traité souffrait d'une imprécision sur un point au moins : la définition d'une propriété foncière. Cette étude, mettant en avant la notion de marché foncier, un espace d'échange où ce qui s'échange est le lopin de terre, voudrait mettre en exergue les lois qui ont caractérisé ce champ particulier, où dominant et dominé cherchent à accumuler chacun à son profit le capital spécifique. Ce faisant, ce travail constitue une évaluation des tractations dont firent l'objet les terres des habitants de Mayotte.
Mais encore, l'auteur voudrait mettre en évidence la déculturation caractérisant les nouveaux cadres indigènes au regard de la représentation foncière conduisant inévitablement à des rapports conflictuels au sein de la communauté mahoraise.
Mayotte est cette île française de l'océan Indien, faisant géographiquement partie de l'archipel des Comores. L'île fut cédée à la France en 1841 par Andriantsoly. L'article 5 du traité stipulait que la France devait reconnaître les propriétés foncières des autochtones. Le sultan de Mayotte s'effaça de la scène politique et le colons, nouveaux maîtres de l'île, restèrent seuls juges et policier; pour mettre en application et contrôler les prescriptions de ladite convention.
Le traité souffrait d'une imprécision sur un point au moins : la définition d'une propriété foncière. Cette étude, mettant en avant la notion de marché foncier, un espace d'échange où ce qui s'échange est le lopin de terre, voudrait mettre en exergue les lois qui ont caractérisé ce champ particulier, où dominant et dominé cherchent à accumuler chacun à son profit le capital spécifique. Ce faisant, ce travail constitue une évaluation des tractations dont firent l'objet les terres des habitants de Mayotte.
Mais encore, l'auteur voudrait mettre en évidence la déculturation caractérisant les nouveaux cadres indigènes au regard de la représentation foncière conduisant inévitablement à des rapports conflictuels au sein de la communauté mahoraise.
Le traité souffrait d'une imprécision sur un point au moins : la définition d'une propriété foncière. Cette étude, mettant en avant la notion de marché foncier, un espace d'échange où ce qui s'échange est le lopin de terre, voudrait mettre en exergue les lois qui ont caractérisé ce champ particulier, où dominant et dominé cherchent à accumuler chacun à son profit le capital spécifique. Ce faisant, ce travail constitue une évaluation des tractations dont firent l'objet les terres des habitants de Mayotte.
Mais encore, l'auteur voudrait mettre en évidence la déculturation caractérisant les nouveaux cadres indigènes au regard de la représentation foncière conduisant inévitablement à des rapports conflictuels au sein de la communauté mahoraise.