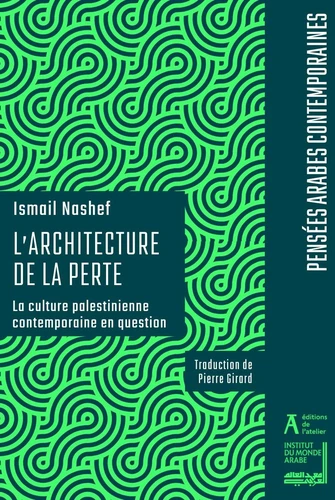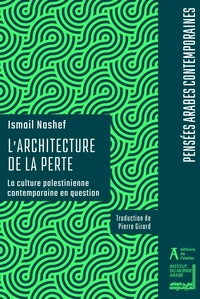Nouveauté
L'architecture de la perte. La culture palestinienne contemporaine en question
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format Multi-format est :
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages350
- FormatMulti-format
- ISBN978-2-7082-5571-5
- EAN9782708255715
- Date de parution21/11/2025
- Protection num.NC
- Infos supplémentairesMulti-format incluant ePub avec ...
- ÉditeurÉditions de l'Atelier
- TraducteurPierre Girard
- TraducteurFranck Mermier
Résumé
L'ouvrage d'Ismaïl Nachef explore l'évolution de la pensée de la perte dans la culture palestinienne contemporaine, façonnée par la Nakba de 1948. Il analyse comment cette perte fondatrice est sans cesse rejouée, notamment après les accords d'Oslo de 1993, qui marquent une transition : la perte initiale est absorbée par de nouvelles défaites politiques. Nachef examine diverses productions culturelles - littérature, arts visuels, architecture, récits du quotidien - pour comprendre comment elles traduisent cette mémoire.
Ces ouvres manifestent une appropriation de plus en plus indirecte de la Nakba, révélant une dynamique marquée par la « perte de la perte ».
Ces ouvres manifestent une appropriation de plus en plus indirecte de la Nakba, révélant une dynamique marquée par la « perte de la perte ».
L'ouvrage d'Ismaïl Nachef explore l'évolution de la pensée de la perte dans la culture palestinienne contemporaine, façonnée par la Nakba de 1948. Il analyse comment cette perte fondatrice est sans cesse rejouée, notamment après les accords d'Oslo de 1993, qui marquent une transition : la perte initiale est absorbée par de nouvelles défaites politiques. Nachef examine diverses productions culturelles - littérature, arts visuels, architecture, récits du quotidien - pour comprendre comment elles traduisent cette mémoire.
Ces ouvres manifestent une appropriation de plus en plus indirecte de la Nakba, révélant une dynamique marquée par la « perte de la perte ».
Ces ouvres manifestent une appropriation de plus en plus indirecte de la Nakba, révélant une dynamique marquée par la « perte de la perte ».