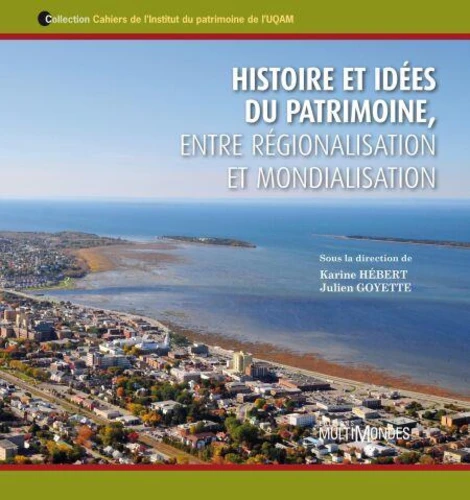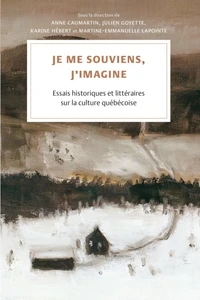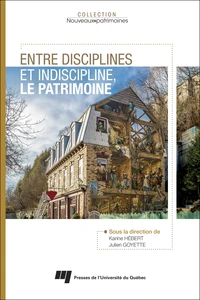Histoire et idées du patrimoine, entre régionalisation et mondialisation
Par : ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages326
- FormatePub
- ISBN978-2-89544-976-8
- EAN9782895449768
- Date de parution20/01/2011
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille14 Mo
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurMultiMondes Editions
Résumé
Cet ouvrage montre que le patrimoine est un processus de part en part, mais un processus qui n'a rien d'abstrait. Le patrimoine, en effet, n'existe pas en dehors d'objets, d'institutions et d'acteurs?; il est également toujours situé - dans un moment et dans un lieu. Et si la patrimonialisation n'est pas linéaire, si elle ne se déroule pas devant nous à la manière d'un ruban, elle n'est pas non plus homogène.
Avec la mondialisation, le patrimoine se définit maintenant dans une dialectique région-monde, ce qui, pour le chercheur, implique de faire de constants allers-retours entre les plans local et universel. Au total, les enjeux soulevés dans cet ouvrage se traduisent par une série de questions et de difficultés. Comment concilier spécificité et universalisme, sauvegarde et diffusion, conservation et démocratisation?? Difficulté à rendre compte de tous les jeux d'échelle sur le plan patrimonial.
Comment un témoin d'un courant culturel étranger, même reconnu comme patrimoine mondial, peut-il en venir à faire partie d'une mémoire patrimoniale «?autochtone?»?? Difficulté aussi à concilier les représentations, à la fois antinomiques et complémentaires, des experts, des citoyens et des touristes. Peut-on s'approprier un patrimoine qui émane d'un autre pays, d'un autre groupe culturel?? À quel prix sur le plan identitaire?? Qui peut s'arroger le droit de le préserver, notamment lorsqu'on parle de patrimoine mondial?? Comment faire correspondre la mémoire du bourreau et de la victime, du colonisateur et du colonisé, du pauvre et du riche, du contribuable et de l'amateur de prouesses architecturales?? Difficulté enfin à concilier mémoire heureuse et mémoire honteuse, le nécessaire oubli et le devoir de mémoire.
Avec la mondialisation, le patrimoine se définit maintenant dans une dialectique région-monde, ce qui, pour le chercheur, implique de faire de constants allers-retours entre les plans local et universel. Au total, les enjeux soulevés dans cet ouvrage se traduisent par une série de questions et de difficultés. Comment concilier spécificité et universalisme, sauvegarde et diffusion, conservation et démocratisation?? Difficulté à rendre compte de tous les jeux d'échelle sur le plan patrimonial.
Comment un témoin d'un courant culturel étranger, même reconnu comme patrimoine mondial, peut-il en venir à faire partie d'une mémoire patrimoniale «?autochtone?»?? Difficulté aussi à concilier les représentations, à la fois antinomiques et complémentaires, des experts, des citoyens et des touristes. Peut-on s'approprier un patrimoine qui émane d'un autre pays, d'un autre groupe culturel?? À quel prix sur le plan identitaire?? Qui peut s'arroger le droit de le préserver, notamment lorsqu'on parle de patrimoine mondial?? Comment faire correspondre la mémoire du bourreau et de la victime, du colonisateur et du colonisé, du pauvre et du riche, du contribuable et de l'amateur de prouesses architecturales?? Difficulté enfin à concilier mémoire heureuse et mémoire honteuse, le nécessaire oubli et le devoir de mémoire.
Cet ouvrage montre que le patrimoine est un processus de part en part, mais un processus qui n'a rien d'abstrait. Le patrimoine, en effet, n'existe pas en dehors d'objets, d'institutions et d'acteurs?; il est également toujours situé - dans un moment et dans un lieu. Et si la patrimonialisation n'est pas linéaire, si elle ne se déroule pas devant nous à la manière d'un ruban, elle n'est pas non plus homogène.
Avec la mondialisation, le patrimoine se définit maintenant dans une dialectique région-monde, ce qui, pour le chercheur, implique de faire de constants allers-retours entre les plans local et universel. Au total, les enjeux soulevés dans cet ouvrage se traduisent par une série de questions et de difficultés. Comment concilier spécificité et universalisme, sauvegarde et diffusion, conservation et démocratisation?? Difficulté à rendre compte de tous les jeux d'échelle sur le plan patrimonial.
Comment un témoin d'un courant culturel étranger, même reconnu comme patrimoine mondial, peut-il en venir à faire partie d'une mémoire patrimoniale «?autochtone?»?? Difficulté aussi à concilier les représentations, à la fois antinomiques et complémentaires, des experts, des citoyens et des touristes. Peut-on s'approprier un patrimoine qui émane d'un autre pays, d'un autre groupe culturel?? À quel prix sur le plan identitaire?? Qui peut s'arroger le droit de le préserver, notamment lorsqu'on parle de patrimoine mondial?? Comment faire correspondre la mémoire du bourreau et de la victime, du colonisateur et du colonisé, du pauvre et du riche, du contribuable et de l'amateur de prouesses architecturales?? Difficulté enfin à concilier mémoire heureuse et mémoire honteuse, le nécessaire oubli et le devoir de mémoire.
Avec la mondialisation, le patrimoine se définit maintenant dans une dialectique région-monde, ce qui, pour le chercheur, implique de faire de constants allers-retours entre les plans local et universel. Au total, les enjeux soulevés dans cet ouvrage se traduisent par une série de questions et de difficultés. Comment concilier spécificité et universalisme, sauvegarde et diffusion, conservation et démocratisation?? Difficulté à rendre compte de tous les jeux d'échelle sur le plan patrimonial.
Comment un témoin d'un courant culturel étranger, même reconnu comme patrimoine mondial, peut-il en venir à faire partie d'une mémoire patrimoniale «?autochtone?»?? Difficulté aussi à concilier les représentations, à la fois antinomiques et complémentaires, des experts, des citoyens et des touristes. Peut-on s'approprier un patrimoine qui émane d'un autre pays, d'un autre groupe culturel?? À quel prix sur le plan identitaire?? Qui peut s'arroger le droit de le préserver, notamment lorsqu'on parle de patrimoine mondial?? Comment faire correspondre la mémoire du bourreau et de la victime, du colonisateur et du colonisé, du pauvre et du riche, du contribuable et de l'amateur de prouesses architecturales?? Difficulté enfin à concilier mémoire heureuse et mémoire honteuse, le nécessaire oubli et le devoir de mémoire.