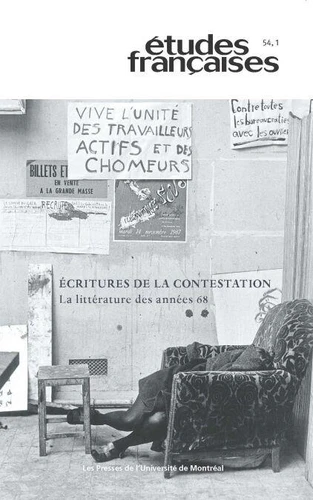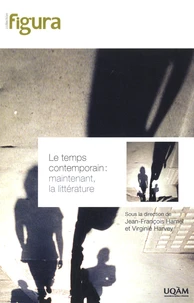Études françaises. Volume 54, numéro 1, 2018. Écritures de la contestation: la littérature des années 68
Par : , , , ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages196
- FormatePub
- ISBN978-2-7606-3971-3
- EAN9782760639713
- Date de parution21/06/2018
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille2 Mo
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurLes Presses de l’Université de M...
Résumé
Depuis un demi-siècle, on prétend que les semaines insurrectionnelles de mai et juin 1968 n'ont eu aucune incidence sur la littérature, si ce n'est de quelques ouvres mineures aussitôt reléguées à l'oubli. D'où le paradoxe d'une explosion révolutionnaire sans égale dans le XXe siècle français, qui a suscité et suscite encore un foisonnement d'interprétations, de commentaires, de témoignages, mais dont le souffle contestataire aurait à peine été ressenti dans le monde littéraire.
Pourtant, à condition de porter l'enquête au-delà de la thématique des ouvres et de l'ouvrir aux apports des sociologues et des historiens, qui ont profondément renouvelé depuis dix ans notre compréhension de la crise de mai et juin, force est de constater que des écrivains, des critiques et des théoriciens ont bel et bien ouvré à transposer en littérature le renouvellement des pratiques et des discours de la contestation.
À l'occasion du cinquantième anniversaire des « événements », ce dossier démontre que le cycle de mobilisation qui culmine dans la crise de Mai, en remettant en cause la division du travail entre écrivain et lecteur, en critiquant les institutions qui assurent la production et la médiation des textes, en traquant les effets idéologiques engendrés par le culte des ouvres et des écrivains, a bouleversé l'idée même de littérature et les modalités de son action dans l'espace public.
À ce titre, les « années 68 » marquent sans doute une inflexion majeure dans l'histoire des politiques de l'écriture.
Pourtant, à condition de porter l'enquête au-delà de la thématique des ouvres et de l'ouvrir aux apports des sociologues et des historiens, qui ont profondément renouvelé depuis dix ans notre compréhension de la crise de mai et juin, force est de constater que des écrivains, des critiques et des théoriciens ont bel et bien ouvré à transposer en littérature le renouvellement des pratiques et des discours de la contestation.
À l'occasion du cinquantième anniversaire des « événements », ce dossier démontre que le cycle de mobilisation qui culmine dans la crise de Mai, en remettant en cause la division du travail entre écrivain et lecteur, en critiquant les institutions qui assurent la production et la médiation des textes, en traquant les effets idéologiques engendrés par le culte des ouvres et des écrivains, a bouleversé l'idée même de littérature et les modalités de son action dans l'espace public.
À ce titre, les « années 68 » marquent sans doute une inflexion majeure dans l'histoire des politiques de l'écriture.
Depuis un demi-siècle, on prétend que les semaines insurrectionnelles de mai et juin 1968 n'ont eu aucune incidence sur la littérature, si ce n'est de quelques ouvres mineures aussitôt reléguées à l'oubli. D'où le paradoxe d'une explosion révolutionnaire sans égale dans le XXe siècle français, qui a suscité et suscite encore un foisonnement d'interprétations, de commentaires, de témoignages, mais dont le souffle contestataire aurait à peine été ressenti dans le monde littéraire.
Pourtant, à condition de porter l'enquête au-delà de la thématique des ouvres et de l'ouvrir aux apports des sociologues et des historiens, qui ont profondément renouvelé depuis dix ans notre compréhension de la crise de mai et juin, force est de constater que des écrivains, des critiques et des théoriciens ont bel et bien ouvré à transposer en littérature le renouvellement des pratiques et des discours de la contestation.
À l'occasion du cinquantième anniversaire des « événements », ce dossier démontre que le cycle de mobilisation qui culmine dans la crise de Mai, en remettant en cause la division du travail entre écrivain et lecteur, en critiquant les institutions qui assurent la production et la médiation des textes, en traquant les effets idéologiques engendrés par le culte des ouvres et des écrivains, a bouleversé l'idée même de littérature et les modalités de son action dans l'espace public.
À ce titre, les « années 68 » marquent sans doute une inflexion majeure dans l'histoire des politiques de l'écriture.
Pourtant, à condition de porter l'enquête au-delà de la thématique des ouvres et de l'ouvrir aux apports des sociologues et des historiens, qui ont profondément renouvelé depuis dix ans notre compréhension de la crise de mai et juin, force est de constater que des écrivains, des critiques et des théoriciens ont bel et bien ouvré à transposer en littérature le renouvellement des pratiques et des discours de la contestation.
À l'occasion du cinquantième anniversaire des « événements », ce dossier démontre que le cycle de mobilisation qui culmine dans la crise de Mai, en remettant en cause la division du travail entre écrivain et lecteur, en critiquant les institutions qui assurent la production et la médiation des textes, en traquant les effets idéologiques engendrés par le culte des ouvres et des écrivains, a bouleversé l'idée même de littérature et les modalités de son action dans l'espace public.
À ce titre, les « années 68 » marquent sans doute une inflexion majeure dans l'histoire des politiques de l'écriture.