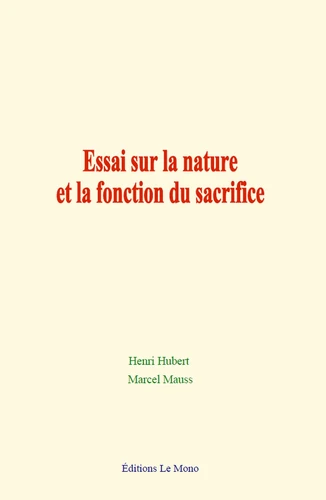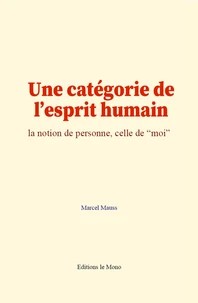Essai sur la nature et la fonction du sacrifice
Par : ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format Multi-format est :
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- FormatMulti-format
- ISBN978-2-38111-226-8
- EAN9782381112268
- Date de parution24/05/2021
- Protection num.NC
- Infos supplémentairesMulti-format incluant ePub avec ...
- ÉditeurEditions Le Mono
Résumé
Nous nous sommes proposé dans ce travail de définir la nature et la fonction sociale du sacrifice.
Le mot de sacrifice suggère immédiatement l'idée de consécration et l'on pourrait être induit à croire que les deux notions se confondent. Il est bien certain, en effet, que le sacrifice implique toujours une consécration ; dans tout sacrifice, un objet passe du domaine commun dans le domaine religieux ; il est consacré.
Mais toutes les consécrations ne sont pas de même nature. Il en est qui épuisent leurs effets sur l'objet consacré, quel qu'il soit, homme ou chose. C'est, par exemple, le cas de l'onction. Sacre-t-on un roi ? Seule, la personnalité religieuse du roi est modifiée ; en dehors d'elle, rien n'est changé. Dans le sacrifice, au contraire, la consécration rayonne au-delà de la chose consacrée ; elle atteint entre autres la personne morale qui fait les frais de la cérémonie.
Le fidèle qui a fourni la victime, objet de la consécration, n'est pas, à la fin de l'opération, ce qu'il était au commencement. Il a acquis un caractère religieux qu'il n'avait pas, ou il s'est débarrassé d'un caractère défavorable dont il était affligé ; il s'est élevé à un état de grâce ou il est sorti d'un état de péché. Dans un cas comme dans l'autre, il est religieusement transformé.
Mais toutes les consécrations ne sont pas de même nature. Il en est qui épuisent leurs effets sur l'objet consacré, quel qu'il soit, homme ou chose. C'est, par exemple, le cas de l'onction. Sacre-t-on un roi ? Seule, la personnalité religieuse du roi est modifiée ; en dehors d'elle, rien n'est changé. Dans le sacrifice, au contraire, la consécration rayonne au-delà de la chose consacrée ; elle atteint entre autres la personne morale qui fait les frais de la cérémonie.
Le fidèle qui a fourni la victime, objet de la consécration, n'est pas, à la fin de l'opération, ce qu'il était au commencement. Il a acquis un caractère religieux qu'il n'avait pas, ou il s'est débarrassé d'un caractère défavorable dont il était affligé ; il s'est élevé à un état de grâce ou il est sorti d'un état de péché. Dans un cas comme dans l'autre, il est religieusement transformé.
Nous nous sommes proposé dans ce travail de définir la nature et la fonction sociale du sacrifice.
Le mot de sacrifice suggère immédiatement l'idée de consécration et l'on pourrait être induit à croire que les deux notions se confondent. Il est bien certain, en effet, que le sacrifice implique toujours une consécration ; dans tout sacrifice, un objet passe du domaine commun dans le domaine religieux ; il est consacré.
Mais toutes les consécrations ne sont pas de même nature. Il en est qui épuisent leurs effets sur l'objet consacré, quel qu'il soit, homme ou chose. C'est, par exemple, le cas de l'onction. Sacre-t-on un roi ? Seule, la personnalité religieuse du roi est modifiée ; en dehors d'elle, rien n'est changé. Dans le sacrifice, au contraire, la consécration rayonne au-delà de la chose consacrée ; elle atteint entre autres la personne morale qui fait les frais de la cérémonie.
Le fidèle qui a fourni la victime, objet de la consécration, n'est pas, à la fin de l'opération, ce qu'il était au commencement. Il a acquis un caractère religieux qu'il n'avait pas, ou il s'est débarrassé d'un caractère défavorable dont il était affligé ; il s'est élevé à un état de grâce ou il est sorti d'un état de péché. Dans un cas comme dans l'autre, il est religieusement transformé.
Mais toutes les consécrations ne sont pas de même nature. Il en est qui épuisent leurs effets sur l'objet consacré, quel qu'il soit, homme ou chose. C'est, par exemple, le cas de l'onction. Sacre-t-on un roi ? Seule, la personnalité religieuse du roi est modifiée ; en dehors d'elle, rien n'est changé. Dans le sacrifice, au contraire, la consécration rayonne au-delà de la chose consacrée ; elle atteint entre autres la personne morale qui fait les frais de la cérémonie.
Le fidèle qui a fourni la victime, objet de la consécration, n'est pas, à la fin de l'opération, ce qu'il était au commencement. Il a acquis un caractère religieux qu'il n'avait pas, ou il s'est débarrassé d'un caractère défavorable dont il était affligé ; il s'est élevé à un état de grâce ou il est sorti d'un état de péché. Dans un cas comme dans l'autre, il est religieusement transformé.