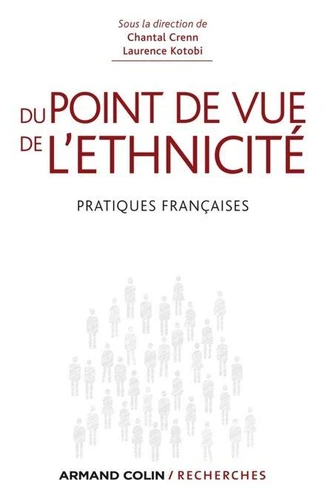Du point de vue de l'ethnicité. Pratiques françaises
Par : ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub protégé est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
- Non compatible avec un achat hors France métropolitaine
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages240
- FormatePub
- ISBN978-2-200-27646-1
- EAN9782200276461
- Date de parution22/02/2012
- Copier CollerNon Autorisé
- Protection num.Adobe & CARE
- Taille666 Ko
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurArmand Colin
Résumé
Depuis une vingtaine d'années, les discussions tantôt politiques, tantôt scientifiques autour du « modèle républicain français d'intégration » témoignent implicitement d'un malaise face à cette question, tout en les occultant dans la pratique. Finalement, ce qui pose problème aujourd'hui n'est pas tant le principe d'égalité des droits que la difficulté contemporaine à l'assurer dans la réalité. Crise économique, chômage, ségrégation urbaine associée à une répartition territoriale des inégalités sociales, ou encore la manière dont la xénophobie se banalise dans le discours politique sont quelques-uns des facteurs qui ont fait apparaître des pratiques et discours discriminatoires où « la culture d'origine » est souvent surinvestie et appréhendée de manière négative.
Aussi la question de l'« ethnicité », réduite à sa dimension politique étatico-nationale, a-t-elle pour effet de limiter la compréhension des réalités quotidiennes associées aux situations hiérarchisées dans lesquelles se jouent des relations interethniques. Plutôt que de s'intéresser aux prétendus « problèmes » que l'immigration pose, anthropologues, géographes, sociologues, mais aussi un juriste, une psycho-sociologue, un documentariste et un économiste ont choisi dans cet ouvrage d'interroger les enjeux auxquels ceux-ci renvoient.
Au fond, il s'agit de considérer que la « différence » des populations nommées « immigrées », « deuxième génération », « gens du voyage » existe moins en tant que telle, qu'elle est le résultat de rapports sociaux qui sont sociologiquement et historiquement construits entre différents acteurs, inscrits dans des rapports sociaux à un moment donné.
Aussi la question de l'« ethnicité », réduite à sa dimension politique étatico-nationale, a-t-elle pour effet de limiter la compréhension des réalités quotidiennes associées aux situations hiérarchisées dans lesquelles se jouent des relations interethniques. Plutôt que de s'intéresser aux prétendus « problèmes » que l'immigration pose, anthropologues, géographes, sociologues, mais aussi un juriste, une psycho-sociologue, un documentariste et un économiste ont choisi dans cet ouvrage d'interroger les enjeux auxquels ceux-ci renvoient.
Au fond, il s'agit de considérer que la « différence » des populations nommées « immigrées », « deuxième génération », « gens du voyage » existe moins en tant que telle, qu'elle est le résultat de rapports sociaux qui sont sociologiquement et historiquement construits entre différents acteurs, inscrits dans des rapports sociaux à un moment donné.
Depuis une vingtaine d'années, les discussions tantôt politiques, tantôt scientifiques autour du « modèle républicain français d'intégration » témoignent implicitement d'un malaise face à cette question, tout en les occultant dans la pratique. Finalement, ce qui pose problème aujourd'hui n'est pas tant le principe d'égalité des droits que la difficulté contemporaine à l'assurer dans la réalité. Crise économique, chômage, ségrégation urbaine associée à une répartition territoriale des inégalités sociales, ou encore la manière dont la xénophobie se banalise dans le discours politique sont quelques-uns des facteurs qui ont fait apparaître des pratiques et discours discriminatoires où « la culture d'origine » est souvent surinvestie et appréhendée de manière négative.
Aussi la question de l'« ethnicité », réduite à sa dimension politique étatico-nationale, a-t-elle pour effet de limiter la compréhension des réalités quotidiennes associées aux situations hiérarchisées dans lesquelles se jouent des relations interethniques. Plutôt que de s'intéresser aux prétendus « problèmes » que l'immigration pose, anthropologues, géographes, sociologues, mais aussi un juriste, une psycho-sociologue, un documentariste et un économiste ont choisi dans cet ouvrage d'interroger les enjeux auxquels ceux-ci renvoient.
Au fond, il s'agit de considérer que la « différence » des populations nommées « immigrées », « deuxième génération », « gens du voyage » existe moins en tant que telle, qu'elle est le résultat de rapports sociaux qui sont sociologiquement et historiquement construits entre différents acteurs, inscrits dans des rapports sociaux à un moment donné.
Aussi la question de l'« ethnicité », réduite à sa dimension politique étatico-nationale, a-t-elle pour effet de limiter la compréhension des réalités quotidiennes associées aux situations hiérarchisées dans lesquelles se jouent des relations interethniques. Plutôt que de s'intéresser aux prétendus « problèmes » que l'immigration pose, anthropologues, géographes, sociologues, mais aussi un juriste, une psycho-sociologue, un documentariste et un économiste ont choisi dans cet ouvrage d'interroger les enjeux auxquels ceux-ci renvoient.
Au fond, il s'agit de considérer que la « différence » des populations nommées « immigrées », « deuxième génération », « gens du voyage » existe moins en tant que telle, qu'elle est le résultat de rapports sociaux qui sont sociologiquement et historiquement construits entre différents acteurs, inscrits dans des rapports sociaux à un moment donné.