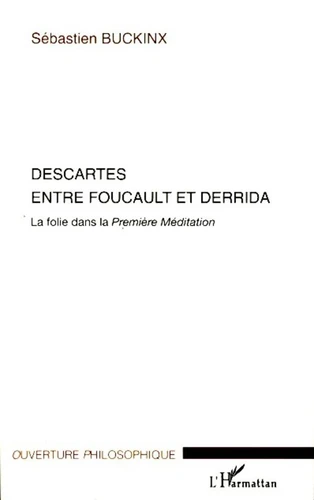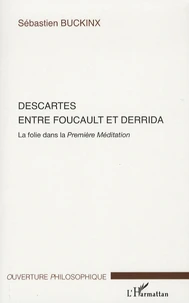Descartes entre Foucault et Derrida. La folie dans la Première Méditation
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages202
- FormatPDF
- ISBN978-2-296-20175-0
- EAN9782296201750
- Date de parution01/07/2008
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille5 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Lorsque Descartes rencontre la folie au cours de la première de ses Méditations, il ne semble pas faire grand cas des raisons de douter qu'elle suggère et la rejette aussitôt avec emphase - " Mais quoi ? ce sont des fous ; et je ne serais pas moins extravagant, si je me réglais sur leurs exemples " pour se tourner vers la voie, plus commune, du rêve. Dans sa thèse Histoire de la folie à l 'âge classique (1961), Michel Foucault interprète succinctement ce passage de Descartes comme l'un des signes de l'avènement d'une ratio classique, déterminée par l'exclusion de la folie et du fou.
Ce commentaire donne à Jacques Derrida la matière de sa conférence Cogito et histoire de la folie (1963) dans laquelle il entend montrer que, loin d'être préalablement rejetée, la folie traverse la première méditation jusqu'à l'évidence du Cogito, qui s'y affronte et trouve en elle la condition de sa possibilité. Cet ouvrage se propose d'une part d'examiner les mécanismes de ces lectures afin d'éclaircir le concept de folie au fondement du débat et, d'autre part, de le confronter au corpus cartésien.
Du premier mouvement émergeront deux folies opposées mais non cartésiennes et, du second, les présupposés communs aux commentaires foucaldien et derridien qu'une relecture des Méditations se doit de réinterroger.
Ce commentaire donne à Jacques Derrida la matière de sa conférence Cogito et histoire de la folie (1963) dans laquelle il entend montrer que, loin d'être préalablement rejetée, la folie traverse la première méditation jusqu'à l'évidence du Cogito, qui s'y affronte et trouve en elle la condition de sa possibilité. Cet ouvrage se propose d'une part d'examiner les mécanismes de ces lectures afin d'éclaircir le concept de folie au fondement du débat et, d'autre part, de le confronter au corpus cartésien.
Du premier mouvement émergeront deux folies opposées mais non cartésiennes et, du second, les présupposés communs aux commentaires foucaldien et derridien qu'une relecture des Méditations se doit de réinterroger.
Lorsque Descartes rencontre la folie au cours de la première de ses Méditations, il ne semble pas faire grand cas des raisons de douter qu'elle suggère et la rejette aussitôt avec emphase - " Mais quoi ? ce sont des fous ; et je ne serais pas moins extravagant, si je me réglais sur leurs exemples " pour se tourner vers la voie, plus commune, du rêve. Dans sa thèse Histoire de la folie à l 'âge classique (1961), Michel Foucault interprète succinctement ce passage de Descartes comme l'un des signes de l'avènement d'une ratio classique, déterminée par l'exclusion de la folie et du fou.
Ce commentaire donne à Jacques Derrida la matière de sa conférence Cogito et histoire de la folie (1963) dans laquelle il entend montrer que, loin d'être préalablement rejetée, la folie traverse la première méditation jusqu'à l'évidence du Cogito, qui s'y affronte et trouve en elle la condition de sa possibilité. Cet ouvrage se propose d'une part d'examiner les mécanismes de ces lectures afin d'éclaircir le concept de folie au fondement du débat et, d'autre part, de le confronter au corpus cartésien.
Du premier mouvement émergeront deux folies opposées mais non cartésiennes et, du second, les présupposés communs aux commentaires foucaldien et derridien qu'une relecture des Méditations se doit de réinterroger.
Ce commentaire donne à Jacques Derrida la matière de sa conférence Cogito et histoire de la folie (1963) dans laquelle il entend montrer que, loin d'être préalablement rejetée, la folie traverse la première méditation jusqu'à l'évidence du Cogito, qui s'y affronte et trouve en elle la condition de sa possibilité. Cet ouvrage se propose d'une part d'examiner les mécanismes de ces lectures afin d'éclaircir le concept de folie au fondement du débat et, d'autre part, de le confronter au corpus cartésien.
Du premier mouvement émergeront deux folies opposées mais non cartésiennes et, du second, les présupposés communs aux commentaires foucaldien et derridien qu'une relecture des Méditations se doit de réinterroger.