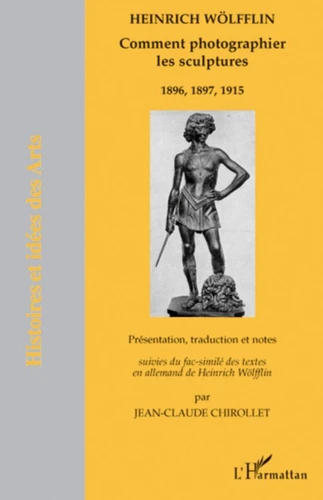Comment photographier les sculptures. 1896, 1897, 1915
Par : ,Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages98
- FormatPDF
- ISBN978-2-296-19689-6
- EAN9782296196896
- Date de parution01/05/2008
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille4 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Les trois articles peu connus - pour la première fois traduits en français et réédités en fac-similé - du célèbre historien de l'art suisse de langue allemande, Heinrich Wölfflin (1864 - 1945), intitulés Comment photographier les sculptures, furent publiés en Allemagne, à Leipzig, en 1896, 1897 et 1915. L'intérêt de ces textes est capital, puisqu'ils témoignent, pour la première fois dans l'histoire de l'art, d'une réflexion critique novatrice concernant la reproduction photographique des œuvres d'art anciennes.
Les images photographiques conditionnent aussi bien l'interprétation historique que la perception esthétique des œuvres d'art, et donc leur " réception " culturelle. Les techniques de traduction photographique influencent, notamment, le type de compréhension que la postérité peut avoir de l'art ancien. Heinrich Wölfflin annonçait, à travers ces réflexions critiques sur la photographie des sculptures (et plus généralement des arts plastiques), certains développements consacrés par la suite à ce phénomène, par Walter Benjamin et André Malraux, au vingtième siècle
Les images photographiques conditionnent aussi bien l'interprétation historique que la perception esthétique des œuvres d'art, et donc leur " réception " culturelle. Les techniques de traduction photographique influencent, notamment, le type de compréhension que la postérité peut avoir de l'art ancien. Heinrich Wölfflin annonçait, à travers ces réflexions critiques sur la photographie des sculptures (et plus généralement des arts plastiques), certains développements consacrés par la suite à ce phénomène, par Walter Benjamin et André Malraux, au vingtième siècle
Les trois articles peu connus - pour la première fois traduits en français et réédités en fac-similé - du célèbre historien de l'art suisse de langue allemande, Heinrich Wölfflin (1864 - 1945), intitulés Comment photographier les sculptures, furent publiés en Allemagne, à Leipzig, en 1896, 1897 et 1915. L'intérêt de ces textes est capital, puisqu'ils témoignent, pour la première fois dans l'histoire de l'art, d'une réflexion critique novatrice concernant la reproduction photographique des œuvres d'art anciennes.
Les images photographiques conditionnent aussi bien l'interprétation historique que la perception esthétique des œuvres d'art, et donc leur " réception " culturelle. Les techniques de traduction photographique influencent, notamment, le type de compréhension que la postérité peut avoir de l'art ancien. Heinrich Wölfflin annonçait, à travers ces réflexions critiques sur la photographie des sculptures (et plus généralement des arts plastiques), certains développements consacrés par la suite à ce phénomène, par Walter Benjamin et André Malraux, au vingtième siècle
Les images photographiques conditionnent aussi bien l'interprétation historique que la perception esthétique des œuvres d'art, et donc leur " réception " culturelle. Les techniques de traduction photographique influencent, notamment, le type de compréhension que la postérité peut avoir de l'art ancien. Heinrich Wölfflin annonçait, à travers ces réflexions critiques sur la photographie des sculptures (et plus généralement des arts plastiques), certains développements consacrés par la suite à ce phénomène, par Walter Benjamin et André Malraux, au vingtième siècle