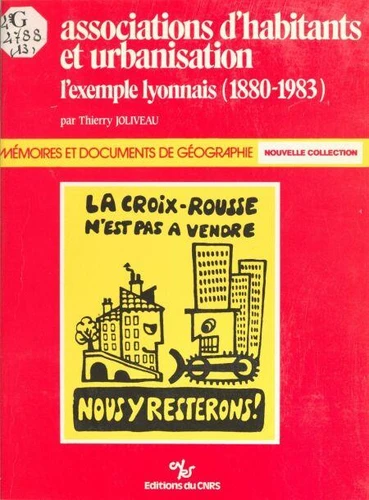Associations d'habitants et urbanisation : l'exemple lyonnais, 1880 - 1983
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages240
- FormatPDF
- ISBN2-271-10478-5
- EAN9782271104786
- Date de parution01/01/1987
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille109 Mo
- Infos supplémentairespdf
- ÉditeurCNRS Éditions (réédition numériq...
Résumé
Les associations d'habitants, qu'elles soient comités de quartier ou associations de défense du cadre de vie et de l'environnement, sont - depuis les années soixante-dix - à l'avant-scène des débats sur les politiques urbaines. Elles ont obtenu les faveurs aussi bien des journalistes, que des chercheurs. À Lyon, mais certainement aussi dans d'autres villes de France, elles ont une histoire bien plus ancienne que l'intérêt récent qu'elles suscitent.
En avoir une meilleure connaissance, devrait enrichir notre vision du processus d'urbanisation présent, passé et futur. La perspective historique permet de replacer l'action des associations contemporaines, dans une histoire qui la relativise tout en l'éclairant. Depuis la fin du siècle dernier, tout a changé : les modes de recrutement, et les caractéristiques sociales des membres, le type de fonctionnement interne ou de liaisons avec les autres groupes et avec les institutions locales, les formes d'action et la logique spatiale des interventions.
Et pourtant, une permanence sous-tend aussi cette histoire, et permet de dégager une « forme » associative aux caractères stables, dont les déterminants risquent de marquer durablement le futur. La perspective géographique est indispensable, car la logique fondamentale des associations est spatiale. Jusqu'ici, le processus de territorialisation dans l'espace lyonnais était peu connu, et peu étudié.
L'espace est à la fois objet et moyen de l'action des associations qui agissent à toutes les échelles : quartier, commune, agglomération, voire région. Ainsi, s'offre au géographe un champ d'analyse très riche sur la délimitation des espaces revendiqués, les images produites, les stratégies spatiales et sociales, qui conduisent l'action des associations. À la lumière du cas lyonnais, certaines analyses sociologiques sont réenvisagées, en particulier sur la naissance de la planification urbaine en France, la fonction des équipements collectifs en milieu urbain, et le rôle des classes moyennes dans l'élaboration et la mise en place des politiques urbaines.
En avoir une meilleure connaissance, devrait enrichir notre vision du processus d'urbanisation présent, passé et futur. La perspective historique permet de replacer l'action des associations contemporaines, dans une histoire qui la relativise tout en l'éclairant. Depuis la fin du siècle dernier, tout a changé : les modes de recrutement, et les caractéristiques sociales des membres, le type de fonctionnement interne ou de liaisons avec les autres groupes et avec les institutions locales, les formes d'action et la logique spatiale des interventions.
Et pourtant, une permanence sous-tend aussi cette histoire, et permet de dégager une « forme » associative aux caractères stables, dont les déterminants risquent de marquer durablement le futur. La perspective géographique est indispensable, car la logique fondamentale des associations est spatiale. Jusqu'ici, le processus de territorialisation dans l'espace lyonnais était peu connu, et peu étudié.
L'espace est à la fois objet et moyen de l'action des associations qui agissent à toutes les échelles : quartier, commune, agglomération, voire région. Ainsi, s'offre au géographe un champ d'analyse très riche sur la délimitation des espaces revendiqués, les images produites, les stratégies spatiales et sociales, qui conduisent l'action des associations. À la lumière du cas lyonnais, certaines analyses sociologiques sont réenvisagées, en particulier sur la naissance de la planification urbaine en France, la fonction des équipements collectifs en milieu urbain, et le rôle des classes moyennes dans l'élaboration et la mise en place des politiques urbaines.
Les associations d'habitants, qu'elles soient comités de quartier ou associations de défense du cadre de vie et de l'environnement, sont - depuis les années soixante-dix - à l'avant-scène des débats sur les politiques urbaines. Elles ont obtenu les faveurs aussi bien des journalistes, que des chercheurs. À Lyon, mais certainement aussi dans d'autres villes de France, elles ont une histoire bien plus ancienne que l'intérêt récent qu'elles suscitent.
En avoir une meilleure connaissance, devrait enrichir notre vision du processus d'urbanisation présent, passé et futur. La perspective historique permet de replacer l'action des associations contemporaines, dans une histoire qui la relativise tout en l'éclairant. Depuis la fin du siècle dernier, tout a changé : les modes de recrutement, et les caractéristiques sociales des membres, le type de fonctionnement interne ou de liaisons avec les autres groupes et avec les institutions locales, les formes d'action et la logique spatiale des interventions.
Et pourtant, une permanence sous-tend aussi cette histoire, et permet de dégager une « forme » associative aux caractères stables, dont les déterminants risquent de marquer durablement le futur. La perspective géographique est indispensable, car la logique fondamentale des associations est spatiale. Jusqu'ici, le processus de territorialisation dans l'espace lyonnais était peu connu, et peu étudié.
L'espace est à la fois objet et moyen de l'action des associations qui agissent à toutes les échelles : quartier, commune, agglomération, voire région. Ainsi, s'offre au géographe un champ d'analyse très riche sur la délimitation des espaces revendiqués, les images produites, les stratégies spatiales et sociales, qui conduisent l'action des associations. À la lumière du cas lyonnais, certaines analyses sociologiques sont réenvisagées, en particulier sur la naissance de la planification urbaine en France, la fonction des équipements collectifs en milieu urbain, et le rôle des classes moyennes dans l'élaboration et la mise en place des politiques urbaines.
En avoir une meilleure connaissance, devrait enrichir notre vision du processus d'urbanisation présent, passé et futur. La perspective historique permet de replacer l'action des associations contemporaines, dans une histoire qui la relativise tout en l'éclairant. Depuis la fin du siècle dernier, tout a changé : les modes de recrutement, et les caractéristiques sociales des membres, le type de fonctionnement interne ou de liaisons avec les autres groupes et avec les institutions locales, les formes d'action et la logique spatiale des interventions.
Et pourtant, une permanence sous-tend aussi cette histoire, et permet de dégager une « forme » associative aux caractères stables, dont les déterminants risquent de marquer durablement le futur. La perspective géographique est indispensable, car la logique fondamentale des associations est spatiale. Jusqu'ici, le processus de territorialisation dans l'espace lyonnais était peu connu, et peu étudié.
L'espace est à la fois objet et moyen de l'action des associations qui agissent à toutes les échelles : quartier, commune, agglomération, voire région. Ainsi, s'offre au géographe un champ d'analyse très riche sur la délimitation des espaces revendiqués, les images produites, les stratégies spatiales et sociales, qui conduisent l'action des associations. À la lumière du cas lyonnais, certaines analyses sociologiques sont réenvisagées, en particulier sur la naissance de la planification urbaine en France, la fonction des équipements collectifs en milieu urbain, et le rôle des classes moyennes dans l'élaboration et la mise en place des politiques urbaines.