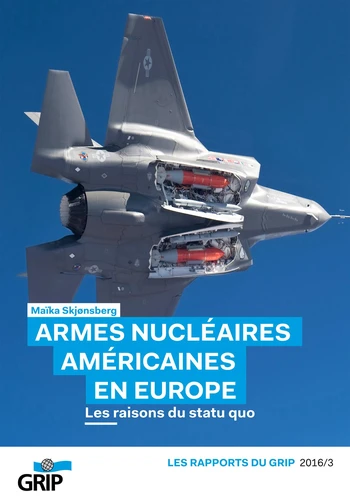Armes nucléaires américaines en europe. Les raisons du statu quo
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format Multi-format est :
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages48
- FormatMulti-format
- ISBN978-2-87291-051-9
- EAN9782872910519
- Date de parution21/04/2016
- Protection num.NC
- Infos supplémentairesMulti-format incluant ePub avec ...
- ÉditeurGRIP
Résumé
Le nombre d'armes nucléaires américaines déployées en Europe a diminué de 97 % depuis les années 1970. Toutefois, il reste encore aujourd'hui environ 180 bombes nucléaires américaines dans cinq pays européens : Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Italie et Turquie. Pourtant, ces armes nucléaires tactiques, de courte portée, n'ont aucune utilité militaire. La capacité de dissuasion de l'OTAN ne serait en rien affectée par leur retrait.
Alors pourquoi sont-elles encore là en 2016 ? Il existe actuellement un alignement d'intérêts, à différents niveaux et pour de multiples raisons, qui régit le maintien de ces armes nucléaires. Un réseau d'acteurs composé des États-Unis, de l'appareil bureaucratique de l'OTAN, des deux puissances nucléaires européennes de l'Alliance - la France et le Royaume-Uni - et des États accueillant les bombes, soutient leur déploiement en Europe. Le complexe militaro-industriel américain, en raison de ses intérêts économiques et bureaucratiques, maintient un intense lobbying pour la présence et la modernisation des armes nucléaires américaines en Europe.
L'administration américaine a ainsi fait en sorte de véhiculer l'idée selon laquelle le déploiement d'armes nucléaires en Europe est essentiel pour l'OTAN. Soucieux de leurs propres intérêts, la France et le Royaume-Uni ont également renforcé ce discours sur la nécessité d'une alliance nucléaire dotée d'un partage des risques et des responsabilités. Les gouvernements allemand, belge et néerlandais refusent quant à eux de se prononcer pour un retrait des bombes.
Ils ne veulent pas être perçus comme « le maillon faible » de l'Alliance et n'ont pas de pressions politiques internes assez fortes pour s'engager dans ce dur et long combat.
Alors pourquoi sont-elles encore là en 2016 ? Il existe actuellement un alignement d'intérêts, à différents niveaux et pour de multiples raisons, qui régit le maintien de ces armes nucléaires. Un réseau d'acteurs composé des États-Unis, de l'appareil bureaucratique de l'OTAN, des deux puissances nucléaires européennes de l'Alliance - la France et le Royaume-Uni - et des États accueillant les bombes, soutient leur déploiement en Europe. Le complexe militaro-industriel américain, en raison de ses intérêts économiques et bureaucratiques, maintient un intense lobbying pour la présence et la modernisation des armes nucléaires américaines en Europe.
L'administration américaine a ainsi fait en sorte de véhiculer l'idée selon laquelle le déploiement d'armes nucléaires en Europe est essentiel pour l'OTAN. Soucieux de leurs propres intérêts, la France et le Royaume-Uni ont également renforcé ce discours sur la nécessité d'une alliance nucléaire dotée d'un partage des risques et des responsabilités. Les gouvernements allemand, belge et néerlandais refusent quant à eux de se prononcer pour un retrait des bombes.
Ils ne veulent pas être perçus comme « le maillon faible » de l'Alliance et n'ont pas de pressions politiques internes assez fortes pour s'engager dans ce dur et long combat.
Le nombre d'armes nucléaires américaines déployées en Europe a diminué de 97 % depuis les années 1970. Toutefois, il reste encore aujourd'hui environ 180 bombes nucléaires américaines dans cinq pays européens : Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Italie et Turquie. Pourtant, ces armes nucléaires tactiques, de courte portée, n'ont aucune utilité militaire. La capacité de dissuasion de l'OTAN ne serait en rien affectée par leur retrait.
Alors pourquoi sont-elles encore là en 2016 ? Il existe actuellement un alignement d'intérêts, à différents niveaux et pour de multiples raisons, qui régit le maintien de ces armes nucléaires. Un réseau d'acteurs composé des États-Unis, de l'appareil bureaucratique de l'OTAN, des deux puissances nucléaires européennes de l'Alliance - la France et le Royaume-Uni - et des États accueillant les bombes, soutient leur déploiement en Europe. Le complexe militaro-industriel américain, en raison de ses intérêts économiques et bureaucratiques, maintient un intense lobbying pour la présence et la modernisation des armes nucléaires américaines en Europe.
L'administration américaine a ainsi fait en sorte de véhiculer l'idée selon laquelle le déploiement d'armes nucléaires en Europe est essentiel pour l'OTAN. Soucieux de leurs propres intérêts, la France et le Royaume-Uni ont également renforcé ce discours sur la nécessité d'une alliance nucléaire dotée d'un partage des risques et des responsabilités. Les gouvernements allemand, belge et néerlandais refusent quant à eux de se prononcer pour un retrait des bombes.
Ils ne veulent pas être perçus comme « le maillon faible » de l'Alliance et n'ont pas de pressions politiques internes assez fortes pour s'engager dans ce dur et long combat.
Alors pourquoi sont-elles encore là en 2016 ? Il existe actuellement un alignement d'intérêts, à différents niveaux et pour de multiples raisons, qui régit le maintien de ces armes nucléaires. Un réseau d'acteurs composé des États-Unis, de l'appareil bureaucratique de l'OTAN, des deux puissances nucléaires européennes de l'Alliance - la France et le Royaume-Uni - et des États accueillant les bombes, soutient leur déploiement en Europe. Le complexe militaro-industriel américain, en raison de ses intérêts économiques et bureaucratiques, maintient un intense lobbying pour la présence et la modernisation des armes nucléaires américaines en Europe.
L'administration américaine a ainsi fait en sorte de véhiculer l'idée selon laquelle le déploiement d'armes nucléaires en Europe est essentiel pour l'OTAN. Soucieux de leurs propres intérêts, la France et le Royaume-Uni ont également renforcé ce discours sur la nécessité d'une alliance nucléaire dotée d'un partage des risques et des responsabilités. Les gouvernements allemand, belge et néerlandais refusent quant à eux de se prononcer pour un retrait des bombes.
Ils ne veulent pas être perçus comme « le maillon faible » de l'Alliance et n'ont pas de pressions politiques internes assez fortes pour s'engager dans ce dur et long combat.