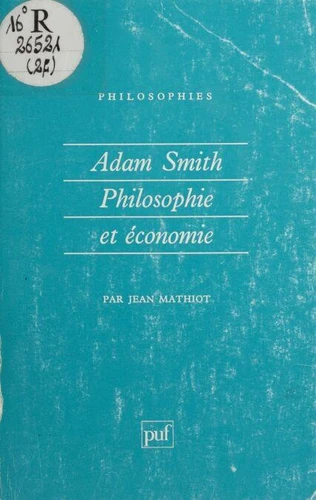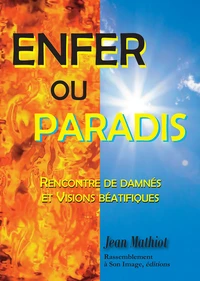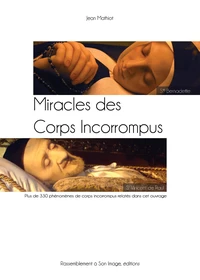Adam Smith, philosophie et économie. De la sympathie à l'échange
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages128
- FormatePub
- ISBN2-13-066520-9
- EAN9782130665205
- Date de parution31/12/1989
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille31 Mo
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurPresses universitaires de France...
Résumé
La plupart des débats contemporains concernant l'individualisme ou le libéralisme économiques nous ramènent, inévitablement, de l'aveu de chacun, à Adam Smith, le fondateur. Pourtant, cette quête des racines est souvent stérile : piégée par une reconnaissance sociale qui l'érige en discipline séparée, l'économie politique ressent comme une contradiction l'épreuve de sa mise en rapport avec d'autres savoirs.
Le présent travail, qui se veut proche des textes smithiens, conduit à la conclusion qu'un autre regard est, non seulement souhaitable, mais encore nécessaire. Smith, invoqué comme l'auteur de la séparation entre philosophie et économie politique est plutôt, à y regarder de près, celui qui nous enseigne qu'elles partagent une rationalité commune. Tel est l'enjeu de la compréhension du fameux paradoxe : comment Smith, théoricien d'une philosophie morale de la sympathie (principe d'intérêt pour autrui), peut-il être aussi celui d'une économie de l'intérêt propre de chacun ? N'est-ce pas aussi en rupture avec leur acception philosophique que les concepts de travail, d'échange, de division du travail deviennent des concepts efficaces ? La constatation qui se dégage de ce travail (qui devrait se prolonger pour les autres fondateurs, Cournot, Walras, Marx, Marshall, Keynes...) est surprenante : cette rupture apparente doit se penser dans une communauté de rationalité plus profonde.
L'économie politique ne jouit pas d'un douteux privilège d'extra-territorialité, ni par rapport à la philosophie ni, plus généralement, par rapport aux formes que revêt la représentation de la pratique humaine.
Le présent travail, qui se veut proche des textes smithiens, conduit à la conclusion qu'un autre regard est, non seulement souhaitable, mais encore nécessaire. Smith, invoqué comme l'auteur de la séparation entre philosophie et économie politique est plutôt, à y regarder de près, celui qui nous enseigne qu'elles partagent une rationalité commune. Tel est l'enjeu de la compréhension du fameux paradoxe : comment Smith, théoricien d'une philosophie morale de la sympathie (principe d'intérêt pour autrui), peut-il être aussi celui d'une économie de l'intérêt propre de chacun ? N'est-ce pas aussi en rupture avec leur acception philosophique que les concepts de travail, d'échange, de division du travail deviennent des concepts efficaces ? La constatation qui se dégage de ce travail (qui devrait se prolonger pour les autres fondateurs, Cournot, Walras, Marx, Marshall, Keynes...) est surprenante : cette rupture apparente doit se penser dans une communauté de rationalité plus profonde.
L'économie politique ne jouit pas d'un douteux privilège d'extra-territorialité, ni par rapport à la philosophie ni, plus généralement, par rapport aux formes que revêt la représentation de la pratique humaine.
La plupart des débats contemporains concernant l'individualisme ou le libéralisme économiques nous ramènent, inévitablement, de l'aveu de chacun, à Adam Smith, le fondateur. Pourtant, cette quête des racines est souvent stérile : piégée par une reconnaissance sociale qui l'érige en discipline séparée, l'économie politique ressent comme une contradiction l'épreuve de sa mise en rapport avec d'autres savoirs.
Le présent travail, qui se veut proche des textes smithiens, conduit à la conclusion qu'un autre regard est, non seulement souhaitable, mais encore nécessaire. Smith, invoqué comme l'auteur de la séparation entre philosophie et économie politique est plutôt, à y regarder de près, celui qui nous enseigne qu'elles partagent une rationalité commune. Tel est l'enjeu de la compréhension du fameux paradoxe : comment Smith, théoricien d'une philosophie morale de la sympathie (principe d'intérêt pour autrui), peut-il être aussi celui d'une économie de l'intérêt propre de chacun ? N'est-ce pas aussi en rupture avec leur acception philosophique que les concepts de travail, d'échange, de division du travail deviennent des concepts efficaces ? La constatation qui se dégage de ce travail (qui devrait se prolonger pour les autres fondateurs, Cournot, Walras, Marx, Marshall, Keynes...) est surprenante : cette rupture apparente doit se penser dans une communauté de rationalité plus profonde.
L'économie politique ne jouit pas d'un douteux privilège d'extra-territorialité, ni par rapport à la philosophie ni, plus généralement, par rapport aux formes que revêt la représentation de la pratique humaine.
Le présent travail, qui se veut proche des textes smithiens, conduit à la conclusion qu'un autre regard est, non seulement souhaitable, mais encore nécessaire. Smith, invoqué comme l'auteur de la séparation entre philosophie et économie politique est plutôt, à y regarder de près, celui qui nous enseigne qu'elles partagent une rationalité commune. Tel est l'enjeu de la compréhension du fameux paradoxe : comment Smith, théoricien d'une philosophie morale de la sympathie (principe d'intérêt pour autrui), peut-il être aussi celui d'une économie de l'intérêt propre de chacun ? N'est-ce pas aussi en rupture avec leur acception philosophique que les concepts de travail, d'échange, de division du travail deviennent des concepts efficaces ? La constatation qui se dégage de ce travail (qui devrait se prolonger pour les autres fondateurs, Cournot, Walras, Marx, Marshall, Keynes...) est surprenante : cette rupture apparente doit se penser dans une communauté de rationalité plus profonde.
L'économie politique ne jouit pas d'un douteux privilège d'extra-territorialité, ni par rapport à la philosophie ni, plus généralement, par rapport aux formes que revêt la représentation de la pratique humaine.