- Accueil /
- Frank Braemer
Frank Braemer

Dernière sortie
Hauran V
Après une phase d'exploration très fructueuse, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, suivie d'une longue période de désintérêt de la part de la communauté scientifique, les études archéologiques dans le Hauran et les régions environnantes ont repris en 1974. La publication du recueil Hauran I (1985-1986), puis celle des actes du colloque réuni à Suweida en 1990 par la DGAMS (1997), faisaient connaître un ensemble de contributions pluridisciplinaires qui dressait un état des connaissances et relançait les principaux corpus et inventaires en cours portant sur l'épigraphie, l'architecture et la céramique régionales.
En 2007, le colloque de Damas a montré d'abord combien se sont multipliées les interventions sur le terrain, qu'il s'agisse d'études de site ou de programmes thématiques régionaux. Les projets Balnéorient et Atlas des sites pré- et protohistoriques de Syrie du Sud ou encore l'inventaire des maisons villageoises d'époque romaine permettent ainsi d'aborder de manière nouvelle, sur la longue durée, les questions de l'occupation du sol et du développement local, de l'urbanisme et de l'architecture.
Des corpus d'études sur les périodes pré- et protohistorique ont aussi été constitués. En une vingtaine d'années, on est passé de la collecte d'informations relativement ponctuelles, recueillies sur des sites éloignés les uns des autres, à une recherche de terrain plus dense et systématique, fouilles et prospections confondues, dont les résultats permettent de donner aujourd'hui à la Syrie du Sud une place tout à fait significative, à l'échelle du Levant Sud, de la période natoufienne à l'âge du Fer.
Pour les époques hellénistique, romaine et byzantine, les études archéologiques et d'histoire régionale, conduites sur la longue durée, portent toujours sur le contexte de l'occupation humaine, rurale ou urbaine. Elles abordent la question des ressources offertes par le milieu géographique, de son ouverture à différents groupes de population et des interactions qui en résultent : conflits territoriaux, échanges commerciaux à longue distance, établissement d'itinéraires caravaniers qui peuvent susciter le brigandage.
Des réponses neuves sont apportées à des questions ouvertes depuis la reprise des recherches sur la région. On perçoit mieux maintenant la transition entre l'âge du Fer et la nouvelle phase de développement qui débute à l'époque hellénistique. A partir de l'époque nabatéenne, puis pour l'époque romaine, le répertoire des décors architecturaux, confrontés à d'autres données de nature épigraphique ou archéologique, constitue localement un marqueur chronologique précis.
Le corpus régional des arts plastiques apporte de nouvelles bases à son interprétation. Dans les sanctuaires, des fouilles révèlent l'organisation du culte et des pratiques rituelles. Notre connaissance et notre interprétation des villes et des agglomérations sont désormais éclairées par la prise en compte du développement urbain sur une durée plus longue que la pério
En 2007, le colloque de Damas a montré d'abord combien se sont multipliées les interventions sur le terrain, qu'il s'agisse d'études de site ou de programmes thématiques régionaux. Les projets Balnéorient et Atlas des sites pré- et protohistoriques de Syrie du Sud ou encore l'inventaire des maisons villageoises d'époque romaine permettent ainsi d'aborder de manière nouvelle, sur la longue durée, les questions de l'occupation du sol et du développement local, de l'urbanisme et de l'architecture.
Des corpus d'études sur les périodes pré- et protohistorique ont aussi été constitués. En une vingtaine d'années, on est passé de la collecte d'informations relativement ponctuelles, recueillies sur des sites éloignés les uns des autres, à une recherche de terrain plus dense et systématique, fouilles et prospections confondues, dont les résultats permettent de donner aujourd'hui à la Syrie du Sud une place tout à fait significative, à l'échelle du Levant Sud, de la période natoufienne à l'âge du Fer.
Pour les époques hellénistique, romaine et byzantine, les études archéologiques et d'histoire régionale, conduites sur la longue durée, portent toujours sur le contexte de l'occupation humaine, rurale ou urbaine. Elles abordent la question des ressources offertes par le milieu géographique, de son ouverture à différents groupes de population et des interactions qui en résultent : conflits territoriaux, échanges commerciaux à longue distance, établissement d'itinéraires caravaniers qui peuvent susciter le brigandage.
Des réponses neuves sont apportées à des questions ouvertes depuis la reprise des recherches sur la région. On perçoit mieux maintenant la transition entre l'âge du Fer et la nouvelle phase de développement qui débute à l'époque hellénistique. A partir de l'époque nabatéenne, puis pour l'époque romaine, le répertoire des décors architecturaux, confrontés à d'autres données de nature épigraphique ou archéologique, constitue localement un marqueur chronologique précis.
Le corpus régional des arts plastiques apporte de nouvelles bases à son interprétation. Dans les sanctuaires, des fouilles révèlent l'organisation du culte et des pratiques rituelles. Notre connaissance et notre interprétation des villes et des agglomérations sont désormais éclairées par la prise en compte du développement urbain sur une durée plus longue que la pério
Après une phase d'exploration très fructueuse, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, suivie d'une longue période de désintérêt de la part de la communauté scientifique, les études archéologiques dans le Hauran et les régions environnantes ont repris en 1974. La publication du recueil Hauran I (1985-1986), puis celle des actes du colloque réuni à Suweida en 1990 par la DGAMS (1997), faisaient connaître un ensemble de contributions pluridisciplinaires qui dressait un état des connaissances et relançait les principaux corpus et inventaires en cours portant sur l'épigraphie, l'architecture et la céramique régionales.
En 2007, le colloque de Damas a montré d'abord combien se sont multipliées les interventions sur le terrain, qu'il s'agisse d'études de site ou de programmes thématiques régionaux. Les projets Balnéorient et Atlas des sites pré- et protohistoriques de Syrie du Sud ou encore l'inventaire des maisons villageoises d'époque romaine permettent ainsi d'aborder de manière nouvelle, sur la longue durée, les questions de l'occupation du sol et du développement local, de l'urbanisme et de l'architecture.
Des corpus d'études sur les périodes pré- et protohistorique ont aussi été constitués. En une vingtaine d'années, on est passé de la collecte d'informations relativement ponctuelles, recueillies sur des sites éloignés les uns des autres, à une recherche de terrain plus dense et systématique, fouilles et prospections confondues, dont les résultats permettent de donner aujourd'hui à la Syrie du Sud une place tout à fait significative, à l'échelle du Levant Sud, de la période natoufienne à l'âge du Fer.
Pour les époques hellénistique, romaine et byzantine, les études archéologiques et d'histoire régionale, conduites sur la longue durée, portent toujours sur le contexte de l'occupation humaine, rurale ou urbaine. Elles abordent la question des ressources offertes par le milieu géographique, de son ouverture à différents groupes de population et des interactions qui en résultent : conflits territoriaux, échanges commerciaux à longue distance, établissement d'itinéraires caravaniers qui peuvent susciter le brigandage.
Des réponses neuves sont apportées à des questions ouvertes depuis la reprise des recherches sur la région. On perçoit mieux maintenant la transition entre l'âge du Fer et la nouvelle phase de développement qui débute à l'époque hellénistique. A partir de l'époque nabatéenne, puis pour l'époque romaine, le répertoire des décors architecturaux, confrontés à d'autres données de nature épigraphique ou archéologique, constitue localement un marqueur chronologique précis.
Le corpus régional des arts plastiques apporte de nouvelles bases à son interprétation. Dans les sanctuaires, des fouilles révèlent l'organisation du culte et des pratiques rituelles. Notre connaissance et notre interprétation des villes et des agglomérations sont désormais éclairées par la prise en compte du développement urbain sur une durée plus longue que la pério
En 2007, le colloque de Damas a montré d'abord combien se sont multipliées les interventions sur le terrain, qu'il s'agisse d'études de site ou de programmes thématiques régionaux. Les projets Balnéorient et Atlas des sites pré- et protohistoriques de Syrie du Sud ou encore l'inventaire des maisons villageoises d'époque romaine permettent ainsi d'aborder de manière nouvelle, sur la longue durée, les questions de l'occupation du sol et du développement local, de l'urbanisme et de l'architecture.
Des corpus d'études sur les périodes pré- et protohistorique ont aussi été constitués. En une vingtaine d'années, on est passé de la collecte d'informations relativement ponctuelles, recueillies sur des sites éloignés les uns des autres, à une recherche de terrain plus dense et systématique, fouilles et prospections confondues, dont les résultats permettent de donner aujourd'hui à la Syrie du Sud une place tout à fait significative, à l'échelle du Levant Sud, de la période natoufienne à l'âge du Fer.
Pour les époques hellénistique, romaine et byzantine, les études archéologiques et d'histoire régionale, conduites sur la longue durée, portent toujours sur le contexte de l'occupation humaine, rurale ou urbaine. Elles abordent la question des ressources offertes par le milieu géographique, de son ouverture à différents groupes de population et des interactions qui en résultent : conflits territoriaux, échanges commerciaux à longue distance, établissement d'itinéraires caravaniers qui peuvent susciter le brigandage.
Des réponses neuves sont apportées à des questions ouvertes depuis la reprise des recherches sur la région. On perçoit mieux maintenant la transition entre l'âge du Fer et la nouvelle phase de développement qui débute à l'époque hellénistique. A partir de l'époque nabatéenne, puis pour l'époque romaine, le répertoire des décors architecturaux, confrontés à d'autres données de nature épigraphique ou archéologique, constitue localement un marqueur chronologique précis.
Le corpus régional des arts plastiques apporte de nouvelles bases à son interprétation. Dans les sanctuaires, des fouilles révèlent l'organisation du culte et des pratiques rituelles. Notre connaissance et notre interprétation des villes et des agglomérations sont désormais éclairées par la prise en compte du développement urbain sur une durée plus longue que la pério
Les livres de Frank Braemer

Khirbet al Umbashi. Villages et campements de pasteurs dans le "désert noir" (Syrie) à l'âge du Bronze
Frank Braemer, Jean-Claude Echallier, Ahmad Taraqji
E-book
9,99 €
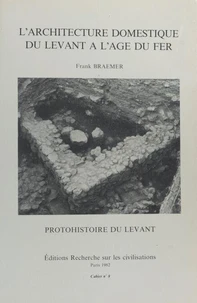
8,99 €

8,99 €

Hauran V. La Syrie du Sud du Néolithique à l'Antiquité tardive : recherches récentes Volume 2
Michel Al-Maqdissi, Frank Braemer, Jean-Marie Dentzer, Eva Ishaq
40,00 €

Hauran V. La Syrie du Sud du Néolithique à l'Antiquité tardive : recherches récentes Volume 1
Michel Al-Maqdissi, Frank Braemer, Jean-Marie Dentzer
65,00 €


Khirbet al Umbashi. Villages et campements de pasteurs dans le "désert noir" (Syrie) à l'âge du Bronze
Frank Braemer, Jean-Claude Echallier, Ahmad Taraqji
43,00 €

40,00 €
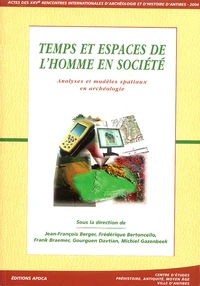
Temps et espaces de l'homme en société. Analyses et modèles spatiaux en archéologie
avec 1 Cédérom
Jean-François Berger, Frank Braemer, Frédérique Bertoncello, Gourguen Davtian, Michiel Gazenbeek
45,00 €

35,00 €
