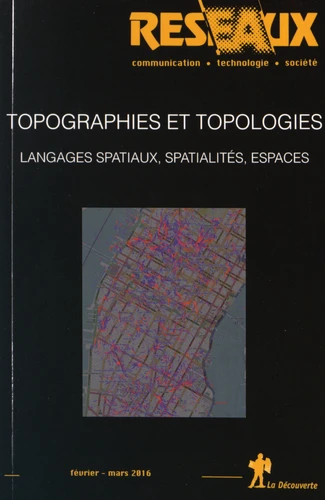Réseaux N° 195, Février-mars 2016
Topographies et topologies. Langages spatiaux, spatialités, espaces
Par : , Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Nombre de pages252
- PrésentationBroché
- Poids0.402 kg
- Dimensions16,1 cm × 24,0 cm × 1,5 cm
- ISBN978-2-7071-8960-8
- EAN9782707189608
- Date de parution24/03/2016
- ÉditeurLa Découverte
Résumé
La prolifération des cartes et des usages du terme " cartographie " ont produit une forme d'évidence des codes de représentation visuelle de l'information, supposés s'adapter à tout : espaces, spatialités, topographies, topologies, territoires, réseaux, graphes etc. Ces technologies cognitives ont pourtant une longue histoire. En travaillant sur les langages spatiaux, ce numéro aborde aussi, inévitablement, les grandes questions liées à la dimension spatiale des mondes sociaux.
La prolifération des cartes et des usages du terme " cartographie " ont produit une forme d'évidence des codes de représentation visuelle de l'information qui seraient supposés s'adapter à tout : espaces, spatialités, topographies, topologies, territoires, réseaux, graphes, images de graphes, etc. Ces technologies cognitives ont pourtant une longue histoire. Celle-ci a permis de produire des conventions qui possèdent leurs limites de validité, et peuvent donc être modifiées mais pas oubliées.
Par ailleurs, la diversification des producteurs d'imagerie spatiale contribue à enrichir mais aussi à brouiller les codes de la communication visuelle, rendant possibles malentendus et fausses pistes. Les sciences sociales font un usage abondant de toutes ces ressources visuelles pour exploiter des données de plus en plus nombreuses sans pour autant prendre toujours le temps d'expliciter leurs choix et les conséquences sur l'activité de recherche elle-même.
La prolifération des cartes et des usages du terme " cartographie " ont produit une forme d'évidence des codes de représentation visuelle de l'information qui seraient supposés s'adapter à tout : espaces, spatialités, topographies, topologies, territoires, réseaux, graphes, images de graphes, etc. Ces technologies cognitives ont pourtant une longue histoire. Celle-ci a permis de produire des conventions qui possèdent leurs limites de validité, et peuvent donc être modifiées mais pas oubliées.
Par ailleurs, la diversification des producteurs d'imagerie spatiale contribue à enrichir mais aussi à brouiller les codes de la communication visuelle, rendant possibles malentendus et fausses pistes. Les sciences sociales font un usage abondant de toutes ces ressources visuelles pour exploiter des données de plus en plus nombreuses sans pour autant prendre toujours le temps d'expliciter leurs choix et les conséquences sur l'activité de recherche elle-même.
La prolifération des cartes et des usages du terme " cartographie " ont produit une forme d'évidence des codes de représentation visuelle de l'information, supposés s'adapter à tout : espaces, spatialités, topographies, topologies, territoires, réseaux, graphes etc. Ces technologies cognitives ont pourtant une longue histoire. En travaillant sur les langages spatiaux, ce numéro aborde aussi, inévitablement, les grandes questions liées à la dimension spatiale des mondes sociaux.
La prolifération des cartes et des usages du terme " cartographie " ont produit une forme d'évidence des codes de représentation visuelle de l'information qui seraient supposés s'adapter à tout : espaces, spatialités, topographies, topologies, territoires, réseaux, graphes, images de graphes, etc. Ces technologies cognitives ont pourtant une longue histoire. Celle-ci a permis de produire des conventions qui possèdent leurs limites de validité, et peuvent donc être modifiées mais pas oubliées.
Par ailleurs, la diversification des producteurs d'imagerie spatiale contribue à enrichir mais aussi à brouiller les codes de la communication visuelle, rendant possibles malentendus et fausses pistes. Les sciences sociales font un usage abondant de toutes ces ressources visuelles pour exploiter des données de plus en plus nombreuses sans pour autant prendre toujours le temps d'expliciter leurs choix et les conséquences sur l'activité de recherche elle-même.
La prolifération des cartes et des usages du terme " cartographie " ont produit une forme d'évidence des codes de représentation visuelle de l'information qui seraient supposés s'adapter à tout : espaces, spatialités, topographies, topologies, territoires, réseaux, graphes, images de graphes, etc. Ces technologies cognitives ont pourtant une longue histoire. Celle-ci a permis de produire des conventions qui possèdent leurs limites de validité, et peuvent donc être modifiées mais pas oubliées.
Par ailleurs, la diversification des producteurs d'imagerie spatiale contribue à enrichir mais aussi à brouiller les codes de la communication visuelle, rendant possibles malentendus et fausses pistes. Les sciences sociales font un usage abondant de toutes ces ressources visuelles pour exploiter des données de plus en plus nombreuses sans pour autant prendre toujours le temps d'expliciter leurs choix et les conséquences sur l'activité de recherche elle-même.