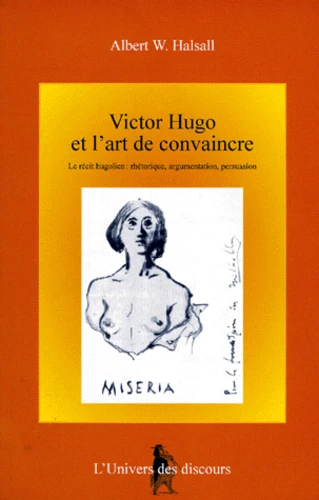Victor Hugo Et L'Art De Convaincre. Le Recit Hugolien, Rhetorique, Argumentation, Persuasion
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Nombre de pages496
- PrésentationBroché
- Poids0.645 kg
- Dimensions14,0 cm × 21,5 cm × 3,0 cm
- ISBN2-921425-61-0
- EAN9782921425612
- Date de parution01/04/1995
- CollectionL'univers des discours
- ÉditeurBalzac éditeur
Résumé
Cet ouvrage propose un modèle narratologique sémio-rhétorique. L'étude de la pragmatique narrative nécessite une méthode qui explique autant la production que la réception virtuelle du récit, c'est-à-dire qu'elle doit en expliquer les mécanismes persuasifs. L'analyse de l'éthos, du pathos et du Jogos narratifs expose la fonction pragmatique de récits qui combinent une rhétorique à fonction persuasive avec une logique à fonction sémiotique.
Ayant déjà proposé, dans l'Art de convaincre, une méthode rhétorique pour analyser la pragmatique narrative, la seconde étape consiste à montrer empiriquement la validité d'une telle méthode par l'application systématique qu'on en fait sur un corpus narratif spécifique, en l'occurrence les romans de Victor Hugo.
A la fois ennemi déclaré (" Guerre à la rhétorique ") et ami enthousiaste (" Ces divines éclosions de l'esprit que les grecs appelaient Tropes ") de la rhétorique classique, Hugo souscrivait à la doctrine de " l'Utilité du Beau ". Qu'il s'agisse du désir d'améliorer le sort des pauvres (Les Misérables, L'Homme qui rit), ou d'abolir la peine capitale (Le Dernier Jour d'un condamné à mort), l'argumentation rhétorique lui offrait les stratégies discursives (éthiques, pathiques, logiques) nécessaires à la persuasion. A des degrés différents, chacun de ses romans possède les traits génériques caractéristiques de l'exemplum, c'est-à-dire du récit exemplaire.
Cet ouvrage propose un modèle narratologique sémio-rhétorique. L'étude de la pragmatique narrative nécessite une méthode qui explique autant la production que la réception virtuelle du récit, c'est-à-dire qu'elle doit en expliquer les mécanismes persuasifs. L'analyse de l'éthos, du pathos et du Jogos narratifs expose la fonction pragmatique de récits qui combinent une rhétorique à fonction persuasive avec une logique à fonction sémiotique.
Ayant déjà proposé, dans l'Art de convaincre, une méthode rhétorique pour analyser la pragmatique narrative, la seconde étape consiste à montrer empiriquement la validité d'une telle méthode par l'application systématique qu'on en fait sur un corpus narratif spécifique, en l'occurrence les romans de Victor Hugo.
A la fois ennemi déclaré (" Guerre à la rhétorique ") et ami enthousiaste (" Ces divines éclosions de l'esprit que les grecs appelaient Tropes ") de la rhétorique classique, Hugo souscrivait à la doctrine de " l'Utilité du Beau ". Qu'il s'agisse du désir d'améliorer le sort des pauvres (Les Misérables, L'Homme qui rit), ou d'abolir la peine capitale (Le Dernier Jour d'un condamné à mort), l'argumentation rhétorique lui offrait les stratégies discursives (éthiques, pathiques, logiques) nécessaires à la persuasion. A des degrés différents, chacun de ses romans possède les traits génériques caractéristiques de l'exemplum, c'est-à-dire du récit exemplaire.