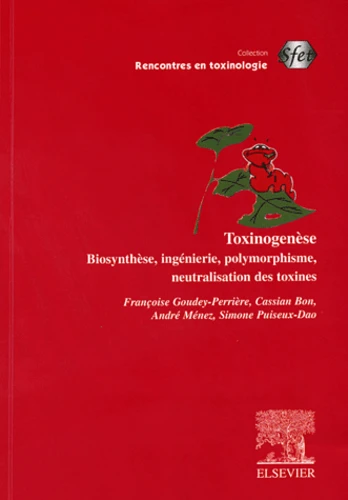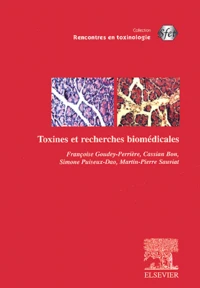Toxinogenèse. Biosynthèse, ingénierie, polymorphisme, neutralisation des toxines
Par : , , ,Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages192
- PrésentationBroché
- Poids0.36 kg
- Dimensions17,0 cm × 24,0 cm × 1,2 cm
- ISBN2-84299-481-7
- EAN9782842994815
- Date de parution04/12/2003
- CollectionRencontres en toxinologie
- ÉditeurElsevier Masson
Résumé
Les travaux fondateurs de Claude Bernard, au milieu du XIXe siècle, ont ancré la notion maintenant familière de toxines considérées comme outils pharmacologiques d'une incomparable précision aujourd'hui encore les toxines bloqueurs de canaux ioniques, par exemple, apportent une contribution irremplaçable à l'identification de nouveaux récepteurs cellulaires. Plus tard, l'importance médicale d'un grand nombre de toxines bactériennes a largement contribué à poser les fondements de l'immunologie (immunothérapie spécifique, allergie), et entraîné le développement d'une recherche thérapeutique toujours d'actualité. En revanche, la biosynthèse des toxines - comme on disait naguère -, les mécanismes de la toxinogenèse - comme on tend à dire aujourd'hui -, ont été et restent moins explorés en dépit de l'apport incomparable de la génomique. De fait, la connaissance des voies métaboliques qui conduisent à l'élaboration puis à l'excrétion de toxines apporte des réponses incomplètes à des problèmes de Santé publique touchant l'écologie que sait-on du déterminisme des pullulations d'espèces venimeuses ou toxiques ? Des facteurs déclenchant la toxinogenèse au sein de populations de microorganismes à toxicité variable ? Quel est ou quel peut être le rôle de l'anthropisation des milieux dans ces phénomènes ? Peut-on identifier, prévoir, prévenir les conditions d'apparition et de développement de véritables systèmes toxinogènes, naturels ou anthropiques, concept qui demande sans doute à être précisé ou validé ? Cet ouvrage apporte un éclairage neuf sur une problématique majeure de la sphère biomédicale. M. Goyffon, MNHN.
Les travaux fondateurs de Claude Bernard, au milieu du XIXe siècle, ont ancré la notion maintenant familière de toxines considérées comme outils pharmacologiques d'une incomparable précision aujourd'hui encore les toxines bloqueurs de canaux ioniques, par exemple, apportent une contribution irremplaçable à l'identification de nouveaux récepteurs cellulaires. Plus tard, l'importance médicale d'un grand nombre de toxines bactériennes a largement contribué à poser les fondements de l'immunologie (immunothérapie spécifique, allergie), et entraîné le développement d'une recherche thérapeutique toujours d'actualité. En revanche, la biosynthèse des toxines - comme on disait naguère -, les mécanismes de la toxinogenèse - comme on tend à dire aujourd'hui -, ont été et restent moins explorés en dépit de l'apport incomparable de la génomique. De fait, la connaissance des voies métaboliques qui conduisent à l'élaboration puis à l'excrétion de toxines apporte des réponses incomplètes à des problèmes de Santé publique touchant l'écologie que sait-on du déterminisme des pullulations d'espèces venimeuses ou toxiques ? Des facteurs déclenchant la toxinogenèse au sein de populations de microorganismes à toxicité variable ? Quel est ou quel peut être le rôle de l'anthropisation des milieux dans ces phénomènes ? Peut-on identifier, prévoir, prévenir les conditions d'apparition et de développement de véritables systèmes toxinogènes, naturels ou anthropiques, concept qui demande sans doute à être précisé ou validé ? Cet ouvrage apporte un éclairage neuf sur une problématique majeure de la sphère biomédicale. M. Goyffon, MNHN.