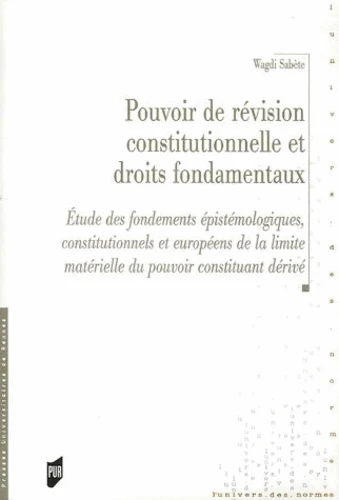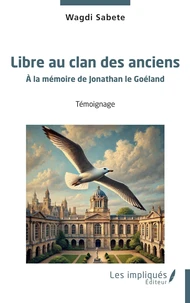Pouvoir de révision constitutionnelle et droits fondamentaux. Etude des fondements épistémologiques, constitutionnels et européens de la limitation matérielle du pouvoir constituant dérivé
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages317
- PrésentationBroché
- Poids0.59 kg
- Dimensions17,0 cm × 24,0 cm × 2,5 cm
- ISBN2-7535-0159-9
- EAN9782753501591
- Date de parution05/01/2006
- CollectionL'univers des normes
- ÉditeurPU Rennes
Résumé
Cet ouvrage analyse sur le plan de la philosophie du droit mais aussi sur le plan du droit positif, constitutionnel et européen, la raison pour laquelle le positivisme normativiste nie l'existence d'une limite matérielle à l'exercice du pouvoir de révision constitutionnelle. Il parvient à une conclusion selon laquelle les résultats de la recherche scientifique en droit public sont conditionnés par la conception philosophique adoptée de ce qu'on considère comme énoncé scientifique.
La controverse doctrinale sur la limitation du pouvoir de révision est fondée essentiellement sur des raisons épistémologiques. Tout dépend donc de la conception philosophique de la science juridique. Le fondement de la limitation du pouvoir constituant en matière de droits fondamentaux dépend, en conséquence, de la conception que nous adoptons de leur " valeur " en droit constitutionnel et européen.
L'erreur de la doctrine formaliste réside dans la confiscation de la souveraineté qui n'appartient qu'au pouvoir constituant originaire en l'attribuant au pouvoir constituant dérivé, erreur qui résulte d'une fidélité à la philosophie de Hume qui sépare entre être et devoir être en éliminant l'acte constituant de l'objet de la recherche. Par ailleurs, l'étude du droit européen montre bien les incidences des normes européennes sur les révisions de normes constitutionnelles.
Enfin, quel que soit le mérite du positivisme juridique et son apport à la construction de la science du droit, force est de constater que l'une de ses marques de faiblesse est sa lutte parfois caricaturale et absurde contre la métaphysique classique. L'erreur qu'il faudrait éviter est de croire que le formalisme qui en découle est indépassable et donc définitif. Le risque est de considérer que le positivisme, fruit de notre modernité, est une pensée définitive, car il n'y a de pensée définitive que pour une modernité qui ne pense plus.
La controverse doctrinale sur la limitation du pouvoir de révision est fondée essentiellement sur des raisons épistémologiques. Tout dépend donc de la conception philosophique de la science juridique. Le fondement de la limitation du pouvoir constituant en matière de droits fondamentaux dépend, en conséquence, de la conception que nous adoptons de leur " valeur " en droit constitutionnel et européen.
L'erreur de la doctrine formaliste réside dans la confiscation de la souveraineté qui n'appartient qu'au pouvoir constituant originaire en l'attribuant au pouvoir constituant dérivé, erreur qui résulte d'une fidélité à la philosophie de Hume qui sépare entre être et devoir être en éliminant l'acte constituant de l'objet de la recherche. Par ailleurs, l'étude du droit européen montre bien les incidences des normes européennes sur les révisions de normes constitutionnelles.
Enfin, quel que soit le mérite du positivisme juridique et son apport à la construction de la science du droit, force est de constater que l'une de ses marques de faiblesse est sa lutte parfois caricaturale et absurde contre la métaphysique classique. L'erreur qu'il faudrait éviter est de croire que le formalisme qui en découle est indépassable et donc définitif. Le risque est de considérer que le positivisme, fruit de notre modernité, est une pensée définitive, car il n'y a de pensée définitive que pour une modernité qui ne pense plus.
Cet ouvrage analyse sur le plan de la philosophie du droit mais aussi sur le plan du droit positif, constitutionnel et européen, la raison pour laquelle le positivisme normativiste nie l'existence d'une limite matérielle à l'exercice du pouvoir de révision constitutionnelle. Il parvient à une conclusion selon laquelle les résultats de la recherche scientifique en droit public sont conditionnés par la conception philosophique adoptée de ce qu'on considère comme énoncé scientifique.
La controverse doctrinale sur la limitation du pouvoir de révision est fondée essentiellement sur des raisons épistémologiques. Tout dépend donc de la conception philosophique de la science juridique. Le fondement de la limitation du pouvoir constituant en matière de droits fondamentaux dépend, en conséquence, de la conception que nous adoptons de leur " valeur " en droit constitutionnel et européen.
L'erreur de la doctrine formaliste réside dans la confiscation de la souveraineté qui n'appartient qu'au pouvoir constituant originaire en l'attribuant au pouvoir constituant dérivé, erreur qui résulte d'une fidélité à la philosophie de Hume qui sépare entre être et devoir être en éliminant l'acte constituant de l'objet de la recherche. Par ailleurs, l'étude du droit européen montre bien les incidences des normes européennes sur les révisions de normes constitutionnelles.
Enfin, quel que soit le mérite du positivisme juridique et son apport à la construction de la science du droit, force est de constater que l'une de ses marques de faiblesse est sa lutte parfois caricaturale et absurde contre la métaphysique classique. L'erreur qu'il faudrait éviter est de croire que le formalisme qui en découle est indépassable et donc définitif. Le risque est de considérer que le positivisme, fruit de notre modernité, est une pensée définitive, car il n'y a de pensée définitive que pour une modernité qui ne pense plus.
La controverse doctrinale sur la limitation du pouvoir de révision est fondée essentiellement sur des raisons épistémologiques. Tout dépend donc de la conception philosophique de la science juridique. Le fondement de la limitation du pouvoir constituant en matière de droits fondamentaux dépend, en conséquence, de la conception que nous adoptons de leur " valeur " en droit constitutionnel et européen.
L'erreur de la doctrine formaliste réside dans la confiscation de la souveraineté qui n'appartient qu'au pouvoir constituant originaire en l'attribuant au pouvoir constituant dérivé, erreur qui résulte d'une fidélité à la philosophie de Hume qui sépare entre être et devoir être en éliminant l'acte constituant de l'objet de la recherche. Par ailleurs, l'étude du droit européen montre bien les incidences des normes européennes sur les révisions de normes constitutionnelles.
Enfin, quel que soit le mérite du positivisme juridique et son apport à la construction de la science du droit, force est de constater que l'une de ses marques de faiblesse est sa lutte parfois caricaturale et absurde contre la métaphysique classique. L'erreur qu'il faudrait éviter est de croire que le formalisme qui en découle est indépassable et donc définitif. Le risque est de considérer que le positivisme, fruit de notre modernité, est une pensée définitive, car il n'y a de pensée définitive que pour une modernité qui ne pense plus.