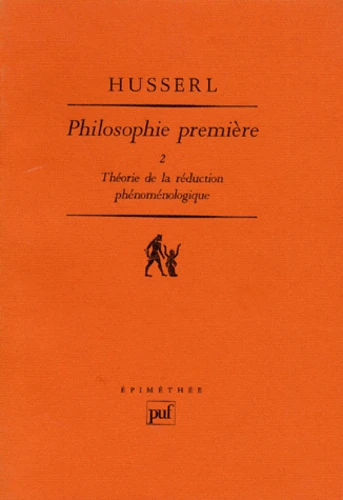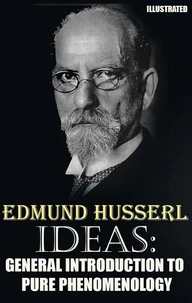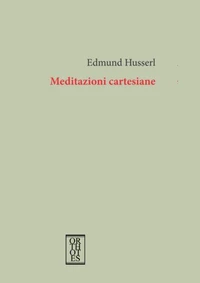PHILOSOPHIE PREMIERE.. Tome 2, (1923-24), Théorie de la réduction phénomènologique
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages328
- PrésentationBroché
- Poids0.5 kg
- Dimensions15,0 cm × 21,5 cm × 2,3 cm
- ISBN2-13-043302-2
- EAN9782130433026
- Date de parution01/07/1990
- CollectionEpiméthée
- ÉditeurPUF
Résumé
Philosophie première appartient à ces textes phénoménologiques qui reflètent l'autroréflexion et l'autocritique d'un penseur en quête d'une philosophie de la raison théorique et pratique. Dans la seconde partie (1923-24), Husserl reprend à son compte la tâche inaugurale de la philosophie en esquissant une " phénoménologie de la phénoménologie ". Là gît le paradoxe : la seconde partie, intitulée théorie de la réduction phénoménologique (les lecçons 28 à 54), reprend à nouveaux frais la réflexion sur le commencement apodictique de la philosophie et sur le sens de la méthode phénoménologique.
Il n'y a, dans l'œuvre de Husserl, aucune notion qui ait suscité autant de malentendus et d'interprétations contradictoires, aucune aussi qui n'engage à ce point le projet husserlien que la réduction phénoménologique. Husserl y revint inlassablement, parce que " les médiations sur la méthode appartiennent déjà à l'édification de la philosophie elle-même ".
Placés sous l'égide de Descartes, ces " Méditations sur la philosophie première " doutent pourtant pour la première fois du modèle cartésien. Elles ébauchent des " chemins nouveaux " vers la phénoménologie transcendantale, les chemins critiques et psychologiques. Elles intègrent aussi des problèmes auparavant inaperçus ou méconnus (solipsisme, intersubjectivité, horizon temporel et monde vécu). Bien que le chemin cartésien garde sa dignité de " voie royale ", l'idée de prima philosophia en appelle du néocartésianisme à une " monadologie " de type leibnizien et une philosophie transcendantale d'inspiration kantienne.
Philosophie première appartient à ces textes phénoménologiques qui reflètent l'autroréflexion et l'autocritique d'un penseur en quête d'une philosophie de la raison théorique et pratique. Dans la seconde partie (1923-24), Husserl reprend à son compte la tâche inaugurale de la philosophie en esquissant une " phénoménologie de la phénoménologie ". Là gît le paradoxe : la seconde partie, intitulée théorie de la réduction phénoménologique (les lecçons 28 à 54), reprend à nouveaux frais la réflexion sur le commencement apodictique de la philosophie et sur le sens de la méthode phénoménologique.
Il n'y a, dans l'œuvre de Husserl, aucune notion qui ait suscité autant de malentendus et d'interprétations contradictoires, aucune aussi qui n'engage à ce point le projet husserlien que la réduction phénoménologique. Husserl y revint inlassablement, parce que " les médiations sur la méthode appartiennent déjà à l'édification de la philosophie elle-même ".
Placés sous l'égide de Descartes, ces " Méditations sur la philosophie première " doutent pourtant pour la première fois du modèle cartésien. Elles ébauchent des " chemins nouveaux " vers la phénoménologie transcendantale, les chemins critiques et psychologiques. Elles intègrent aussi des problèmes auparavant inaperçus ou méconnus (solipsisme, intersubjectivité, horizon temporel et monde vécu). Bien que le chemin cartésien garde sa dignité de " voie royale ", l'idée de prima philosophia en appelle du néocartésianisme à une " monadologie " de type leibnizien et une philosophie transcendantale d'inspiration kantienne.