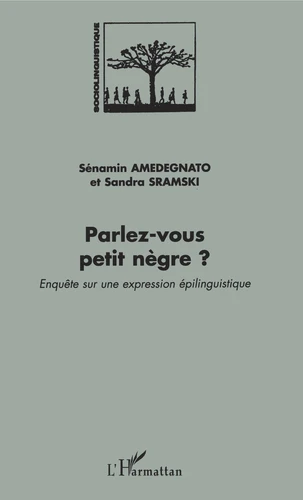Parlez-vous petit nègre ?. Enquête sur une expression épilinguistique
Par : ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages134
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.175 kg
- Dimensions13,5 cm × 21,7 cm × 1,2 cm
- ISBN2-7475-4819-8
- EAN9782747548199
- Date de parution01/11/2003
- CollectionSociolinguistique
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
L'expression française "parler petit nègre", bien que de moins en moins employée aujourd'hui en France, semble soulever, si ce n'est explicitement, du moins dans les imaginaires collectifs sociolinguistiques, une foule de représentations plus ou moins conflictuelles. Réalité sociolinguistique, le "petit nègre" est défini comme un français incorrect, sommaire ou rudimentaire parlé par les indigènes des anciennes colonies françaises (par extension, un style embarrassé) et suscite malaise, gêne, amusement et indifférence feinte.
C'est en tout cas ce que révèle l'enquête dont l'ouvrage rend compte. Mais si les enquêtés sont tous d'accord sur le fait que cette réalité est fautive du point de vue de LA norme (considérée ici comme idéal puriste), leurs attitudes s'étalent, selon l'âge, l'origine ethnique et la catégorie socioprofessionnelle, sur un éventail plutôt large, qui va du déni à la revendication. Le "parler petit nègre" pose aussi problème quant à sa dénomination et sa classification.
Il semble que le désignant et la réalité qu'il décrit soient uniques, car ne répondant pas facilement aux critères définitoires d'autres éléments du paradigme de la langue (par rapport à la norme) : interlangue, dialecte, interlecte, idiolecte, régiolecte, sociolecte, pidgin, créole, charabia...
C'est en tout cas ce que révèle l'enquête dont l'ouvrage rend compte. Mais si les enquêtés sont tous d'accord sur le fait que cette réalité est fautive du point de vue de LA norme (considérée ici comme idéal puriste), leurs attitudes s'étalent, selon l'âge, l'origine ethnique et la catégorie socioprofessionnelle, sur un éventail plutôt large, qui va du déni à la revendication. Le "parler petit nègre" pose aussi problème quant à sa dénomination et sa classification.
Il semble que le désignant et la réalité qu'il décrit soient uniques, car ne répondant pas facilement aux critères définitoires d'autres éléments du paradigme de la langue (par rapport à la norme) : interlangue, dialecte, interlecte, idiolecte, régiolecte, sociolecte, pidgin, créole, charabia...
L'expression française "parler petit nègre", bien que de moins en moins employée aujourd'hui en France, semble soulever, si ce n'est explicitement, du moins dans les imaginaires collectifs sociolinguistiques, une foule de représentations plus ou moins conflictuelles. Réalité sociolinguistique, le "petit nègre" est défini comme un français incorrect, sommaire ou rudimentaire parlé par les indigènes des anciennes colonies françaises (par extension, un style embarrassé) et suscite malaise, gêne, amusement et indifférence feinte.
C'est en tout cas ce que révèle l'enquête dont l'ouvrage rend compte. Mais si les enquêtés sont tous d'accord sur le fait que cette réalité est fautive du point de vue de LA norme (considérée ici comme idéal puriste), leurs attitudes s'étalent, selon l'âge, l'origine ethnique et la catégorie socioprofessionnelle, sur un éventail plutôt large, qui va du déni à la revendication. Le "parler petit nègre" pose aussi problème quant à sa dénomination et sa classification.
Il semble que le désignant et la réalité qu'il décrit soient uniques, car ne répondant pas facilement aux critères définitoires d'autres éléments du paradigme de la langue (par rapport à la norme) : interlangue, dialecte, interlecte, idiolecte, régiolecte, sociolecte, pidgin, créole, charabia...
C'est en tout cas ce que révèle l'enquête dont l'ouvrage rend compte. Mais si les enquêtés sont tous d'accord sur le fait que cette réalité est fautive du point de vue de LA norme (considérée ici comme idéal puriste), leurs attitudes s'étalent, selon l'âge, l'origine ethnique et la catégorie socioprofessionnelle, sur un éventail plutôt large, qui va du déni à la revendication. Le "parler petit nègre" pose aussi problème quant à sa dénomination et sa classification.
Il semble que le désignant et la réalité qu'il décrit soient uniques, car ne répondant pas facilement aux critères définitoires d'autres éléments du paradigme de la langue (par rapport à la norme) : interlangue, dialecte, interlecte, idiolecte, régiolecte, sociolecte, pidgin, créole, charabia...