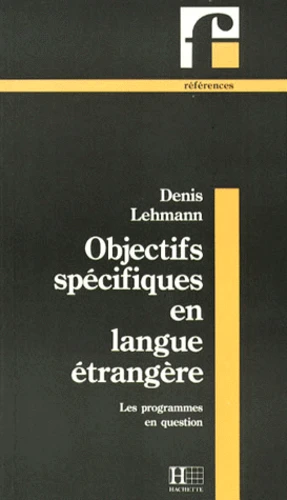Objectifs Specifiques En Langues Etrangeres. Les Programmes En Question
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Nombre de pages223
- PrésentationBroché
- Poids0.215 kg
- Dimensions12,0 cm × 21,0 cm × 1,2 cm
- ISBN2-01-020646-0
- EAN9782010206467
- Date de parution01/09/1993
- CollectionF / Références
- ÉditeurHachette
Résumé
L'enseignement des langues étrangères aux publics dits spécifiques (en somme les publics scientifiques, techniques et professionnels) n'est pas une question très neuve. Mais c'est une question quelque peu empoisonnée, au point que l'on ne sait pas trop comment la nommer : certains emploient le terme de " langues de spécialité ", tandis que d'autres parlent de " langues pour non-spécialistes " (à comprendre comme " non-spécialistes des langues ").
On a longtemps donné la priorité au contenu, en privilégiant les caractéristiques des discours spécialisés. Puis on a construit de vastes " systèmes " centrés sur la variété des besoins des apprenants, et cela a pu s'appeler le " français fonctionnel ".
Aujourd'hui l'on tente d'explorer d'autres voies. D'une part, on prend conscience de l'importance des facteurs culturels dans la communication spécialisée : qu'il s'agisse des échanges de travail ou de l'expression de la pensée scientifique et technique. D'autre part, on met en examen les principes d'élaboration des programmes, et l'on se demande s'il est possible de placer les conditions de l'apprentissage lui-même au cœur de la problématique, plutôt que les seuls besoins langagiers ou les caractéristiques des discours visés.
L'enseignement des langues étrangères aux publics dits spécifiques (en somme les publics scientifiques, techniques et professionnels) n'est pas une question très neuve. Mais c'est une question quelque peu empoisonnée, au point que l'on ne sait pas trop comment la nommer : certains emploient le terme de " langues de spécialité ", tandis que d'autres parlent de " langues pour non-spécialistes " (à comprendre comme " non-spécialistes des langues ").
On a longtemps donné la priorité au contenu, en privilégiant les caractéristiques des discours spécialisés. Puis on a construit de vastes " systèmes " centrés sur la variété des besoins des apprenants, et cela a pu s'appeler le " français fonctionnel ".
Aujourd'hui l'on tente d'explorer d'autres voies. D'une part, on prend conscience de l'importance des facteurs culturels dans la communication spécialisée : qu'il s'agisse des échanges de travail ou de l'expression de la pensée scientifique et technique. D'autre part, on met en examen les principes d'élaboration des programmes, et l'on se demande s'il est possible de placer les conditions de l'apprentissage lui-même au cœur de la problématique, plutôt que les seuls besoins langagiers ou les caractéristiques des discours visés.