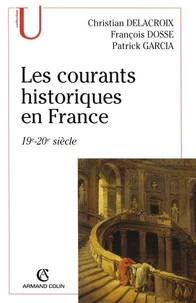Michel de Certeau est une figure intellectuelle singulière : son exigence hors du commun le pousse à traverser tous les continents des sciences humaines en pleine effervescence dans les années 1960 et 1970. À la fois jésuite, historien, anthropologue, sémiologue, théologien et spécialiste de la mystique du XVIIe siècle, Certeau, sans avoir été psychanalyste, aura été aussi un des fondateurs de l'École freudienne de Paris. Outre son rapport privilégié à l'archive et son champ particulier d'investigation historique qu'est la mystique, notamment au moment de la coupure moderne du XVIIe siècle, Certeau a développé une très riche réflexion sur ce qu'est l'" opération historiographique ". Même si cette direction de recherche n'est qu'un aspect d'une œuvre plurielle qui s'est engagée dans la voie de l'élucidation des arts de faire du quotidien, c'est cette dimension de l'apport de Michel de Certeau qui est ici interrogée. Braconnier des savoirs, faisant jouer l'interdisciplinarité à partir de l'objet étudié, Certeau permet de mieux situer les apports de la philosophie, de la psychanalyse, de l'anthropologie et de la sémiotique à l'histoire. Cet ouvrage se donne pour objectif d'interroger la pertinence dans l'écriture de l'histoire du temps présent d'un certain nombre de notions et de concepts utilisés par les historiens en se penchant sur le cas précis de l'œuvre de Michel de Certeau, relue à partir de la conjoncture historiographique actuelle. Après avoir été très en écart avec la pratique historienne dans les années 1970, elle est en effet devenue une ressource majeure pour tout historien de la discipline et pour toute réflexion épistémologique sur celle-ci.
Michel de Certeau est une figure intellectuelle singulière : son exigence hors du commun le pousse à traverser tous les continents des sciences humaines en pleine effervescence dans les années 1960 et 1970. À la fois jésuite, historien, anthropologue, sémiologue, théologien et spécialiste de la mystique du XVIIe siècle, Certeau, sans avoir été psychanalyste, aura été aussi un des fondateurs de l'École freudienne de Paris. Outre son rapport privilégié à l'archive et son champ particulier d'investigation historique qu'est la mystique, notamment au moment de la coupure moderne du XVIIe siècle, Certeau a développé une très riche réflexion sur ce qu'est l'" opération historiographique ". Même si cette direction de recherche n'est qu'un aspect d'une œuvre plurielle qui s'est engagée dans la voie de l'élucidation des arts de faire du quotidien, c'est cette dimension de l'apport de Michel de Certeau qui est ici interrogée. Braconnier des savoirs, faisant jouer l'interdisciplinarité à partir de l'objet étudié, Certeau permet de mieux situer les apports de la philosophie, de la psychanalyse, de l'anthropologie et de la sémiotique à l'histoire. Cet ouvrage se donne pour objectif d'interroger la pertinence dans l'écriture de l'histoire du temps présent d'un certain nombre de notions et de concepts utilisés par les historiens en se penchant sur le cas précis de l'œuvre de Michel de Certeau, relue à partir de la conjoncture historiographique actuelle. Après avoir été très en écart avec la pratique historienne dans les années 1970, elle est en effet devenue une ressource majeure pour tout historien de la discipline et pour toute réflexion épistémologique sur celle-ci.