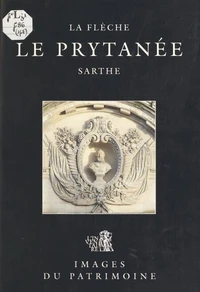La puissance des Plantagenêts, puis la richesse des ducs d'Anjou, les commandes de pièces d'orfèvrerie religieuse par les évêques et abbés, celles d'objets civils par la noblesse et une bourgeoisie active et aisée ont suscité au cours des siècles une floraison d'ateliers d'orfèvres, d'abord à Angers - qui sera toujours le centre le plus actif - aux XII et XIII siècles, à Saumur et Château-Gontier au XVème à Laval au XVIème puis à La Flèche au XIII siècle. Cette activité se poursuit jusque dans le courant du XIX, siècle, avant que les orfèvres parisiens mais aussi lyonnais ne supplantent les marchands orfèvres locaux.
Ce sont près de 800 orfèvres et apprentis qui sont recensés dans le dictionnaire des orfèvres de l'Ancien Régime, auxquels il faut ajouter 85 fabricants marchands du XIXème siècle. Noms prestigieux, telles les dynasties des Hardye, des La Roche ou des Chesneau, ou patronymes jusqu'alors restés dans l'ombre, dont certains ne sont connus que par les sources : leurs biographies ont été rédigées à l'aide de pièces d'archives très largement inédites. La connaissance des orfèvres de l'Anjou et du bas Maine s'en trouve ainsi singulièrement renouvelée et enrichie.
600 poinçons apportent aux chercheurs et collectionneurs un outil de référence incontournable. 421 oeuvres, du XIII au XVIIIe siècle, offrent un répertoire par époque, par type d'oeuvres - religieuses et civiles -, par centre de production : ainsi se révèlent les oeuvres les plus originales, la diversité des types selon les lieux de fabrication, l'évolution des usages, des formes et des décors.
La puissance des Plantagenêts, puis la richesse des ducs d'Anjou, les commandes de pièces d'orfèvrerie religieuse par les évêques et abbés, celles d'objets civils par la noblesse et une bourgeoisie active et aisée ont suscité au cours des siècles une floraison d'ateliers d'orfèvres, d'abord à Angers - qui sera toujours le centre le plus actif - aux XII et XIII siècles, à Saumur et Château-Gontier au XVème à Laval au XVIème puis à La Flèche au XIII siècle. Cette activité se poursuit jusque dans le courant du XIX, siècle, avant que les orfèvres parisiens mais aussi lyonnais ne supplantent les marchands orfèvres locaux.
Ce sont près de 800 orfèvres et apprentis qui sont recensés dans le dictionnaire des orfèvres de l'Ancien Régime, auxquels il faut ajouter 85 fabricants marchands du XIXème siècle. Noms prestigieux, telles les dynasties des Hardye, des La Roche ou des Chesneau, ou patronymes jusqu'alors restés dans l'ombre, dont certains ne sont connus que par les sources : leurs biographies ont été rédigées à l'aide de pièces d'archives très largement inédites. La connaissance des orfèvres de l'Anjou et du bas Maine s'en trouve ainsi singulièrement renouvelée et enrichie.
600 poinçons apportent aux chercheurs et collectionneurs un outil de référence incontournable. 421 oeuvres, du XIII au XVIIIe siècle, offrent un répertoire par époque, par type d'oeuvres - religieuses et civiles -, par centre de production : ainsi se révèlent les oeuvres les plus originales, la diversité des types selon les lieux de fabrication, l'évolution des usages, des formes et des décors.