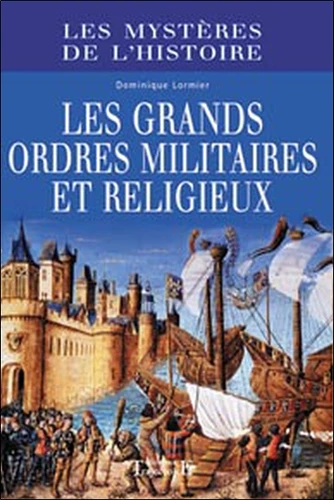Les grands ordres militaires et religieux
Par :Formats :
Disponible d'occasion :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Nombre de pages243
- PrésentationBroché
- Poids0.48 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 1,7 cm
- ISBN2-84197-393-X
- EAN9782841973934
- Date de parution14/10/2006
- CollectionLes mystères de l'Histoire
- ÉditeurTrajectoire (editions)
Résumé
L'affrontement du christianisme et de l'Islam débute au VIIIe siècle. Il atteint son paroxysme au XIe siècle avec la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon en 1099. Le royaume latin qui se crée au Moyen Orient suscite le développement de nombreux ordres à la fois militaires et religieux, dont la vocation est de défendre les positions franques en Orient. Les Templiers, officiellement reconnus par la papauté en 1129, sont de tous les combats.
Leur règle, rédigée par Saint Bernard, fait de ces chevaliers du Christ un ordre tout puissant, dépendant directement du pape. Les Hospitaliers sont souvent à leurs côtés, quoique plus marqués par leur vocation caritative. Après la chute de Saint Jean-d'Acre en 1291, Templiers et Hospitaliers se replient en Europe. Ils sont devenus les banquiers des rois de France. Philippe IV le Bel est décidé à s'emparer de leur trésor...
Quant aux Chevaliers Teutoniques, également présents en Méditerranée, ils cherchent d'abord à christianiser la Prusse et la Livonie, d'où ils seront finalement chassés. L'auteur évoque également les destinées des Chevaliers de Malte (qui résistent aux Turcs), et des ordres espagnols (Santiago et Calatrava), sans oublier celui de Notre Dame de la Merci, dont les membres ont pour vocation de racheter les chrétiens capturés par les musulmans en Méditerranée (près de 500 000 d'entre eux seront ainsi sauvés).
Nés glorieux à l'époque des grandes croisades, tous ces ordres connaissent, à l'exception de celui de Malte, des destinées tragiques et souvent mystérieuses. C'est leur histoire, avec ses heurts et ses malheurs et ses nombreuses énigmes, que raconte ici Dominique Lormier.
Leur règle, rédigée par Saint Bernard, fait de ces chevaliers du Christ un ordre tout puissant, dépendant directement du pape. Les Hospitaliers sont souvent à leurs côtés, quoique plus marqués par leur vocation caritative. Après la chute de Saint Jean-d'Acre en 1291, Templiers et Hospitaliers se replient en Europe. Ils sont devenus les banquiers des rois de France. Philippe IV le Bel est décidé à s'emparer de leur trésor...
Quant aux Chevaliers Teutoniques, également présents en Méditerranée, ils cherchent d'abord à christianiser la Prusse et la Livonie, d'où ils seront finalement chassés. L'auteur évoque également les destinées des Chevaliers de Malte (qui résistent aux Turcs), et des ordres espagnols (Santiago et Calatrava), sans oublier celui de Notre Dame de la Merci, dont les membres ont pour vocation de racheter les chrétiens capturés par les musulmans en Méditerranée (près de 500 000 d'entre eux seront ainsi sauvés).
Nés glorieux à l'époque des grandes croisades, tous ces ordres connaissent, à l'exception de celui de Malte, des destinées tragiques et souvent mystérieuses. C'est leur histoire, avec ses heurts et ses malheurs et ses nombreuses énigmes, que raconte ici Dominique Lormier.
L'affrontement du christianisme et de l'Islam débute au VIIIe siècle. Il atteint son paroxysme au XIe siècle avec la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon en 1099. Le royaume latin qui se crée au Moyen Orient suscite le développement de nombreux ordres à la fois militaires et religieux, dont la vocation est de défendre les positions franques en Orient. Les Templiers, officiellement reconnus par la papauté en 1129, sont de tous les combats.
Leur règle, rédigée par Saint Bernard, fait de ces chevaliers du Christ un ordre tout puissant, dépendant directement du pape. Les Hospitaliers sont souvent à leurs côtés, quoique plus marqués par leur vocation caritative. Après la chute de Saint Jean-d'Acre en 1291, Templiers et Hospitaliers se replient en Europe. Ils sont devenus les banquiers des rois de France. Philippe IV le Bel est décidé à s'emparer de leur trésor...
Quant aux Chevaliers Teutoniques, également présents en Méditerranée, ils cherchent d'abord à christianiser la Prusse et la Livonie, d'où ils seront finalement chassés. L'auteur évoque également les destinées des Chevaliers de Malte (qui résistent aux Turcs), et des ordres espagnols (Santiago et Calatrava), sans oublier celui de Notre Dame de la Merci, dont les membres ont pour vocation de racheter les chrétiens capturés par les musulmans en Méditerranée (près de 500 000 d'entre eux seront ainsi sauvés).
Nés glorieux à l'époque des grandes croisades, tous ces ordres connaissent, à l'exception de celui de Malte, des destinées tragiques et souvent mystérieuses. C'est leur histoire, avec ses heurts et ses malheurs et ses nombreuses énigmes, que raconte ici Dominique Lormier.
Leur règle, rédigée par Saint Bernard, fait de ces chevaliers du Christ un ordre tout puissant, dépendant directement du pape. Les Hospitaliers sont souvent à leurs côtés, quoique plus marqués par leur vocation caritative. Après la chute de Saint Jean-d'Acre en 1291, Templiers et Hospitaliers se replient en Europe. Ils sont devenus les banquiers des rois de France. Philippe IV le Bel est décidé à s'emparer de leur trésor...
Quant aux Chevaliers Teutoniques, également présents en Méditerranée, ils cherchent d'abord à christianiser la Prusse et la Livonie, d'où ils seront finalement chassés. L'auteur évoque également les destinées des Chevaliers de Malte (qui résistent aux Turcs), et des ordres espagnols (Santiago et Calatrava), sans oublier celui de Notre Dame de la Merci, dont les membres ont pour vocation de racheter les chrétiens capturés par les musulmans en Méditerranée (près de 500 000 d'entre eux seront ainsi sauvés).
Nés glorieux à l'époque des grandes croisades, tous ces ordres connaissent, à l'exception de celui de Malte, des destinées tragiques et souvent mystérieuses. C'est leur histoire, avec ses heurts et ses malheurs et ses nombreuses énigmes, que raconte ici Dominique Lormier.