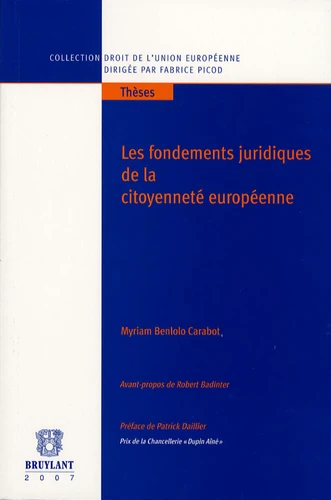Les fondements juridiques de la citoyenneté européenne
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Nombre de pages782
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids1.26 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 4,4 cm
- ISBN978-2-8027-2190-1
- EAN9782802721901
- Date de parution17/04/2007
- CollectionDroit de l'UE. Thèses
- ÉditeurBruylant (Emile)
- PréfacierRobert Badinter
- PréfacierPatrick Daillier
Résumé
Révolution juridique pour les uns, mirage pour les autres, la citoyenneté européenne, consacrée en 1992 par les articles 17 à 22 du traité instituant la Communauté européenne, suscite controverses et passions politiques. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement? Instaurée en dehors du cadre étatique, et préexistante à un peuple européen, la citoyenneté de l'Union bouscule les fondements mêmes des démocraties européennes. C'est logiquement le lien qu'entretient la citoyenneté de l'Union avec les nationalités internes qui illustre le mieux toutes les ambiguïtés de l'entreprise communautaire. En effet, bien qu'expressément dépendante de la nationalité d'un État membre, la citoyenneté européenne est une remise en cause profonde des schémas traditionnels: elle est fondée sur la pluralité des nationalités, refusant intrinsèquement l'idée d'une appartenance unique entre un ordre juridique et un individu. Ce n'est pas là la moindre de ses originalités: privée d'une dimension politique pleine et entière, la citoyenneté de l'Union, notamment par le biais du principe d'égalité de traitement et du droit de séjour, démontre la viabilité d'un véritable statut juridique, conféré à des personnes de nationalités différentes et qui entendent le rester. Dans ce processus, propice à l'uniformisation d'un "territoire communautaire", c'est le critère de résidence, pourtant fermement rejeté comme voie d'accès directe, qui permet de donner corps à la citoyenneté européenne. Laboratoire d'une conception certainement nouvelle de l'appartenance, la jeune citoyenneté de l'Union cristallise aussi, et sans doute pour cette raison, toutes les résistances nationales. Fondée sur les nationalités, mais alimentée par le territoire, elle est, aujourd'hui plus que jamais, l'avenir de l'aventure communautaire.
Révolution juridique pour les uns, mirage pour les autres, la citoyenneté européenne, consacrée en 1992 par les articles 17 à 22 du traité instituant la Communauté européenne, suscite controverses et passions politiques. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement? Instaurée en dehors du cadre étatique, et préexistante à un peuple européen, la citoyenneté de l'Union bouscule les fondements mêmes des démocraties européennes. C'est logiquement le lien qu'entretient la citoyenneté de l'Union avec les nationalités internes qui illustre le mieux toutes les ambiguïtés de l'entreprise communautaire. En effet, bien qu'expressément dépendante de la nationalité d'un État membre, la citoyenneté européenne est une remise en cause profonde des schémas traditionnels: elle est fondée sur la pluralité des nationalités, refusant intrinsèquement l'idée d'une appartenance unique entre un ordre juridique et un individu. Ce n'est pas là la moindre de ses originalités: privée d'une dimension politique pleine et entière, la citoyenneté de l'Union, notamment par le biais du principe d'égalité de traitement et du droit de séjour, démontre la viabilité d'un véritable statut juridique, conféré à des personnes de nationalités différentes et qui entendent le rester. Dans ce processus, propice à l'uniformisation d'un "territoire communautaire", c'est le critère de résidence, pourtant fermement rejeté comme voie d'accès directe, qui permet de donner corps à la citoyenneté européenne. Laboratoire d'une conception certainement nouvelle de l'appartenance, la jeune citoyenneté de l'Union cristallise aussi, et sans doute pour cette raison, toutes les résistances nationales. Fondée sur les nationalités, mais alimentée par le territoire, elle est, aujourd'hui plus que jamais, l'avenir de l'aventure communautaire.